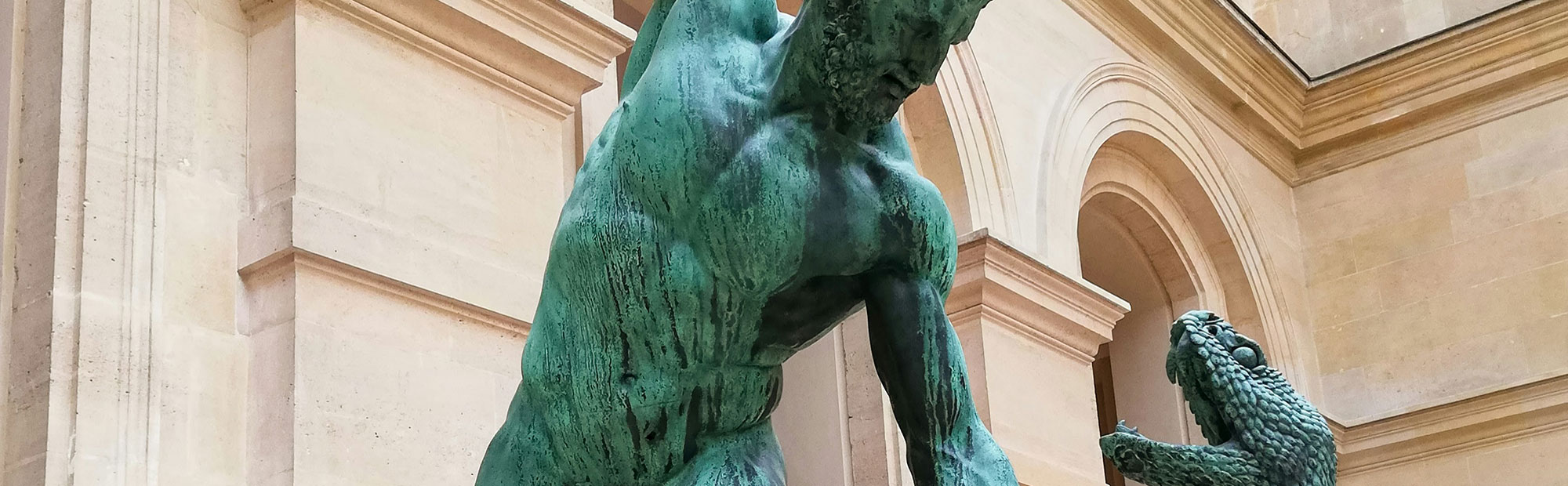Recherche
Résultats de la recherche
2299 résultats trouvés
Louis André (1960-2019)

Louis André nous a quittés, à 58 ans. Conservateur du patrimoine, il avait rejoint le Musée des arts et métiers en 1991 après un début de carrière au service de l’Inventaire général en Champagne-Ardenne et la direction du Musée des mines de fer de Neufchef-Aumetz en Lorraine. Louis a joué un rôle majeur au sein de la jeune équipe qui a conduit la rénovation de ce Musée bicentenaire dont la collection d’objets et de dessins techniques est unique au monde. Premier responsable des collections Communication et Transports, il a été co-commissaire de l’exposition de préfiguration du Musée rénové organisée en 1997 au Palais de la découverte sur le thème « La mécanique au temps des automates ».
Grand conteur d’histoires d’objets, Louis savait mieux que quiconque illustrer l’entrée de l’Avion de Blériot au Conservatoire des arts et métiers, le premier accident automobile de l’histoire avec le Fardier de Cugnot ou l’Alliage du Conservatoire si important pour la mise en place du système métrique. Ses articles dans La Revue du Musée, ses ouvrages sur « Les Machines à papier », « L’Abbaye de Fontenay » ou « Aristide Bergès » témoignent de sa grande rigueur et de sa parfaite érudition en histoire des techniques.
En 1999, Louis André quitte le Musée pour une autre vie professionnelle, celle d’un enseignant-chercheur unanimement reconnu et apprécié par ses collègues et ses étudiants. Il est nommé Maître de conférences à l ‘université de Clermont-Ferrand puis à Rennes-II où il co-dirigeait un Master et préparait ses étudiants aux concours de l’Institut national du Patrimoine qu’il connaissait bien.
Très engagé dans la vie associative, Louis André était également secrétaire général du CILAC, l’Association pour l’étude, la conservation et la mise en valeur du patrimoine industriel en France. A ce titre, il a largement contribué à la réussite du XVI° Congrès sur le Patrimoine industriel qui s’est tenu à Lille en 2015 et a assuré avec succès la transformation de la revue du CILAC Patrimoine industriel. Tout récemment il était à Morlaix pour conseiller les responsables du projet Espace des Sciences dans l’ancienne Manufacture des Tabacs.
Le Musée des arts et métiers aujourd’hui se souvient de toutes les années où plus jeune Louis brillait par sa créativité, son dynamisme, sa compétence bien sûr et aussi son humour. Notre Musée rénové lui ressemble, inventif, généreux, rigoureux, attentif aux publics et à nos partenaires. Merci Louis pour tout ce que vous avez apporté à vos collègues qui restent désemparés.
Nous pensons avec beaucoup d’affection à votre famille, à votre épouse, à vos trois filles et à cette ville du Mans où vous résidiez. Le Mans, ville de la famille Bollée, Amédée, Louis et encore Amédée, vous racontiez si bien l’histoire de L’Obéissante premier « autobus » à vapeur qui en 1875 relia pour la première fois Le Mans à Paris en 18 heures ! Avec d’autres véhicules historiques L’Obéissante est en bonne place dans l’ancienne église de Saint Martin des Champs devenue à la Révolution Conservatoire des arts et métiers et Panthéon des techniques.
Merci Louis, nous ne vous oublions pas.
Anne-Laure Carré
et Dominique Ferriot
Commission scientifique nationale des collections

Introduction
À l’initiative de la sénatrice Catherine Morin-Desailly, la loi n° 2010-501 du 18 mai 20102 a autorisé la restitution à la Nouvelle- Zélande des têtes tatouées de guerriers maoris conservées dans les collections publiques, et notamment dans celles du muséum d’histoire naturelle de la Ville de Rouen en Seine-Maritime. Ainsi l'article 1er dispose « qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les têtes maories conservées par les musées de France cessent de faire partie de leurs collections pour être remises à la Nouvelle-Zélande. »
Mais le débat ouvert à l'occasion de cette loi s'est élargi, bien au-delà, aux conditions de gestion des collections. En effet, les trois autres articles ajoutés au cours du débat parlementaire, sur proposition du rapporteur, le sénateur Philippe Richert, concernent la création d’une Commission scientifique nationale des collections qui « a pour mission de conseiller les personnes publiques ou les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d’art contemporain dans l’exercice de leurs compétences en matière de déclassement3 de biens culturels appartenant à leurs collections, à l’exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques. » Compétente pour traiter du déclassement, c’est-à-dire de la sortie du domaine public de biens appartenant aux collections, la commission ne l’est pas pour intervenir sur le sort à leur réserver par la suite qu’il s’agisse de les transférer à un État étranger ou de les aliéner.
La création de la commission se situe dans la suite d’un débat récurrent sur l’inaliénabilité des collections publiques. Le principe de l’inaliénabilité des biens faisant partie du domaine public a, singulièrement dans notre pays, une longue histoire qui remonte aux légistes de l’Ancien Régime. Il a été conforté en 2002 par la « loi relative aux musées de France » qui dispose, d’une part, que « les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables » et, d’autre part, que ce principe comporte des exceptions (« toute décision de déclassement d’un de ces biens ne peut être prise qu’après avis conforme de la commission nationale scientifique des collections des musées de France »). Il s'applique surtout de manière plus globale à l'ensemble du domaine public mobilier depuis que l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) a fourni la première définition générale de ce domaine public dans son article L2112-1. Le débat n’a pas cessé pour autant et les discussions sur la restitution de la « Vénus Hottentote »4 puis sur les « têtes maories » ont été l’occasion, pour le Parlement, de le reprendre. En constatant que les biens relevant de la loi de 2002 sur les musées de France n’avaient fait l'objet que d'un seul cas de déclassement, le Parlement a souhaité formaliser les procédures de sortie du domaine public et des collections, au-delà de celles des seuls musées de France, à l’ensemble des collections appartenant au domaine public mais également à certaines collections appartenant à des personnes privées. Il a également souligné qu’une réflexion spécifique devait être engagée sur la délicate question des restes humains.
Ainsi, la loi donne à la Commission scientifique nationale des collections une compétence élargie par rapport à celle de la Commission scientifique des collections des musées de France qui avait été instituée par la "loi « loi musées ». Elle prend en compte le code général de la propriété des personnes publiques dont l'article L2112-1 dispose que « font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’art, de l’histoire, de l’archéologie, de la science ou de la technique ». Cette définition s’accompagne d’une énumération non exhaustive de diverses catégories de biens qui recoupent celles pour lesquelles la commission nationale scientifique des collections est compétente.
Dans plusieurs de ces domaines, le déclassement est déjà une pratique traditionnelle. Ainsi le Mobilier national et la Manufacture nationale de Sèvres aliènent périodiquement des biens qui faisaient partie de leurs collections. La loi prévoit d’ailleurs que la commission n’intervient pas dans les mêmes conditions dans tous les secteurs patrimoniaux. Son avis conforme est nécessaire dans certains, alors qu’elle ne rend qu’un avis simple dans d’autres. Le dispositif qui résulte de ces textes est en conséquence complexe et implique un effort de définition du champ de compétence de la commission aussi bien que de la notion même de collections dont certaines justifient son conseil alors même qu’elles sont gérées par des personnes privées.
C’est pour prendre en compte cette diversité que les textes réglementaires d’organisation de la commission ont défini une structure en plusieurs collèges selon la nature des collections en cause. La mise en place de la structure et la désignation de ses membres ayant exigé plus de temps que prévu, la commission n’a été installée officiellement que le 21 novembre 20135.
L’article 4 (non codifié) de la loi n° 2010-501 du 18 mai 2010, créant la commission scientifique nationale des collections, a prévu que cette commission « remet au Parlement un rapport sur ses orientations en matière de déclassement ou de cession des biens appartenant aux collections dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi. » À défaut d'avoir pu respecter ces délais initiaux, la commission s’est efforcée de produire le présent rapport dans un délai d’un an après son installation.
Élaboré au terme d’une intense mobilisation des quatre collèges qui composent la commission (voir en annexe n°2 le compte-rendu d’activité), ce rapport cerne, dans une première partie, le champ de ses compétences avant de préciser les conditions de son intervention éventuelle dans chacun des domaines qui ressortent des textes et d’aborder enfin la question sensible des restes humains.
Le rapport a été adopté le 21 novembre 2014 par la commission réunie en séance plénière, un an après son installation.
2. Loi n° 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la NouvelleZélande et relative à la gestion des collections (Journal officiel de la République française le 19 mai 2010)
3. Les termes en gras dans cette introduction font l’objet d’une définition dans le glossaire p. 6 du présent volume.
4. La restitution de la « Vénus Hottentote » a fait l’objet d’une proposition de loi d’initiative sénatoriale
5. Le décret d’organisation n° 2011-160 du 8 février 2011, codifié aux articles R115-1 et suivants du code du patrimoine (voir ensemble des textes de la loi et du décret en annexe n°1), a été publié au Journal officiel le 10 février 2011, mais la nomination des membres désignés par l’administration a demandé deux années supplémentaires (arrêté ministériel du 24 janvier 2013), le temps pour le ministère de la culture et de la communication d'obtenir les noms de tous les membres pressentis de la part des autres services concernés puis de les faire confirmer après les changements de gouvernement en mai et juin 2012. La désignation des membres représentant les collectivités territoriales a demandé une année supplémentaire. Le dernier d'entre eux ayant été désigné en septembre 2013, la commission a été convoquée et officiellement installée le 21 novembre 2013.
------
Rapport mentionné dans la publication Les restes humains dans les collections publiques, outil d'aide à la gestion des collections de restes humains patrimonialisés dans les établissements publics français publié par l'Ocim :
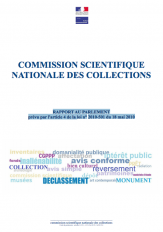
Musées et patrimoines au Brésil : expériences communautaires et insurgentes
Face à la dramatique actualité politique brésilienne, aux conséquences sociales, écologiques et culturelles aujourd’hui incalculables, il n’est pas inutile de souligner la singularité et la richesse des expérimentations en muséologie et patrimoine qui s’y déroulent depuis la fin des années 1980. Hugues de Varine n’a-t-il pas avancé que le Brésil « est un des leaders de la nouvelle muséologie ». Alors même que la France a tourné le dos depuis longtemps à ce courant novateur, né dans les années soixante de la critique radicale du musée européen, bourgeois, centré sur la collection et les beaux-arts, le mouvement muséologique brésilien a généré des formes originales et plurielles, musées communautaires, indigènes, de rue, de favelas…, visant le changement social et développant une fonction politique d’encapacitation des personnes et des collectifs.
À cette première différence de taille entre France et Brésil s’en ajoute une seconde qui tient au lien étroit entre musée et patrimoine pensé par la muséologie sociale, quand des partages divers – mobilier/immobilier, matériel/immatériel –, aux effets neutralisant, différencient les institutions françaises et formatent les approches. Peut-être est-il alors possible d’avancer un troisième contraste, relatif alors au poids des institutions patrimoniales au regard de leur ancienneté et de la force des traditions qu’elles ont instaurées : la « jeunesse » des institutions brésiliennes favorisant une plus grande labilité de la notion de patrimoine, son appropriation et l’émergence de pratiques « insurgentes » (Castriota).
Cette journée donnera lieu à la présentation de situations singulières qui permettront de faire valoir la singularité des approches et pratiques brésiliennes. Effet direct d’une « mobilité sortante » soutenue par la Région de Bourgogne-Franche-Comté, elle est une première concrétisation d’un partenariat entre l’université de Bourgogne et l’université fédérale de Pelotas (RS) et constitue l’amorce d’un réseau de recherche unissant le Centre Georges Chevrier (Université de Bourgogne), le Programme d’études supérieures en mémoires sociales et patrimoine (Université Fédérale de Pelotas), le Programme de Post-Graduation en environnement bâti et patrimoine soutenable (Université Fédérale du Minas Gerais), et l’université Fédérale de Goias (Bacharelado en Muséologie et Programme de Post-graduation en Anthropologie Sociale).
Entrée libre, gratuite, sans inscription, dans la limite des places disponibles.
La manifestation se déroulera à l'université de Bourgogne, sur le campus de Dijon,
à la Maison des Sciences de l'Homme.
Adresse : Université de Bourgogne - 2, boulevard Gabriel - 21000 Dijon.
"Eclairage et muséographie"
Thème
L’éclairage intervient à différents niveaux de la muséographie que ce soit comme élément d’expression, d’ergonomie mais aussi facteur de détérioration des collections. Les sources et les variables lumineuses sont multiples pour structurer l’exposition et jouer sur les températures de couleur, les intensités, les textures…
Quelle est la place de l’éclairage dans l’exposition, de sa conception à sa réception ? Comment inventer ce dialogue entre la lumière et l’espace et créer ainsi des ambiances, donner vie aux objets et accompagner l’expérience du visiteur ?
En s’appuyant sur des retours d’expérience et les questionnements des professionnels, cette formation propose d’interroger l’éclairage comme objet signifiant et porteur du sens dans l’exposition.
Objectifs de la formation
• Apporter des éléments théoriques sur l’éclairage muséographique
• S’appuyer sur la visite d’une exposition pour analyser la place et le rôle de la lumière
• Échanger autour des pratiques entre professionnels : projets, questions, solutions
Destinataires
Toute personne en relation avec l’installation, la maintenance, la mise en place et la conception d’une exposition
Parcours professionnalisant : exposition
Frais de participation
160 € incluant la restauration du midi
ALIPH - Appel annuel à projets
Présentation d’ALIPH
ALIPH est une initiative unique de coopération internationale en vue de faire face au défi de la protection du patrimoine culturel dans les zones en conflit. ALIPH, dont l'acronyme désigne la première lettre de l'alphabet arabe, a pour vocation d’agir en faveur du patrimoine culturel dans les zones en conflit, grâce à un programme de subvention qui lui permet flexibilité et réactivité.
Les trois domaines d’intervention d’ALIPH sont : la protection préventive pour atténuer les risques de destruction, les mesures d’urgence pour assurer la sécurité du patrimoine, et les actions post-conflits pour que les populations puissent à nouveau jouir de leur patrimoine culturel.
Basée à Genève, ALIPH est une organisation à but non lucratif ayant obtenu le statut d’organisation internationale. Elle a pour vocation de contribuer à la protection du patrimoine culturel dans les zones en conflit. Il s’agit d’une initiative unique de coopération internationale réunissant des investisseurs publics et privés, créée pour soutenir financièrement des actions ayant trait à la prévention, la protection et la réhabilitation du patrimoine culturel menacé ou endommagé par un conflit.
Appel annuel à projets
Les projets sélectionnés viseront à réaffirmer les principes fondateurs d’ALIPH, notamment la conviction que protéger le patrimoine dans les zones en conflit contribue au développement de valeurs telles que la paix et la réconciliation, la solidarité internationale, la cohésion sociale et le vivre-ensemble, la diversité culturelle, l’éducation et la formation, le développement local et durable, et l’égalité femme-homme.
Les projets proposés devront porter sur la prévention, la protection et la restauration du patrimoine matériel et immatériel situé dans les zones de conflits.
Lignes directrices pour les demandes de subventions "Appel à projets annuel - 2019" ci-contre.
Dépôt des candidatures en ligne
Date limite de dépôt des candidatures : 15 mars 2019 à 15h00 CET.
Pour en savoir plus, consultez le site Internet d'ALIPH.
Repenser le musée à l'aune de l'archéologie contemporaine
La conférence annuelle d'ICMAH (Comité international pour les Musées et les Collections d’archéologie et d’histoire) se tiendra à Kyoto, au Japon.
Au cours de cette conférence, ICMAH souhaiterait examiner le rôle des musées archéologiques et historiques dans l'archéologie contemporaine. Dans chaque pays, de nombreux musées étaient autrefois les centres d'activités et d'études archéologiques, et beaucoup le sont encore.
Cependant, les relations traditionnelles entre les musées et l'archéologie évoluent, avec la pratique de l'archéologie préventive (ou de sauvetage) et d'autres pratiques de recherche en archéologie qui se multiplient et se dispersent. La diversité des organisations archéologiques modifie également l'accès aux ressources et aux données dans une même région. Dans ce contexte, un certain nombre de collections sont fréquemment exposées en dehors des musées. Pourtant, le public continue de penser que le musée demeure l'endroit où conserver les objets, les découvertes et les collections archéologiques.
Comment considérer cet écart ? Comment conserver nos musées actifs, actuels et attractifs, en tant que "plaque-tournante" de l'archéologie contemporaine ? Comment musées et organisations associées devraient-ils collaborer avec les communautés locales, pour offrir une richesse de connaissances en archéologie et en histoire ? Ce thème propose également d'évaluer plus largement la notion de musée comme "pôle culturel". L'approche consiste à ouvrir des perspectives sur les missions des musées d'archéologie et d'histoire, pour servir les communautés.
Programme
Etant donné le programme dense de la 25e Conférence Générale d'ICOM, la conférence annuelle de l'ICMAH se déroulera sur trois après-midi, trois jours après les séances plénières.
2 septembre : Session 1, Archéologie, collections et recherches
3 septembre : Session 2, Les expositions comptent / Session 3, Les possibilités de médiation
4 septembre : Session 4, Discussions autour du concept de "pôles culturels" dans le contexte de l'archéologie
Suivies des élections du bureau de l'ICMAH
5 septembre : Visite de sites
Visite de sites
La visite de l'ICMAH aura lieu à Osaka, au musée d'histoire - château d'Osaka : ouverte à 50 personnes maximum, sur inscription.
La participation est gratuite : vous êtes invité par l'ICMAH. L'inscription est nécessaire pour fixer le nombre de participants : la priorité est donnée aux membres de l'ICMAH. Le musée d’histoire d’Osaka, ouvert en 2001, est un musée d’histoire avec les vestiges archéologiques des palais antiques sur lesquels il est construit (VIe siècle); le 10ème étage du musée est dédié au palais Naniwa reconstruit.
Le musée est consacré à l'urbanisation de la ville, depuis ses origines jusqu'aux temps modernes. Le château d'Osaka (à 20 minutes à pied du musée) est l'un des châteaux les plus célèbres du Japon. Il a joué un rôle majeur dans l'unification du Japon au XVIe siècle, au cours d'une des dernières rébellions contre les Tokugawa.
Informations
La conférence se tiendra en anglais : aucune traduction ne pourra être assurée.
La participation à la conférence annuelle de l'ICMAH est gratuite. Les frais de transport et de séjour des participants ne pourront être pris en charge par l'ICMAH.
Toutes les contributions à la conférence annuelle feront l'objet d'une publication dans la revue en ligne de l'ICMAH, diffusée sur son site internet.
Les inscriptions à la conférence et aux visites de sites sont obligatoires.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site d'ICMAH : http://network.icom.museum/icmah et téléchargez le livret au sujet de la conférence : http://network.icom.museum/icmah/events/coming-conference/
Appel à contributions et inscriptions
31 mars 2019 : date limite pour soumettre vos propositions de contribution à la conférence annuelle de l'ICMAH.
1er juillet 2019 : date limite d'inscription à la conférence annuelle et aux visites de site
Plus d'informations pour le dépôt de vos contributions et vous inscrire : formulaires
La Photographie, outil et / ou finalité de l’exposition
Coordination scientifique : Beatrice Piazzi, ethnomuséographe, doctorante à l’Université d’Artois,
avec Isabelle Roussel-Gillet et Serge Chaumier (MEM).
Beatrice Piazzi : beatrice.piazzi[a]gmail.com / serge.chaumier[a]univ-artois.fr
En partenariat avec les deux associations professionnelles : Les Muséographes / Association Nationale des Iconographes (ANI)
A l’occasion de l’exposition présentée par le master MEM avec des collections du Centre Régional de la Photographie des Hauts-de-France accueillie à la Halle aux sucres de Dunkerque en mars 2019, se tient une journée d’étude professionnelle consacrée à la muséographie de la photographie.
La photographie est tantôt exposée pour elle-même, dans une démarche artistique, tantôt comme outil documentaire, témoignage, ou encore comme élément scénographique dans une exposition thématique. Elle n’est alors qu’un des éléments parmi d’autres des expôts convoqués. Pour autant son statut est particulier et sa charge présentielle souvent très forte donne à l’exposition un caractère marquant.
Nous nous intéresserons lors de cette journée d'étude aux problématiques rencontrées par les iconographes dans leur relation aux muséographes, mais aussi aux graphistes et scénographes. Les aspects éditoriaux, expographiques, de réception par les visiteurs, les enjeux de conservation mais aussi juridiques seront autant de points mis en relation avec le statut de l’image. Ce sera aussi l’occasion de traiter des logiques métiers, des interrelations et collaborations entre professionnels autour de la muséographie de la photographie.
Public cible de la journée : journée à destination de professionnels des musées, de l’exposition, de l’image et des étudiants en muséographie du master MEM, des professionnels en charge de la valorisation d’un fonds photographique dans le cadre d’exposition permanente ou temporaire en institution ou comme prestataire, et de tout professionnel acteur de l’élaboration d’une exposition (conservateur, commissaire/ muséographe, régisseur, artiste photographe, documentaliste, chercheur, juriste, iconographe, graphiste, agence).
Inscription gratuite sur réservation en envoyant un mail à : journee.etude.mem@gmail.com
"Culture du réseau, réseaux de la culture"
Les Rencontres professionnelles sont organisées annuellement autour de deux journées d'études thématiques. Ce congrès national, ouvert à l'ensemble des professionnels de la culture et du tourisme, chercheurs et étudiants, se veut un moment d'échange, de débat et de partage autour de nos pratiques professionnelles. Il comprendra pour cela des tables rondes, des échanges d'expériences, des visites de sites, l'intervention de chercheurs, mais aussi l'intervention d'acteurs de la société civile et des ateliers participatifs.
Plus d'informations sur le programme en ligne :
Contact : contact[a]fems.asso.fr / 04 84 35 14 87
www.fems.asso.fr
Les petits spécimens 3
Les petits spécimens est le rendez-vous annuel du Signe avec les familles et le jeune public.
À l’occasion de sa troisième édition, le parcours et ses ateliers vous invitent à organiser et bâtir ensemble une véritable ville à l’intérieur du Signe !
Commissariat : Marion Bataille, EXTRA et Fanny Millard
Accès libre et gratuit, ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h. 7j/7
Pour plus d'informations : 03 25 35 79 01 ou contact[a]cndg.fr
Les réserves sont-elles le cœur des musées ?
Retrouvez l'intégralité de cette soirée-débat déontologie en vidéos
Captations
Retrouvez la publication de la synthèse de la soirée
Publication
Ce cycle propose de débattre des questions vives qui font l’actualité des musées sous l’angle des pratiques déontologiques définies par ICOM.
Les réserves sont-elles le cœur des musées ?
En trente ans, la muséographie - c’est-à-dire la mise en scène, dans un parcours conçu pour être attractif et intelligible, d’objets emblématiques, fruits d’une savante sélection dans les « collections » - a pris une place décisive et conduit en réserves nombre d’œuvres ou d’objets ne remplissant pas ces conditions. Les enjeux relatifs à l’exposition, l’étude et la transmission du patrimoine comme les problématiques liées à l’acquisition et à la constitution des collections ont toujours retenu l’attention des professionnels mais les pratiques de conservation restent encore peu étudiées alors même que le modèle du musée se diffuse, s’exporte, se transforme profondément, entrainant la volonté d’étudier à la fois la face publique du musée mais aussi ses coulisses encore trop souvent méconnues.
Comment concilier accessibilité et sécurité des collections ? Comment rendre visible la part invisible des collections ? Espace actif, les réserves ne peuvent l’être que si les conditions de la visite ne portent pas préjudice aux objets. Il faut donc les rendre « visitables » en les sécurisant, en protégeant les objets fragiles des poussières et de toutes les pollutions. La conception de telles réserves n’a, évidemment, plus rien à voir avec les « greniers» qu’elles évoquent encore souvent aux yeux du public. Une conception qui requiert elle-même de très solides compétences d’architectes, de programmistes, d’économistes, de logisticiens... : aujourd’hui, un projet de réserve est au moins aussi complexe qu’un projet de musée et pas toujours moins coûteux...
L’enjeu est de concevoir des projets ouverts et innovants, qui prennent pleinement leur place dans les programmes scientifiques et culturels des musées. Quels sont les leviers d’innovation ? C’est à ces projets que se propose de se consacrer la prochaine soirée déontologie INP/ICOM France.
Le débat se déroulera autour de trois questions :
- Les innovations professionnelles et techniques, notamment en matière de sécurité des collections, de conditions de conservation et restauration, de capacité de travail scientifique sur les objets, de principes organisationnels
- Les aspects économiques : quelles sont les composantes du coût de conception et de rénovation de réserves, les enjeux de mutualisation et d’externalisation...
- Les aspects culturels et sociaux : les projets en cours, des sites architecturaux à part entière ? Pour quels publics ? Quel outil/rôle pédagogique pour des futurs professionnels, comment associer des partenaires ? Quelle médiation pour les réserves ? Comment sensibiliser des élus à ces investissements ?
© Photo by Matt Seymour on Unsplash