
Recherche
Résultats de la recherche
2299 résultats trouvés
Accueil en résidence dans les musées
Dans le cadre de sa stratégie de développement de la recherche partenariale, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche propose aux enseignantes-chercheuses et aux enseignants-chercheurs (ci-après EC) titulaires affectés dans des établissements d’enseignement supérieur un accueil en résidence au sein de musées dont la liste suit, pour l’année universitaire 2023-2024. Les candidats seront accueillis conjointement dans un musée et au sein d’une unité de recherche rattachée à l’InSHS (CNRS). En 2023-2024, 32 semestres de résidences sont proposés.
Les EC retenus continueront d’être rémunérés par leur administration d’origine et cesseront temporairement leur service d’enseignement pendant la période de leur accueil en résidence, afin de se consacrer au projet de recherche qu’ils auront déposé dans leur dossier de candidature. Les candidatures pourront, au choix, porter sur un ou deux semestres de résidence.
Cet accueil en résidence fera l’objet d’une procédure de sélection qui engagera le CNRS et le musée demandé et impliquera l’accord de la direction de leur établissement (à renseigner sur le dossier de candidature, voir infra). Le CNRS est désigné par le MESR pour organiser et piloter cette procédure de sélection.
Objectifs
L’accueil en résidence vise à développer les recherches en sciences humaines et sociales dans les musées. Il s’adresse à l’ensemble des disciplines SHS (histoire de l’art, histoire, archéologie, littérature, philosophie, économie, sociologie, ethnologie, géographie, droit, etc.) et aux approches interdisciplinaires. L’accueil lie une unité de recherche co-pilotée par le CNRS à l’un des musées participant au dispositif, qui sont mentionnés dans la liste à la suite.
Les accueils en résidence devront permettre de réaliser des recherches inédites en lien avec les activités, les bâtiments, les sites ou les collections des musées, et en cohérence avec les orientations scientifiques de l’unité d’accueil. Des opérations conjointes entre les lauréats et les musées pourront être conduites sur la période de la résidence, à l’initiative des EC et en accord avec les musées (cycles de conférences, ateliers, rencontres, etc.). Ces résidences pourront aussi, le cas échéant, être l’occasion de développer des projets collectifs qui auront vocation à être soumis ensuite aux différents dispositifs de soutien à la recherche (ANR, ERC, Emergences, etc.). Les EC bénéficieront ainsi d’un environnement particulièrement propice à la conduite de leurs recherches, tandis que les musées pourront bénéficier du travail scientifique mené par les résidents. Dans ce cadre, les lauréats disposeront d’un espace de travail au sein du musée ainsi qu’un accès facilité aux catalogues et collections. Le musée s’engage à rédiger une convention d’accueil en résidence de l’EC qui précisera les conditions détaillées de son accueil.
Le projet doit être en lien avec les collections, les activités ou les bâtiments et sites des musées sollicités. Il pourra mentionner le type d’opération que les EC seront en mesure de proposer aux musées sur la période de la résidence. Le projet pourra prévoir une collaboration entre plusieurs musées partenaires, sans pour autant que ce soit une exigence.
L’évaluation des candidatures se fera à la fois sur la qualité scientifique du projet, son adéquation avec les collections, les activités, les bâtiments et les sites des musées sollicités, le caractère original de la recherche et sa cohérence avec les axes de l’unité de recherche accueillante.
Les séjours en résidence commenceront à compter du 1er septembre 2023.
Procédure
La résidence fait l’objet d’une convention entre l’établissement d’origine de l’EC, le CNRS et le musée. Les demandes d’accueil en résidence doivent être transmises, pour avis, à la direction de l’établissement d’appartenance de l’EC, à la direction de l’unité de recherche de destination, ainsi qu’à la direction des musées (par l’intermédiaire des contacts listés ci-dessous). Les dossiers des EC ayant reçu un avis favorable devront être transmis à l’InSHS (CNRS), à l’adresse inshs.daa@cnrs.fr, avant le lundi 17 avril 2023 à minuit, sous la forme d’un fichier PDF unique. L’évaluation comportera deux temps : les candidatures feront d’abord l’objet d’une évaluation scientifique avec rapports sous l’autorité de l’InSHS, puis elles seront soumises à une commission d’admission CNRS/Musées.
Composition du dossier
Le dossier est composé des pièces indiquées ci-dessous :
- le formulaire de demande d’accueil en résidence portant l’accord de la direction de l’établissement employeur (présidence de l’Université), l’avis de l’unité de recherche de destination et du musée
- un curriculum vitae, présentant un bilan des travaux de recherche, des charges d’enseignement et des fonctions d’intérêt collectif (10 pages maximum)
- une liste des travaux et publications, indiquant les liens d’accès à la plate-forme HAL
- un projet de recherche scientifique proposé pour l’accueil en résidence en musée (5 pages maximum) comportant un volet préfigurant le type de coopération envisagées entre l’EC et le musée.
Un rapport d’activité sera remis à l’InSHS et au musée d’accueil dans un délai de trois mois après la fin de l’accueil en résidence.
Focus sur la conférence générale de Prague 2022
La présence française à Prague était importante, ce dont témoignait la réception d’ICOM France particulièrement appréciée. Je n’évoquerai pas ici le contenu de mes participations (dont celle, à l’initiative d’ICOM France, sur le plurilinguisme), ni bien sûr le vote de la définition du musée, résultat d’un processus de consultation remarquable, aboutissement de plusieurs années de discussions, de luttes et de compromis, dans lesquelles j’ai été largement impliqué. Je m’attarderai ici essentiellement sur deux points, dans lesquels je me suis le plus investi durant cette conférence.
- Le groupe de travail sur les collections en réserve
Ce groupe a été créé en mars 2022, à la suite du vote à Kyoto d’une résolution concernant ce sujet. Le groupe a été constitué de manière transparente, en demandant aux comités nationaux et internationaux de présenter un délégué afin de participer à ses travaux ; mon nom avait été proposé par l’ICOFOM. Le Président d’ICOM, Alberto Garlandini, m’a demandé de présider ce groupe, constitué d’une dizaine de membres actifs dans le domaine des réserves et représentatifs de la diversité muséale, dont Gaël de Guichen (ICOM-CC) et Moctar Sanfo (ICOM Burkina Faso), tous deux francophones). La conférence de Prague nous a permis de nous réunir autrement que par visioconférence et d’organiser une table-ronde le 22 mars, au sein du bâtiment des congrès. Celle-ci a accueilli une cinquantaine de membres. Nous avons ainsi pu aborder les différents points discutés lors des réunions passées et structurant le rapport que nous avons remis ultérieurement au Conseil exécutif (en novembre 22) : les nouveaux espaces de réserve, les réserves partagées, les réserves ouvertes, et le programme Re-Org initié par l’ICCROM. Le groupe de travail a également discuté les projets ultérieurs, notamment le lancement d’une enquête internationale sur les réserves en 2023 (projet validé par l’ICOM) et celui, ultérieurement, d’un conférence générale sur les réserves en 2024, vraisemblablement à Paris, sur la situation des réserves à l’international.
- Les réunions du comité ICOFOM et le dictionnaire de muséologie.
La présence de membres francophones au sein de l’ICOFOM, le comité international pour la muséologie, constitue un élément important, afin d’assurer la présence de la muséologie française et l’expression d’une pensée originale sur le champ muséal. Durant le mandat précédent (2019-22), cette présence francophone était assurée par Daniel Schmitt (F), Marion Bertin (F), Yves Bergeron (CA), Michèle Rivet (CA) et moi-même en tant qu’ancien Président du comité. Plusieurs séances ont été organisées autour de diverses thématiques (dont celle autour du multilinguisme et une séance autour de la Table ronde de Santiago). Le colloque d’ICOFOM s’est par après déroulé à Prague, au sein du musée national Technique, portant sur l’activisme, les collections et le public, puis à Brno, à l’université Masarik. Deux sessions ont été organisées, la première sur les « muséologies difficiles », durant laquelle j’ai fait une première intervention sur « la muséologie au risque de l’inégalité » et une seconde sur la colonialité. Une session conjointe d’ICOFOM et d’ICTOP, autour de l’importance de Brno pour le développement de la muséologie internationale (les rôles de Jelinek et Stránský, notamment), durant laquelle je suis également intervenu au titre d’ancien de la formation à Brno (International summer school of museology), a clôturé la journée.
François Mairesse, membre d'ICOM France et ancien président d'ICOFOM
SITEM - 28 au 30 mars / Carrousel du Louvre
Le SITEM, salon international des musées des lieux de culture et de tourisme revient au Carrousel du Louvre pour sa 27ème édition du 28 au 30 mars prochain !
Sous le signe de l’innovation, cette édition sera marquée par de nombreuses nouveautés : des partenaires inédits accompagnés par près de 150 exposants, dont plus de 60 nouvelles entreprises et institutions venues de France, Suisse, Belgique, Canada, Grèce, Pays-Bas, Italie et des Etats-Unis vous présenteront en avant-première leurs nouveaux produits et actualités, dans un salon plus grand autour d’une programmation actuelle et diversifiée. En tout 17 ateliers et 15 conférences vous seront proposés lors de ces 3 journées. Les ateliers mettront en avant les dernières collaborations remarquables d’institutions culturelles et d’entreprises innovantes, et les conférences exploreront trois thématiques fortes : éco-responsabilité, diversité & inclusion, les nouvelles voies du digital.
En 2023, le salon se tiendra les 28, 29 et 30 mars au Carrousel du Louvre.
ICOM France aura le plaisir de vous accueillir sur son stand C22 - Hall Gabriel.
Si vous souhaitez obtenir une invitation gratuite, merci de nous contacter : musees.icomfrance@gmail.com

Un nouvel espace immersif proposant en libre accès plusieurs médiations numériques en réalité virtuelle, mixte ou augmentée investira plus de 100 m2 du Carrousel, et un espace start-up sera dédié aux jeunes entreprises et à l’innovation culturelle. Vous trouverez également des nouveaux espaces : le business lounge, l’espace Carrière, et un restaurant 100 % bio !
Toutes et tous sont également convié·es aux nouvelles éditions de Musé(E)mportables (festival composé de vidéos de 3 minutes prises avec son téléphone portable pour sujet exclusif le musée), et de Start-Up Contest (un concours primant deux start-ups exposantes ayant pour but de commercialiser un produit ou un service visant à renforcer l’attractivité des sites ou des territoires culturels et touristiques.) !
Musé(E)mportable Start-Up-Contest
La Nuit de l’innovation culturelle le mercredi 29 mars permettra quant à elle de se rassembler dans une ambiance conviviale propice aux échanges de 19h00 à 22h00.
Une application web et mobile sera également mise à disposition de tous les visiteurs et exposants, afin de faciliter les échanges et la mise en relation.
SITEM - 27ème édition
Le SITEM, salon international des musées des lieux de culture et de tourisme revient au Carrousel du Louvre pour sa 27ème édition du 28 au 30 mars prochain !
Sous le signe de l’innovation, cette édition sera marquée par de nombreuses nouveautés : des partenaires inédits accompagnés par près de 150 exposants, dont plus de 60 nouvelles entreprises et institutions venues de France, Suisse, Belgique, Canada, Grèce, Pays-Bas, Italie et des Etats-Unis vous présenteront en avant-première leurs nouveaux produits et actualités, dans un salon plus grand autour d’une programmation actuelle et diversifiée. En tout 17 ateliers et 15 conférences vous seront proposés lors de ces 3 journées. Les ateliers mettront en avant les dernières collaborations remarquables d’institutions culturelles et d’entreprises innovantes, et les conférences exploreront trois thématiques fortes : éco-responsabilité, diversité & inclusion, les nouvelles voies du digital.
En 2023, le salon se tiendra les 28, 29 et 30 mars au Carrousel du Louvre.
ICOM France a le plaisir de faire partie des partenaires et de vous accueillir sur son stand C22 - Hall Gabriel.
Si vous souhaitez obtenir une invitation gratuite, merci de nous contacter : musees.icomfrance@gmail.com

NEMO - Nouvelles de nos membres
NEMO accueille vos soumissions pour la page "News from our members" jusqu'au jeudi 16 mars. Toutes les contributions sont publiées en ligne, et trois d'entre elles seront publiées dans le bulletin d'information.
Veuillez noter que NEMO a revu le type de soumissions publié en ligne et qu'ils ont décidé de ne plus accepter de contributions sur les expositions. Ils accepteront toujours les contributions sur les expositions en ligne et les expositions avec une valeur ajoutée supplémentaire, comme un rapport ou autre. Cette décision a été prise parce que la plupart des abonnés à la newsletter et des visiteurs du site web ne peuvent pas visiter ces expositions et parce que NEMO ne fait pas office de calendrier des expositions.
Veuillez soumettre les informations ci-dessous à : thonander@ne-mo.org :
nom de votre institution
titre de l'événement/de la contribution
date (si disponible)
ville/ lieu
courte description (environ 50 mots en texte cohérent)
un lien pour de plus amples informations
Par exemple :
Réseau des organisations européennes de musées
Conférence européenne des musées NEMO 2023
19-21 novembre 2023
Lahti, Finlande
... courte description (environ 50 mots) ...
Rencontre annuelle du CLIC
Bienvenue à la Rencontre annuelle du CLIC, le vendredi 31 mars 2023
Comme vous le savez déjà, le vendredi 31 mars 2023, la journée annuelle du CLIC revient à la Cité des Sciences.
Cette rencontre prolongera les 3 journées du SITEM et s'inscrit dans le cadre de l'Année de l'innovation
PRE-PROGRAMME DE LA JOURNEE
09.45-11.00 Table ronde 1: « Les musées et monuments sont-ils condamnés à innover pour survivre ? »
Avec 4 directeurs de musée : Bruno Girveau, Directeur, Palais des Beaux-Arts de Lille ; Xavier Roland, Directeur, Pôle muséal de Mons, Belgique ; Philippe Guillet, Directeur, Muséum de la Métropole de Nantes et Ana-Laura Baz, Directrice de l’innovation, Musée de la civilisation, Québec.
11.00 – 12.15 Table ronde 2: « L’immersion et le multisensoriel, nouveau graal des musées et lieux culturels ? »
Avec Florence Blond, Directrice Projets et Expositions, Nausicaa; Fanny Servole, Directrice des Publics, Cité de l’Architecture et du Patrimoine; Annie Berube, Chargée de mission, projets
12.15 « Quinze Minutes avec …. » un grand témoin
12.30 – 14.15 Déjeuner avec démo d’expériences innovantes
14.30 « Quinze Minutes avec …. » un grand témoin
14.45 – 16.00 Table ronde 3: « Quand le lieu culturel se rapproche de ses voisins ! »
Avec Annabelle Ténèze, Directrice, les Abattoirs, Musée - FRAC Occitanie Toulouse et un représentant d’un musée d’art et d’un centre de science.
16.00 – 17.15 Table ronde 4: « Mécénat, paiement par le public, coproduction et fonds publics : quel financement pour les nouvelles expériences numériques ? »
Avec Agnès Parent, Directrice des publics, Museum National d’Histoires Naturelles, MNHN; Abla Benmiloud Faucher, Chef de mission de la stratégie, de la prospective et du numérique, Centre des monuments nationaux, et le représentant d’un musée d’art.
17.15 – 17.30 « Quinze Minutes avec …. » un grand témoin
Le programme complet sera publié le 8 mars 2023
Les inscriptions sont ouvertes en ligne
Très bonne fin de semaine et bonne lecture !
Un an de soutien aux musées ukrainiens et à leurs professionnels
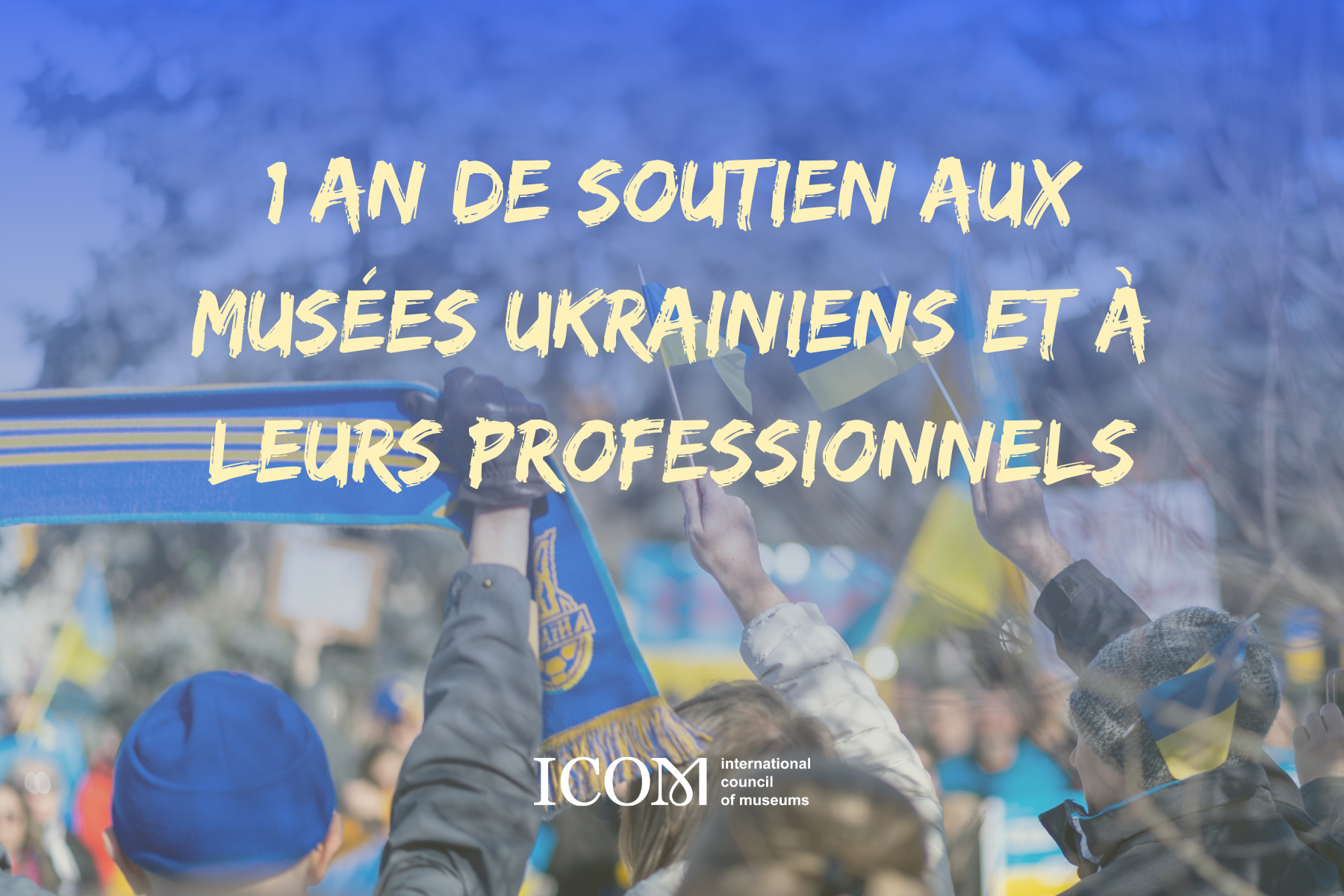
Un an de soutien aux musées ukrainiens et à leurs professionnels
A l’occasion du premier anniversaire de l’invasion des forces russes en Ukraine, l’ICOM condamne les pertes de vies humaines et les dommages infligés au patrimoine culturel qui ont été causés par les agressions de la Russie et exprime son fort soutien aux collègues des musées ukrainiens et à leurs efforts dans ces circonstances extrêmement difficiles.
Au cours de l’année écoulée, le réseau de l’ICOM s’est réuni pour promouvoir et soutenir la sûreté et la sécurité des professionnels des musées et du patrimoine culturel en Ukraine. Alors que de nombreux sites culturels à travers l’Ukraine ont été – et continuent d’être – mis en danger et endommagés, il est important de réfléchir et de se souvenir de ce que le réseau ICOM a réalisé ensemble, et de continuer à promouvoir et à soutenir la sûreté et la sécurité des membres de l’ICOM, du personnel de musées et du patrimoine culturel à travers l’Ukraine.
Comités nationaux, réseaux internationaux
Le 24 février 2022, le jour de l’invasion des forces russes en Ukraine, l’ICOM a publié une déclaration officielle condamnant la destruction et les menaces qui pèsent sur le patrimoine culturel en Ukraine, et appelant les parties prenantes concernées à soutenir les musées et les professionnels de musées. Dans une deuxième déclaration publiée le 9 mars 2022, l’ICOM a rappelé le rôle des musées, de la culture et de la coopération internationale dans la construction d’une paix durable entre les nations. L’ICOM réitère son attente que tous les pays de la région respectent leurs obligations en vertu des conventions internationales, en particulier la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, dont ils sont États parties. Les obligations exprimées dans cette déclaration restent d’actualité et l’ICOM préconise vivement le respect des obligations éthiques et juridiques prévues par le droit international et continue à encourager le soutien international aux professionnels des musées et aux collections en Ukraine.
Le réseau de l’ICOM et les collègues ukrainiens se sont mobilisés efficacement et le soutien international est arrivé rapidement pendant les premières semaines de l’invasion. Afin de soutenir ces efforts, le secrétariat de l’ICOM a consacré ses efforts à fournir un soutien actif et immédiat aux musées et professionnels ukrainiens pendant les attaques et est resté en contact étroit avec les membres à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ukraine afin de comprendre quel soutien les autres musées et professionnels de musées ailleurs dans le réseau de l’ICOM pouvaient offrir à leurs collègues ukrainiens. Dans une volonté d’aider à rationaliser et cibler les efforts, ICOM France a organisé un séminaire en ligne très suivi Situation actuelle des musées ukrainiens : Initiatives déjà prises | Besoins et actions futures (6 avril 2022), au cours duquel des représentants du Secrétariat de l’ICOM et des comités nationaux membres de toute l’Europe ont discuté et passé en revue les initiatives. L’importance de telles réunions de coordination et le pouvoir de la collaboration internationale ont été démontrés lorsqu’ICOM Allemagne, ICOM France ainsi qu’ICOM Autriche et ICOM Suisse ont tous réussi à mobiliser leurs musées pour envoyer des camions contenant des matériaux d’emballage donnés à l’Ukraine par des musées et des institutions de leurs pays respectifs. Ce matériel comprenait des boîtes et des caisses de rangement, du matériel d’emballage pour les archives et des extincteurs, entre autres, et a été distribué entre Lviv et Odessa.

Un soutien financier du fonds d’urgence de l’ICOM a également été accordé à ICOM Pologne (qui a également lancé un appel à soutien) afin d’établir un bureau parlant ukrainien et de commencer à localiser les professionnels de musées ukrainiens afin de les aider. L’ICOM Lettonie a également travaillé au renforcement de la coopération entre les musées lettons et les professionnels de musées ukrainiens.
Afin de promouvoir davantage la coordination et la collaboration internationales, l’ICOM a également soutenu l’appel du Réseau des organisations européennes de musées (NEMO) pour collecter et suivre les activités de soutien aux musées ukrainiens. En effet, le soutien de la communauté muséale aux collègues ukrainiens a été large et diversifié. Il a pris la forme de dons, d’offres d’envoi de matériel et d’équipement, d’emplois temporaires et de logements pour les collègues ukrainiens, et de stockage d’urgence en cas d’évacuation hors d’Ukraine. L’initiative de NEMO a été particulièrement bien accueillie car elle a donné une grande visibilité aux nombreuses actions de la communauté des musées.
Ces exemples de collaboration démontrent non seulement la mobilisation efficace de la communauté mondiale des musées en solidarité avec l’Ukraine pour protéger son patrimoine culturel, mais aussi la manière dont le réseau de l’ICOM, en particulier, peut apporter un soutien rapide, efficace et important à ses collègues et aux musées du monde entier. Le Secrétariat de l’ICOM continuera à soutenir des activités telles que celles-ci, et agit comme un canal pour ses membres vers d’autres acteurs et organisations internationales qui peuvent offrir un soutien.
Recueillir l’expertise et coordonner la collaboration internationale
Le soutien massif de la communauté internationale des musées à l’égard de leurs collègues ukrainiens s’est également traduit par un partage des connaissances. Le secrétariat de l’ICOM s’est efforcé de coordonner et de diffuser efficacement l’expertise offerte par le vaste réseau de l’ICOM. Une session consacrée aux “Réponses à la protection du patrimoine en Ukraine” a été présentée à la 26ème Conférence générale de l’ICOM à Prague le 21 août 2022. Le thème de la conférence, “Le pouvoir des musées”, a été mis en avant lors de cette session, qui a été largement suivie par des professionnels internationaux des musées, en ligne et en personne (la salle à Prague était pleine !).
Un soutien financier du fonds d’urgence de l’ICOM a également été accordé à ICOM Pologne (qui a également lancé un appel à soutien) afin d’établir un bureau parlant ukrainien et de commencer à localiser les professionnels de musées ukrainiens afin de les aider. L’ICOM Lettonie a également travaillé au renforcement de la coopération entre les musées lettons et les professionnels de musées ukrainiens.
Afin de promouvoir davantage la coordination et la collaboration internationales, l’ICOM a également soutenu l’appel du Réseau des organisations européennes de musées (NEMO) pour collecter et suivre les activités de soutien aux musées ukrainiens. En effet, le soutien de la communauté muséale aux collègues ukrainiens a été large et diversifié. Il a pris la forme de dons, d’offres d’envoi de matériel et d’équipement, d’emplois temporaires et de logements pour les collègues ukrainiens, et de stockage d’urgence en cas d’évacuation hors d’Ukraine. L’initiative de NEMO a été particulièrement bien accueillie car elle a donné une grande visibilité aux nombreuses actions de la communauté des musées.
Ces exemples de collaboration démontrent non seulement la mobilisation efficace de la communauté mondiale des musées en solidarité avec l’Ukraine pour protéger son patrimoine culturel, mais aussi la manière dont le réseau de l’ICOM, en particulier, peut apporter un soutien rapide, efficace et important à ses collègues et aux musées du monde entier. Le Secrétariat de l’ICOM continuera à soutenir des activités telles que celles-ci, et agit comme un canal pour ses membres vers d’autres acteurs et organisations internationales qui peuvent offrir un soutien.
Recueillir l’expertise et coordonner la collaboration internationale
Le soutien massif de la communauté internationale des musées à l’égard de leurs collègues ukrainiens s’est également traduit par un partage des connaissances. Le secrétariat de l’ICOM s’est efforcé de coordonner et de diffuser efficacement l’expertise offerte par le vaste réseau de l’ICOM. Une session consacrée aux “Réponses à la protection du patrimoine en Ukraine” a été présentée à la 26ème Conférence générale de l’ICOM à Prague le 21 août 2022. Le thème de la conférence, “Le pouvoir des musées”, a été mis en avant lors de cette session, qui a été largement suivie par des professionnels internationaux des musées, en ligne et en personne (la salle à Prague était pleine !).
Liste rouge d’urgence de l’ICOM – Ukraine
En avril 2022, ICOM Ukraine a exprimé son intérêt pour la préparation d’une Liste rouge d’urgence, et le 24 novembre 2022, l’ICOM a lancé la très attendue Liste rouge d’urgence – Ukraine. Réalisés en un temps record, ICOM Ukraine et le département de la protection du patrimoine ont travaillé main dans la main avec des experts de 11 musées à travers l’Ukraine pour produire une liste complète qui restera un outil précieux dans la lutte contre le pillage et le trafic d’objets culturels en Ukraine. La liste a été bien accueillie par les universitaires, les professionnels des musées, les forces de l’ordre, les gouvernements et les particuliers, et l’ICOM continue de promouvoir activement la liste et de travailler à sa diffusion. Afin d’aider la lutte mondiale pour la protection du patrimoine culturel ukrainien, en particulier au moment où les objets culturels pillés commencent à circuler, la Liste rouge est actuellement en cours de traduction en ukrainien et en suédois (cette dernière étant généreusement financée par les Varldskulturmuseerna suédois (Musées nationaux de la culture mondiale), et ces versions seront publiées prochainement, à la fois sur papier et en ligne.
Il est important de maintenir l’élan et de continuer à amplifier et diffuser les informations que cette Liste rouge d’urgence rassemble. Ainsi, l’ICOM, ses membres, les journalistes et les universitaires continuent de faire circuler la Liste rouge d’urgence, qui a jusqu’à présent été présentée par de nombreux médias, dont The Art Newspaper, Heraldo, El Diaro, Le Quotidien de l‘Art, France Info Culture, et plus récemment, Beaux Arts (janvier 2023). Le compte Twitter de l’Observatoire du trafic illicite des biens culturels est régulièrement mis à jour avec des nouvelles sur la réception et la diffusion de la Liste rouge d’urgence, ainsi que d’autres nouvelles pertinentes pour la situation des musées et des collections en Ukraine.
En août 2022, le Comité d’examen des allocations stratégiques (SAREC) de l’ICOM a lancé un appel à projets spécial destiné à soutenir les musées et les professionnels des musées en Ukraine. Après une évaluation minutieuse, six projets ont été sélectionnés pour un financement de l’ICOM :
- Numérisation des documents d’archives de la Réserve nationale “Kyiv-Pechersk Lavra” par ICOM UK, en partenariat avec ICOM Ukraine, la Réserve nationale “Kyiv-Pechersk Lavra” et l’Université de l’Ouest de l’Angleterre.
- Building Resilient Museums and Communities par le Comité international de l’ICOM sur la gestion des risques de catastrophes (DRMC), en partenariat avec la Coalition internationale des sites de conscience, l’ICOM Ukraine, l’ICOM Canada et l’initiative Heritage Emergency Response Ukraine.
- Musées ukrainiens en danger – Un plan de solution en 3 étapes : connaissance, pratique et visibilité par ICOM Allemagne, en partenariat avec ICOM Suisse et OBMIN.
- Intégrer et renforcer les communautés du patrimoine ukrainien en Géorgie grâce à des opportunités d’emploi et à une campagne de sensibilisation menée par l’ICOM Géorgie, en partenariat avec l’ICOM Ukraine, le Bouclier bleu de Géorgie, le Musée national de la révolution de la dignité – HERI, le Musée national de la soie et l’Association géorgienne de l’artisanat du patrimoine.
- Enregistrement et conception de la méthodologie de préservation de l’histoire de la vie et des activités du musée pendant la guerre totale russe contre l’Ukraine sur l’exemple du musée Khanenko par ICOM Ukraine, en partenariat avec Mir & Co Production
- Les musées de Balakliia et Izyum : évacuation, protection, récupération par ICOM Ukraine, en partenariat avec l’ONG Azov Development et le département de la culture de l’administration régionale de Kharkiv
LE RÔLE DES MUSÉES, DE LA CULTURE ET DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DANS LA CONSTRUCTION D’UNE PAIX DURABLE
Alors que le conflit entre tristement dans sa deuxième année, l’ICOM souhaite rappeler une fois de plus le rôle des musées, de la culture et de la coopération internationale dans la construction d’une paix durable. Dans cette optique, l’ICOM continue d’amplifier les appels au soutien et de coordonner les efforts internationaux pour aider les collègues des musées en Ukraine. Il exhorte la communauté mondiale des musées à se joindre aux efforts de protection du patrimoine et à défendre la culture comme moyen de construire une paix durable. Le réseau de l’ICOM a démontré sa solidarité envers le peuple ukrainien, ainsi que sa capacité à réagir rapidement, en fournissant une assistance professionnelle aux professionnels dans le besoin.
N’hésitez pas à prendre contact avec le Département de la protection du patrimoine au Secrétariat de l’ICOM si vous souhaitez informer le Secrétariat de l’ICOM de toute contribution du réseau ICOM aux efforts de solidarité pour l’Ukraine.
Conditions climatiques des musées
CRISE ÉNERGÉTIQUE ET NOUVELLE PLATEFORME «CONDITIONS CLIMATIQUES DES MUSÉES»
Dans le contexte de la crise énergétique, ICOM Suisse lance la nouvelle plateforme «Conditions climatiques des musées» dans le but d'encourager les échanges entre les professionnel-le-s des musées et d'obtenir de meilleures données sur la gestion d’une plage climatique. Parallèlement, l'AMS et ICOM Suisse sont en contact étroit avec les autorités afin d'attirer l'attention sur la situation des musées dans le cadre de la crise énergétique.

NOUVELLE PLATEFORME «CONDITIONS CLIMATIQUES DES MUSÉES»
En raison de la crise énergétique, l'Association allemande des musées (Deutsche Museumsbund) a publié de nouvelles recommandations pour la régulation climatique dans les musées. ICOM Suisse et l'AMS les reprennent en complément des recommandations existantes d'ICOM Allemagne, contenues dans la publication «Conservation préventive» (six critères pour la détermination des valeurs prescrites selon A. Burmester).
ICOM Suisse et l'AMS sont convaincus que la formulation d'exigences spécifiques aux matériaux en fonction des conditions climatiques, le suivi et l'évaluation des modifications des paramètres climatiques existants nécessitent un échange interdisciplinaire entre spécialistes. C'est dans ce but qu'a été créée la plateforme «Conditions climatiques des musées», qui encourage l'échange interdisciplinaire entre les expert-e-s les plus divers, tels que les technicien-ne-s en climatisation, les restaurateurs/trices, les conservateurs/trices, les architectes, les gestionnaires d'installations, les planificateurs/trices, etc. La direction du contenu est assurée par Nathalie Bäschlin, restauratrice en cheffe du Kunstmuseum de Berne et membre du comité d'ICOM Suisse, le secrétariat général de l'AMS et d'ICOM Suisse se chargeant de la coordination organisationnelle.
La plateforme et la suite des opérations ont été présentées et discutées ensemble lors du lancement du 15 décembre 2022. Les personnes qui souhaitent rejoindre le groupe d'envoi de la plateforme «Conditions climatiques des musées» sont priées de nous contacter à info@museums.ch.
Événement zoom du 27 avril 2023, 10h-12h, sur le thème de la stratégie de mesure du climat
L'objectif est de développer une meilleure pratique commune : comment les conditions climatiques sont-elles réellement mesurées dans les différents établissements ? Comment parvenir à la transparence, de sorte que les institutions puissent également se soutenir mutuellement dans la question de savoir comment garantir des conditions optimales ? Différents exemples pratiques seront présentés, sur la base desquels les exigences minimales en matière de mesures climatiques seront ensuite discutées. La séance sera traduite simultanément en allemand et en français. Nous vous prions de vous inscrire jusqu'au 15 avril 2023 au plus tard à info(at)museums.ch. Vous recevrez le lien zoom à l'avance.
Fiches d'information, recommandations et autres informations:
- Consultation sur les mesures à prendre en cas de pénurie d'électricité: prise de position d'ICOM Suisse et de l'AMS, 12 décembre 2022 [PDF en allemand]
- Recommandations de l'AMS face à la crise énergétique, 29 août 2022 [PDF]
- Recommandation sur les mesures d'économie d'énergie de la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie [PDF, en allemand]
- Matériel d'information de la Confédération
- Informations d'OSTRAL (Organisation pour l’approvisionnement en électricité en cas de crise)
Le prix du musée européen de l'année (EMYA)
La conférence annuelle et la cérémonie de remise des prix de l'EMYA 2023 auront lieu à Barcelone, du 3 au 6 mai 2023. Organisée par le Forum européen du musée et accueillie par MUHBA - Museu Historia de Barcelona
Le European Museum of the Year Award (EMYA) est ouvert aux musées qui ont été récemment ouverts ou qui ont fait l'objet de rénovations importantes au cours des trois dernières années (2019–2022). L'un des objectifs du concours est d'évaluer l'attrait des musées participants pour le public et d'améliorer ainsi la qualité du paysage muséal européen. Le prix est décerné dans le cadre de la conférence annuelle de trois jours de l'European Museum Forum. La conférence favorise le contact et le réseautage entre les professionnel-le-s des musées qui y participent grâce à des manifestations parallèles et des ateliers.
Prix du musée européen de l'année
Le prix du Musée européen de l'année et la série de prix connexes sont décernés chaque année lors de la conférence annuelle et de la cérémonie de remise des prix.
Le processus rigoureux d'évaluation, qui comprend la visite de 60 musées, aboutit à une conférence annuelle à laquelle participent 250 à 300 grands professionnels des musées. Les candidats y présentent leurs musées, les lauréats sont annoncés et les valeurs sous-jacentes et les idées novatrices dans le domaine des musées européens sont discutées, renouvelées et réinterprétées.
Forte des 40 années de traditions et de connaissances accumulées par l'EMYA sur les besoins de la société et de la communauté qui motivent, créent, développent et soutiennent les musées en tant qu'espaces civiques cruciaux pour l'exploration du patrimoine européen, la conférence sert de référence permanente pour l'innovation et les meilleures pratiques dans le secteur.
Les différents prix décernés dans le cadre de l'EMYA reflètent, représentent et soulignent différents aspects et dimensions de ces valeurs. Les deux principaux prix, l'EMYA et le Prix du Musée du Conseil de l'Europe, sont décernés sans interruption depuis 1977. Le système de prix EMYA répond aux changements sociétaux à long terme ainsi qu'aux questions sociales urgentes actuelles, et reflète les défis, les obligations et les opportunités auxquels les musées sont confrontés au 21e siècle.
Les prix EMYA encadrent et intègrent les qualités professionnelles dans un ensemble de valeurs sociales, humanitaires et durables. Le processus d'évaluation très structuré ancre fermement l'évaluation de la qualité dans l'expérience muséale réelle, spécifique et concrète de chaque candidat aux prix et garantit la capacité de discerner la qualité professionnelle, l'innovation et la créativité à travers les grandes différences de traditions, de contextes et d'obligations, de types de musées, d'échelles et de sources et d'importance du financement.
Forum européen du musée
L'EMYA a été fondée en 1977 sur les principes de soutien, d'encouragement, de récompense et de présentation de l'excellence et de l'innovation dans le domaine des musées, en particulier dans les domaines conceptualisés par Kenneth Hudson comme la "qualité publique". Le Forum européen du musée (FEM) fournit le cadre juridique et organisationnel pour le programme annuel du Prix du musée européen de l'année (EMYA).
Le FEM/EMYA se consacre à la promotion de l'excellence en matière d'innovation et de qualité publique dans la pratique muséale, en encourageant la mise en réseau et l'échange d'idées et de bonnes pratiques durables au sein du secteur. La FEM/EMYA s'inscrit dans un cadre général d'engagement en faveur de la citoyenneté, de la démocratie et des droits de l'homme, de la durabilité et du rapprochement des cultures et des frontières sociales et politiques.
Retrouvez la liste des nominés ici
Conférence annuelle du Comité international COSTUME
Le thème de la conférence annuelle 2023 du comité international COSTUME est "Toutes les couleurs du noir".
Le noir n'est pas, techniquement, considéré comme une couleur ; scientifiquement, il représente l'absence ou l'absorption complète de la lumière visible. Pourtant le noir est un élément récurrent de la palette de couleurs et du langage de la mode.
Il est à la fois la couleur de l'amour et de l'amitié. Il est à la fois la couleur de la protestation, du deuil et de la mélancolie ; il est sinistre - associé à la nuit, à la mort, au péché et au mal.
Il est à la fois sérieux, inspirant le respect, la diligence et l'humilité comme lorsqu'il est porté par les religieux, et rebelle comme dans le style des sous-cultures punk et gothique. Le noir est à la fois sophistiqué et chargé d'érotisme ; il est à la fois pieux et pervers.
Les significations paradoxales du noir ont une longue histoire dans l'habillement et le textile. Il s'agit d'une couleur difficile à obtenir et son apparition dans les vêtements était autrefois synonyme de grande richesse.
Elle a d'abord été popularisée dans les cours d'Europe de Philippe le Bon, duc de Bourgogne (1396-1467) en deuil de son père après 1419, à l'empereur d'Espagne Charles Quint (1500-1558) et à Catherine de Médicis (1519-1589), reine consort d'Henri II de France (1519-1589).
Le symbolisme du noir va bien au-delà des tendances vestimentaires. Dans l'Égypte ancienne par exemple, comme dans d'autres régions d'Afrique et d'Asie, le noir symbolisait à la fois la vie et la mort.
Elle est décrite par le célèbre professeur historien des couleurs, Michel Pastoureau, comme la "couleur des entrailles de la terre et du monde souterrain".
Son interprétation dans l'habillement, le textile et la mode souligne donc à quel point notre relation aux vêtements est profondément personnelle, liée à notre matérialité politique, économique et culturelle.
Les communications sur les thèmes suivants seront particulièrement bienvenues, mais la soumission est ouverte à tous les sujets de recherche concernant le reflet de l'utilisation du noir à travers l'histoire, le développement des nouvelles technologies, l'influence des mouvements artistiques, des événements sociaux ou politiques et de l'évolution des goûts :
- Connotations religieuses et spirituelles du noir
- Symbolisme culturel varié du noir
- Le processus et les défis de la création de teintures noires
- Les associations genrées du noir dans la mode
- Le noir en relation avec le dandysme - dans un contexte aussi large que le dandy du 19e siècle, le dandy noir ou le dandy féminin.
- Le noir comme couleur de protestation
- Le rôle du noir dans l'histoire du style sous-culturel
- La tenue de deuil et/ou l'étiquette du port du noir pour observer les rites funéraires
- Le rôle des cours royales dans la popularisation du noir dans la mode
Les présentations doivent durer de 15 à 20 minutes et être faites de préférence en anglais (mais toute autre langue officielle de l'ICOM - français et espagnol est acceptée).
Les résumés d'environ 300 mots doivent être soumis avant le 17 avril 2023 à
chair.costume@icom.museum et doivent contenir les informations suivantes :
- Nom
- Affiliation (avec le numéro de membre de l'ICOM pour les membres de l'ICOM)
- Adresse électronique
- Titre et corps du résumé
- Toute exigence technologique particulière (par exemple un Mac ou un PC pour accompagner les images, la vidéo).
Les résumés et les présentations seront rédigés en anglais (ou dans toute autre langue officielle de l'ICOM, le français et l'espagnol).
Comme il n'y aura pas de traduction, veuillez vous assurer que votre présentation sera facile à suivre pour un public international.
Les conférences seront retransmises en direct, mais il ne sera pas possible d'intervenir à distance.
L'acceptation des communications sera notifiée à la fin du mois de mai 2023.



