
Recherche
Résultats de la recherche
2299 résultats trouvés
Ars Asiatica II – L’art asiatique dans la Bibliothèque d’art et d’archéologie : livres et estampes
Participant de l’engouement général pour les arts « asiatiques » à la fin du XIXe siècle, Jacques Doucet s’attacha à rassembler une collection de premier ordre dans ce domaine, grâce à un réseau de collaborateurs comme Victor Segalen, Paul Pelliot ou Édouard Chavannes.
Après la journée consacrée aux fonds photographiques, Ars Asiatica II complétera l’évaluation de l’« Extrême-Orient » dans la première bibliothèque d’Art et d’Archéologie pour comprendre les modalités de constitution de ce fonds ; identifier son apport à la constitution de l’« extrême-orientalisme » ; évaluer l’impact de la collection sur la pratique artistique contemporaine, notamment l’estampe.
Comité scientifique
Cristina Cramerotti (Musée national des arts asiatiques – Guimet), Jean-Pierre Drège (EPHE), Pauline Guyot (INHA), Cédric Laurent (université de Rennes 2), Christophe Marquet (EFEO), Manuela Moscatiello (musée Cernuschi)
Parmi les intervenantes et les intervenants
Sabrina Castandet Le Bris (Bibliothèque de l'Institut de France), Cristina Cramerotti (Musée Guimet), Ilaria della Monica (Villa i Tatti, The Harvard Center for Italian Renaissance Studies), Jean-Pierre Drège (EPHE), Frank Feltens (Smithsonian Institution, Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery), Laure Haberschill (Musée des Arts Décoratifs), Patrick Latour (Bibliothèque Mazarine), Cédric Laurent (université de Rennes 2), Soline Lau-Suchet (BULAC), Christophe Marquet (EFEO), Manuela Moscatiello (musée Cernuschi), Ellis Tinios (University of Leeds).
Programme de recherche
« La Bibliothèque d’art et d’archéologie de Jacques Doucet : corpus, savoirs et réseaux » (domaine Histoire et théorie de l’histoire de l’art et du patrimoine)
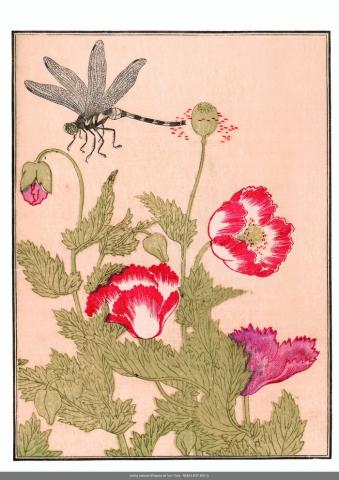
Enquête de l'ICOM international sur les collections de musées en réserve
En mars 2022, l'ICOM international a créé un Groupe de travail dédié aux collections en réserve suite aux décisions du Conseil d’administration de l'ICOM, aux recommandations du Conseil consultatif et à la résolution de la 34e Assemblée générale de l'ICOM à Kyoto.
La mission de ce groupe de travail est d'analyser la situation des collections en réserve dans les musées du monde entier, en coopération avec les comités nationaux et internationaux. Pour mieux comprendre la situation dans le monde, le groupe de travail a créé une enquête pour les musées sur les collections en réserve, dans le but d'utiliser les résultats pour organiser une conférence mondiale sur ce sujet.
Vous trouverez ci-dessous le lien vers cette enquête :
Pour que cette enquête reflète véritablement la réalité mondiale, nous comptons sur tous les membres de notre réseau mondial pour y répondre. Nous vous remercions d'avance pour vos contributions.
Emma Nardi, Présidente de l'ICOM
Journée Wikimedia et culture numérique 2023
L’open content plus que jamais à l’honneur !
Le mardi 25 avril 2023, l’association Wikimédia France organise la 4ème édition de la Journée Wikimedia Culture et numérique. Cette rencontre se déroulera à l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA), Paris 2e, grâce au soutien des Archives nationales et du Club Innovation & Culture CLIC.
Suite à une édition 2022 consacrée à la présentation du premier rapport sur l’open content, la Journée Wikimedia Culture et numérique 2023 présentera en exclusivité l’Observatoire de l’open content et ses futures missions, ainsi que les tout premiers lauréats du Label Culture Libre.
Cette journée sera aussi l’occasion de venir échanger avec des intervenant⋅e⋅s issus de différentes institutions culturelles sur la mise en place de projets liés à l’ouverture et la diffusion de documents et collections patrimoniales.
La journée tentera de répondre aux questions spécifiques largement partagées par les professionnels de la culture. Quelles licences choisir ? Comment identifier les ayants droit des numérisations d’œuvres et quels contrats choisir ? Comment insérer de tels projets dans les circuits administratifs ?
Les participant⋅e⋅s bénéficieront d’un panel d’intervenants qui s’inspireront de leur expérience pour répondre aux questions. Une opportunité rare pour placer l’open content au centre des débats sur les politiques culturelles.
Tarif "mobilité durable"
À compter du 4 avril 2023, dans le cadre de sa nouvelle grille tarifaire, Universcience, l’établissement public regroupant le Palais de la découverte et la Cité des sciences et de l’industrie, crée un tarif spécial “mobilité durable”.
Il permettra aux usagers de vélo ou d’un moyen de transport équivalent (trottinette, gyropode …) de bénéficier d’une réduction sur leur billet d’entrée (1 euro à la Cité des sciences et de l’industrie, 50 centimes aux Étincelles du Palais de la découverte).
Cette mesure incitative aux mobilités durables vient répondre au constat du poids critique des déplacements des visiteurs dans l’empreinte carbone des établissements culturels.
Elle se déploie au sein d’un plan d’ensemble mis en place par Universcience, incluant l’installation d’une calculatrice carbone sur sa billetterie pour sensibiliser ses visiteurs à l’impact de leurs moyens de transport, ainsi que des réductions grâce à des accords avec des opérateurs de mobilités douces :
- partenariat avec Vélib’ permettant aux visiteurs de l’établissement de bénéficier de 45 min de vélo pour 2,5 € au lieu de 3 € et aux utilisateurs de Vélib’ de profiter du tarif mobilité durable à la Cité des sciences et de l’industrie ;
- participation au programme Navigo Culture (Région Ile-de-France, Ile-de-France Mobilités et Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France) permettant aux détenteurs d’un pass Navigo de bénéficier du même tarif.
Ce plan en faveur de la décarbonation des déplacements de ses visiteurs s’inscrit dans l’engagement global d’Universcience pour la durabilité, un des piliers de son projet d’établissement.
Cet engagement se traduit également par une intégration de l’impératif de durabilité dans les méthodes de travail de l’établissement (réemploi des matériaux d’exposition, conception écoresponsable des espaces comme celui des Étincelles du Palais de la découverte …) et dans sa programmation, tout au long de l’année.
La Cité des sciences et de l’industrie présentera notamment à partir du 16 mai 2023 sa nouvelle exposition permanente intitulée Urgence climatique, consacrée au défi de la décarbonation, dont le commissaire scientifique est Jean Jouzel.
Conférence annuelle du Comité international CIDOC
Le thème de la conférence annuelle 2023 du comité international CIDOC est "Frontières de la connaissance. Musées, documentation et données connectées".
La conférence CIDOC 2023 abordera l'importance de construire et de transformer les frontières de la connaissance dans la documentation des musées et l'intégration numérique de leurs informations, afin de savoir à quels objectifs nous aspirons et où nous voulons aller. Nous comprenons ces frontières comme des limites qui obéissent à des positions culturelles, institutionnelles et académiques que nous devons constamment remettre en question et dépasser pour changer l'avenir de notre patrimoine culturel.
L'organisation et l'ouverture des connaissances sont des tâches importantes pour les musées et les diverses institutions du patrimoine culturel, directement liées à leurs pratiques de documentation. Cette organisation est réalisée à partir de différentes approches et objectifs de la gestion institutionnelle : administration, recherche, publication et diffusion, entre autres. Les objectifs visent généralement une meilleure identification du patrimoine, la génération d'inventaires et de catalogues pour sa conservation et son exposition, ainsi que des bases de données, des plateformes technologiques et des données ouvertes liées qui permettent sa diffusion, son utilisation et sa redistribution à des publics plus larges. Tous ces éléments constituent des frontières, des horizons académiques et institutionnels qui conduisent à des pratiques de documentation et à des résultats d'intégration des connaissances.
L'une des frontières les plus courantes est celle qui se concentre sur l'accès à l'information. Avec cet objectif, les développements technologiques de l'information se concentrent sur la publication de différents produits culturels afin de les intégrer dans le monde numérique ; la visibilité est ainsi privilégiée avec des modèles de données qui peuvent laisser de côté la complexité et l'hétérogénéité des sources produites par l'observation scientifique ou académique.
L'accès ne doit donc pas être notre seule frontière. Il en existe d'autres, liées à une meilleure expression de la richesse contextuelle et hétérogène de la documentation patrimoniale, à l'optimisation des processus de documentation, ainsi qu'à l'avancement du développement d'une meilleure infrastructure permettant la représentation adéquate de la connaissance. Il s'agit de créer des clés qui invitent ceux qui les utilisent à suivre l'origine des données et à amplifier le contenu généré par les organisations qui ont la responsabilité de conserver les biens culturels.
Ces frontières sont l'occasion de nous interroger sur les objectifs que nous nous fixons en matière de publication de contenus numériques et sur l'horizon qui nous reste à atteindre. En ce sens, nous invitons à un dialogue basé sur des questions telles que : quelles sont les frontières de la connaissance dans la documentation des biens patrimoniaux ? Quelles frontières avons-nous atteintes et quels nouveaux horizons pouvons-nous envisager ?
La conférence se tiendra à l'Universidad Nacional Autónoma de México du 24 au 28 septembre 2023.
Pour guider la conversation, nous proposons les thèmes suivants :
Les frontières de la connaissance:
- Stratégies visant à réduire la fracture numérique entre les pays, les institutions et les personnes
- Gestion institutionnelle et ouverture des connaissances : l'importance d'une approche globale entre la planification institutionnelle et l'ouverture des connaissances (science ouverte)
- Développement de technologies de l'information flexibles axées sur les biens du patrimoine culturel
- Collaboration pour le développement de thésaurus et de systèmes d'autorité.
- Application standard pour générer des données de qualité et leur mise en relation avec les communautés internationales.
Documentation muséale
- Documentation et enseignement dans les musées
- Décolonisation et documentation : les collections en ligne face aux débats culturels sur les relations de pouvoir
- Initiatives émergentes de documentation muséale
- Musées, documentation et attention au public : médiation entre disciplines et acteurs
- Vocabulaires contrôlés, interopérabilité et systèmes d'organisation des connaissances
- Nouvelles approches interdisciplinaires pour la recherche muséale
Normes, intégration et interopérabilité des connaissances
- Normes relatives au patrimoine culturel
- Préservation numérique
- Frontières technologiques dans la documentation du patrimoine culturel : plateformes de gestion, publication, utilisation de l'intelligence artificielle, etc.
- Collaboration ouverte et distribuée (crowdsourcing)
Conférence annuelle du Comité international DEMHIST
Le thème de la conférence annuelle 2023 du comité international DEMHIST est "Souvenirs des choses perdues : déclencher la mémoire de la maison historique par la perte et la récupération".
Cette conférence se concentre sur l'implication des musées privés (familiaux) ou publics dans la restauration et la sauvegarde de la mémoire qui a été perdue pour diverses raisons, notamment la guerre, la confiscation par l'État, les actions colonialistes, etc.
En tant que professionnels des musées, nous avons l'obligation morale d'examiner en profondeur et de mettre à jour les récits. On trouve de nombreux exemples de ces maisons en Serbie, dont certains seront présentés lors de la conférence à Belgrade. Toutes ces maisons représentent une couche distincte de l'histoire complexe des habitations historiques résultant des effets de la Seconde Guerre mondiale dans cette région du monde.
L'objectif principal de cette conférence est de montrer comment la gestion d'un patrimoine difficile et les défis liés à la protection du patrimoine (gestion des risques liés aux catastrophes naturelles ou d'origine humaine) peuvent conduire aux mêmes préoccupations en matière de mémoire perdue. Ces questions doivent être abordées non seulement dans le contexte de l'histoire européenne du milieu du XXe siècle, mais aussi dans le monde entier, dans les communautés ravagées par les actions colonialistes, comme les Maoris de Nouvelle-Zélande, les communautés du fleuve Sepik en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les communautés indigènes d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, d'Afrique subsaharienne et les Premières nations des Amériques.
Lorsqu'il s'agit de maintenir le feu du souvenir vivant et pertinent dans le présent, qu'est-ce qui caractérise les foyers historiques et traditionnels individuels à travers le monde, mais qui constitue également un facteur commun ? Quels sont les outils disponibles pour entretenir la flamme de la mémoire ? Comment les musées de maisons historiques peuvent-ils préserver l'histoire qui est encore inscrite dans les murs d'une maison, mais qui a été physiquement perdue ? L'inexistence physique du détenteur de la mémoire, c'est-à-dire de l'objet, est-elle si importante qu'elle ne peut être remplacée par un simple récit ou une copie ?
La mise en œuvre de techniques de déclenchement de la mémoire peut-elle nous aider, où que nous soyons dans le monde, à conserver des histoires vivantes même après avoir quitté une maison historique ? Qu'est-ce que nous choisissons de nous rappeler et qu'est-ce que nous décidons d'oublier ? On peut se demander si le souvenir choisi est toujours pertinent pour le public ou s'il aborde des questions de société. Le message de l'oubli, cependant, peut être plus crucial pour un examen attentif et peut contribuer à la guérison d'une communauté. Cela nous amène à la question suivante : comment conserver les souvenirs perdus et oubliés ?
Thèmes de l'appel à contribution
Thème 1 : Souvenirs perdus et retrouvés
Les conservateurs, les propriétaires et les gestionnaires de maisons historiques sont confrontés à l'absence de l'objet ou à la perte de mémoire de l'objet ou de la mémoire perdue. Lorsqu'il s'agit de protéger les maisons historiques dans le monde entier, nous utilisons en fait la méthodologie de Proust pour déclencher la mémoire individuelle et collective à travers les objets. En quoi l'utilisation de cette méthodologie nous aide-t-elle dans le processus de réinventer le récit de la maison historique ?
- Comment pouvons-nous conserver la mémoire de l'objet lorsque l'objet est manquant ou définitivement perdu ? Le pouvoir de la perte et donc de l'inconnu aujourd'hui, en le faisant connaître et en le rendant visible, sert d'outil pédagogique pour les jeunes publics.
- À la recherche des déclencheurs (oubliés) de la mémoire.
- Comment conserver la mémoire perdue ou présenter une histoire d'objets perdus ? Discuter de l'éthique derrière l'utilisation de répliques ou de pièces d'époque similaires. Si nous devons utiliser le substitut, comment le paradoxe de l'authenticité est-il traité ? Perdons-nous la possibilité de raconter l'histoire de quelque chose qui a été perdu en premier lieu ? Quelle perte de mémoire choisissons-nous de partager ? Pouvons-nous partager les deux récits et, si oui, comment ?
Thème 2 : Les maisons historiques comme déclencheurs de l'engagement communautaire
Comment maintenir à jour la mémoire préservée d'une maison historique, résoudre les problèmes de déconnexion et relier l'interprétation à des publics en constante évolution sont les principaux défis de la conservation d'une maison historique. Comment les conservateurs de musées de maisons publiques et les propriétaires familiaux privés peuvent-ils continuer à être pertinents tout en offrant la facilité d'accès à la maison historique ? (comme pendant le processus de reconstruction d'après-guerre) ?
- Collaboration avec la communauté locale en vue de sécuriser le récit de la mémoire partagée mais perdue de la maison historique.
- Façons de raconter une histoire pour évoquer la recherche de la mémoire personnelle (perdue) à la sortie de la maison historique.
- Remise en question de la mémoire actuelle conservée.
- La conservation de la mémoire difficile, oubliée et abandonnée.
Thème 3 : évolution des valeurs
Selon la nouvelle définition de musée de l'ICOM, qu'est-ce qui peut changer lorsque nous parlons d'une maison historique ? Les concepts d'inclusion, de participation communautaire et de durabilité sont pour la première fois reconnus dans le monde entier dans la définition du champ muséal. Comment les intégrer dans les maisons historiques ? Comment pouvons-nous utiliser e pouvoir du numérique et le pouvoir de la communauté (qu'il s'agisse de la communauté numérique ou de la communauté dans les environs de la maison historique) pour assurer une nouvelle couche de mémoire ?
L'évolution des valeurs due à un changement dans les récits de l'histoire publique peut libérer tout le potentiel d'interprétation des maisons historiques.
- Comment le visiteur contemporain peut-il bénéficier du changement potentiel de l'interprétation actuelle de la maison historique ?
- Comment la maison historique peut-elle contribuer à fournir des réponses actualisées aux problèmes de la communauté ?
- Le potentiel du numérique. Les musées et les particuliers adoptent l'environnement numérique, mais si la politique de libre accès a été mise en œuvre par les musées du monde entier, qu'en est-il réellement ? Que faisons-nous réellement de toute cette mémoire numérisée ?
- Le potentiel de conservation de la mémoire dans le domaine numérique au-delà de la collection numérisée de la maison historique.
- Le souvenir numérique - la mémoire partagée comme moyen de sécuriser la perte individuelle de la mémoire.
Conférence annuelle du comité international ICOFOM
"Augmenter la visibilité et l'attractivité du patrimoine des îles : un enjeu du 21e siècle pour la muséologie"
Conférence internationale organisée conjointement par l'ICOFOM (Comité international de muséologie, qui fait partie du Conseil international des musées), l'AMEPNC (Association des musées et institutions patrimoniales de Nouvelle-Calédonie) et l'Université de Nouvelle-Calédonie.
Les patrimoines insulaires sont, par nature, plus mobiles que ceux des espaces continentaux. Certes, les îles peuvent être des escales d'où l'on ramène des objets. Mais les sociétés insulaires, du fait de leur relatif isolement et de l'indisponibilité de certaines ressources, ont toujours eu besoin d'échanger des biens, des denrées, des matériaux et des objets fabriqués avec d'autres populations situées au-delà de la mer.
De l'ensemble culturel Lapita aux routes commerciales de la mer Egée, en passant par les relations précolombiennes entre les îles des Antilles, la kula des Trobriandais popularisée par Bronislaw Malinowski, ou encore le trafic maritime de l'époque contemporaine, l'espace océanique a été une voie d'échange et de circulation d'éléments matériels et immatériels. Ainsi, depuis l'Antiquité, les objets patrimoniaux et les savoirs ont circulé, se sont dispersés et ont quitté les îles, phénomène accentué depuis la multiplication des contacts, notamment avec le monde occidental.
L'importance des patrimoines insulaires repose donc - au moins partiellement - sur cette dispersion. Leur rareté doit également être prise en compte car les populations qui les ont créés étaient souvent peu nombreuses. Dans le Pacifique, en particulier, les archipels ont subi de plein fouet les chocs épidémiques liés au contact avec l'Occident, puis à l'évangélisation et aux politiques coloniales, qui sont à la fois responsables de la minimisation/négation de la culture insulaire et de l'accaparement du patrimoine culturel, la capture de ses artefacts les plus précieux, sacrés et reconnaissables. Avec le déplacement des patrimoines matériels, les connaissances et les patrimoines immatériels peuvent également avoir disparu.
Axes d'étude proposés
La question - dans un contexte muséologique - des patrimoines insulaires, qui s'étendent bien au-delà de l'océan Pacifique, permet d'explorer plusieurs axes qui peuvent être abordés dans les propositions de communication :
- Celui de la transmission : comment, pourquoi et par qui transmettre les savoirs, matériels et immatériels ? Comment faciliter l'implication des jeunes et leur éducation formelle ou informelle, quelle que soit leur communauté d'appartenance ? Quelles formes peut prendre transmission intergénérationnelle au sein de l'institution muséale ? Quelle peut être l'implication des acteurs du patrimoine et du public ?
- Numérique et promotion touristique : comment les outils numériques peuvent-ils être utilisés pour créer une médiation attrayante et inclusive dans un contexte global de post-pandémie, qui a mis en évidence à la fois les fractures numériques vécues par certaines populations ou communautés et la facilitation d'échanges à distance pour le reste du monde. L'accroissement de la visibilité du patrimoine insulaire n'est-il synonyme que de numérisation ? D'autres formes de visibilité peuvent-elles être privilégiées ?
Par ailleurs, la visibilité du patrimoine insulaire dépend-elle du bon fonctionnement du secteur touristique ? Quels sont les enjeux économiques de l'exercice de visibilité ?
- Comment mieux utiliser les spécificités océaniennes, dans une perspective de décolonisation de la muséologie ? Comment ces spécificités peuvent-elles contribuer à repenser l'exposition, voire la conservation, à travers une vision océanienne/insulaire/indigène du lien à l'objet ? L'insularité elle-même - puisque les îles et les archipels fonctionnaient comme des réseaux vivants d'échanges et de relations - peut-elle nourrir la réflexion sur le lien à l'objet ? Les perspectives océaniennes peuvent-elles trouver un écho dans les pratiques et les savoirs d'autres populations insulaires ou indigènes ?
- Comment le changement climatique - et les risques naturels - influencent-ils les décisions en matière de patrimoine, qu'il s'agisse de la préservation des sites, des opérations de conservation d'urgence ou de la sauvegarde du patrimoine immatériel, alors que certaines îles connaissent le déracinement et l'exode ? De quelle manière l'amélioration de la visibilité et de l'attractivité du patrimoine insulaire peut-elle contribuer à la valorisation du patrimoine de l'île ? Comment renforcer le "sens du lieu" pour toutes les générations, et intégrer la sagesse locale dans les pratiques de prise de décision pour un avenir durable ?
Les propositions de communication doivent être envoyées avant le 20 mai 2023 à l'adresse suivante : icofom.pacifique.2023@gmail.com.
Festival de la Muséologie
ICOM France est partenaire du prochain Festival de la Muséologie qui se tiendra le 09 et 10 juin 2023 au Campus Nation – Sorbonne Nouvelle.
Il s’agit d’une édition spéciale puisqu’elle a également pour objectif de célébrer les 5 années d’activités de l’association, fondée en septembre 2017. Il s’agit dans un premier temps de revenir sur le cœur même du travail et de l’ambition de Mêtis qui s’est construit autour d’un constat : le besoin de structurer le champ de la recherche en muséologie et de diffuser largement ses apports. Cette diffusion est entendue moins comme une vulgarisation (à destination du « grand public ») que comme la recherche constante des modalités optimales de circulation des savoirs entre acteurs du champ et, plus encore, l’interrogation de ces modalités. Il ne s’agit pas non plus de tenter de légitimer le métier de chercheur en lui trouvant une utilité sociale, un lien avec la société, mais de partir d’un état de fait : la muséologie est ancrée dans le terrain, et s’est constituée autour de l’institution muséale (Mairesse et Desvallées, 2005). Elle ne peut en être détachée : cela serait un non-sens. Fonctionnant comme une discipline carrefour, la muséologie s’est imposée comme un point de convergence pour toutes les recherches qui portent sur le musée. Pourtant, elle se construit dans un cadre disciplinaire pluriel : elle mobilise en effet des recherches en SIC, en histoire, en sciences de l’éducation, en sociologie, etc. (Gob, Drouguet et Chaumier, 2010, p. 19). Cela induit un éparpillement des ressources, des recherches et des chercheurs, dispersés dans une pluralité de laboratoires et équipes de recherche, et parfois isolés à l’intérieur de ceux-ci. Le besoin de s’interroger sur la façon de faire dialoguer les recherches et initiatives portant sur le musée est donc très clair.
FOCUS sur les tables rondes :
L’humour au musée :
avec Julien Giry, Ludovic Maggioni, Lucile Guittienne et Philippe Boisvert. Modération : Mathieu Viau-Courville
Le numérique :
avec Sébastien Appiotti, Omer Pesquer. Modération : Chang-Ming Peng
L’accessibilité :
avec Cindy Lebat, Maëlle Bobet et Raffaella Russo-Ricci. Modération : Viviana Gobbato
L’économie et les musées :
avec François Mairesse, Marie Ballarini, Pierre Bordas et Cyril Duchêne. Modération : Julie Besson
Le caring museum :
avec Eva Sandri, Guirec Zéo. Modération : Daniel Schmitt
L’environnement :
avec Mélanie Estevès, Servane Hardouin-Delorme et Aude Porcedda. Modération : Amandine Martin
ICOM Paraguay 2023 - Le leadership des musées en matière d'action climatique
Le thème de la conférence internationale organisée par ICOM Paraguay et quatre comités internationaux de l'ICOM est "Le leadership des musées en matière d'action climatique".
En collaboration avec l'ICMAH, ICTOP INTERCOM et MPR.
Cette conférence respectueuse de l'environnement se concentrera sur le site au Paraguay, en mettant l'accent sur la durabilité. Une présentation extraordinaire en ligne sera autorisée pour chacune des quatre sessions. Certaines parties du programme seront diffusées en direct et/ou enregistrées. Les affiches seront annoncées ultérieurement.
Appel à contribution - 30 mai 2023 :
Il y a deux formats de soumissions avec des critères différents : Les communications et les articles. Vous ne pouvez soumettre qu'un seul format.
Nous accueillons une diversité de soumissions qui informent le secteur sur ce qui est fait et ce qui doit être fait par les musées et les sites du patrimoine culturel en réponse aux défis de l'Anthropocène, l'ère géologique où l'activité humaine a commencé à avoir un impact significatif et négatif sur le climat et les écosystèmes de notre planète.
Les partenaires de la conférence invitent les membres de l'ICOM et les autres professionnels des musées à soumettre un résumé d'une contribution académique et professionnelle originale à l'étude et à la pratique du sujet de la conférence. Nous accueillons une diversité de soumissions qui peuvent informer le secteur sur ce qui est fait et ce qui doit être fait par les musées et les sites du patrimoine culturel en réponse aux défis de l'Anthropocène, l'époque géologique où l'activité humaine a commencé à avoir un impact significatif et négatif sur le climat et les écosystèmes de notre planète.
En tant que leaders du secteur des musées et du patrimoine culturel, il est de notre responsabilité d'être bien informés et proactifs en modélisant et en préconisant le passage à des solutions plus durables et respectueuses du climat pour nos musées, nos communautés et notre monde.
Quels types d'aptitudes et de compétences devons-nous acquérir ? Quel est le nouveau programme pour le secteur des musées au niveau universitaire et pour la formation continue ? Quelles nouvelles perspectives, politiques, pratiques et programmes devrions-nous adopter ? Comment inspirer et soutenir des solutions innovantes ? Comment éduquer et engager les donateurs, les partenaires, les communautés et les jeunes générations ? Comment pouvons-nous communiquer efficacement sur ce que nous faisons ? Comment savoir si et quand nous faisons la différence ?
Toutes les propositions soumises seront évaluées par un comité d'examen composé de représentants des organismes organisateurs afin de déterminer leur pertinence par rapport au thème de la conférence. Elles seront publiées avec un numéro ISBN, en anglais et en espagnol, sous la forme d'un livre électronique.
Retrouvez ici le sujet, les thèmes et le contenu de la conférence
Appel à contribution // Revue In situ
In Situ, appel à contributions : « La participation des citoyens et des bénévoles aux politiques des patrimoines »
Date limite d’envoi des propositions : 15 juin 2023
Coordination scientifique
Sylvie Le Clech, conservatrice générale du patrimoine, directrice adjointe des Archives diplomatiques, ministère des Affaires étrangères
Bruno Saunier, conservateur général du patrimoine, inspecteur des patrimoines – collège musées, ministère de la Culture, direction générale des Patrimoines et de l’Architecture
Simon Piéchaud, conservateur général honoraire du patrimoine
Pierre Pénicaud, conservateur général du patrimoine, inspecteur des patrimoines – collège musées & patrimoine scientifique, technique et naturel, ministère de la Culture, direction générale des Patrimoines et de l’Architecture
Appel à contributions
Une étude sur la participation citoyenne et le bénévolat aux politiques des patrimoines a été menée de septembre 2020 à décembre 2021 par quatre conservateurs généraux, inspecteurs des patrimoines. Elle a essentiellement consisté en des entretiens semi-directifs auprès de 250 acteurs du patrimoine, professionnels, bénévoles et participants, ainsi qu’auprès d’élus. Un colloque a ensuite été organisé au début de l’année 2022. Il a réuni, en distanciel et en présentiel, près de 400 inscrits, et a confirmé le diagnostic et les pistes d’actions ressortant de l’étude.
Il est rapidement apparu que la problématique de l’engagement des citoyens dans les politiques patrimoniales, qui prend de nombreuses formes, méritait un prolongement au-delà du diagnostic et des pistes d’actions proposées pour approfondir plusieurs questions :
1. Quelles légitimités scientifiques et politiques pour les différents acteurs des politiques patrimoniales, lorsque la participation des citoyens est introduite ?
2. Quelles limites peut-on ou doit-on poser lorsque cette participation est mise en place ?
3. Quels profils et quelle évolution pour les participants et les bénévoles ?
4. Comment sont-ils considérés par les professionnels ? Comment se perçoivent-ils eux-mêmes ?
5. Quelle place occupent-ils réellement dans les dispositifs participatifs et quelle place souhaitent-ils ?
6. Tous les champs patrimoniaux se prêtent-ils à la participation ?
7. Les formes de la participation sont-elles différentes suivant les champs ?
8. La participation dans le patrimoine culturel est-elle spécifique et se distingue-t-elle de celle observée dans d’autres politiques publiques ?
Les articles, qui pourront émaner de personnes engagées, soit à titre individuel soit à titre collectif (fédération, association, société savante), de membres du monde académique ou d’acteurs professionnels (responsables d’établissements culturels tels qu’archives, musées ou bibliothèques ou de services patrimoniaux de l’État ou de collectivités territoriales), devront donc aborder ces différentes questions. Les perspectives internationales seront les bienvenues pour élargir le sujet.
Nous proposons de regrouper les différentes questions ci-dessus en trois axes, mais des contributions sur de nouvelles thématiques pourront être proposées :
Axe 1 – De la consultation à la décision : jusqu’où aller dans la participation ?
Axe 2 – Qui sont les participants et les bénévoles ?
Axe 3 – Existe-t-il des différences entre les champs patrimoniaux ?
Axe 1 : De la consultation à la décision : jusqu'où aller dans la conservation ?
Autant la question de la participation de la société civile se pose depuis les origines de la démocratie, autant celle de ses limites se pose également. Simple consultation ou participation à la gestion d’un service ou d’un établissement ? Jusqu’où peut-elle aller ? Les différentes formes de participation pourront être interrogées.
Le bénévolat et la participation sont-ils admis par ceux qui détiennent légitimement le pouvoir et le savoir – élus, fonctionnaires, experts –, et ces groupes sont-ils prêts à cette coopération ? Jusqu’où sont-ils également prêts à partager pouvoir et savoir ? Sont-ils formés à cet exercice ? Quels sont les risques en matière scientifique et donc les limites de ce partage ? Telles sont les questions rencontrées.
Quelles légitimités scientifiques et politiques pour les différents acteurs des politiques patrimoniales lorsque l’on introduit la participation des citoyens ?
L'absence de formation
Un projet participatif peut-il être mis en place sans que se pose la question des compétences des participants ? À l’inverse, un projet participatif requiert-il des compétences particulières pour être mis en place et réussir ?
L’approche scientifique peut-elle aller jusqu’à la cogestion ?
Il existe de nombreux exemples de co-construction d’un programme de collecte ou de recherche dans un des champs patrimoniaux, d’un programme urbanistique ou architectural, de son élaboration jusqu’à sa réalisation. Les modes de travail sont-ils en train de changer et observe-t-on dans le domaine du patrimoine de nouvelles habitudes ?
Qu’en est-il, en revanche, de la cogestion d’un service ou d’un établissement patrimonial ? Elle semble supposer un type d’organisation particulier accordant une place à des acteurs autres que des élus ou des fonctionnaires. Mais lequel ?
La participation ne risque-t-elle pas de remettre en cause l’approche scientifique au profit du relativisme et du communautarisme ?
Parmi les freins évoqués par les différents interlocuteurs, la question d’une éventuelle remise en cause de l’approche scientifique du patrimoine est ressortie. Quelles formes peut-elle prendre ?
Quelles limites peut-on ou doit-on poser lorsque la participation est mise en place ?
Le temps et les moyens
La première limite observable à partir des comptes rendus d’entretiens de l’étude et à partir de la littérature est celle du manque de temps et de moyens à consacrer à l’encadrement de bénévoles et de participants. Cette limite est-elle toujours invoquée à juste titre ?
Les risques juridiques
Nombre de responsables d’établissements ou de services patrimoniaux invoquent les risques juridiques que ferait courir l’intervention de bénévoles et de participants dans le fonctionnement d’un service ou d’un établissement. Quelle serait leur responsabilité en cas de problème, ou quelle serait la responsabilité de la personne bénévole ou participant ? La question de la propriété intellectuelle des données produites ou des connaissances apportées est également récurrente.
Des réticences internes
L’un des points bloquants souvent mis en avant serait la réticence des personnels d’un service ou d’un établissement. Et cela quelle que soit leur taille. Cela irait de réticences personnelles d’un ou plusieurs agents jusqu’à des blocages exprimés via les organisations syndicales. L’histoire de l’institution ou de la discipline expliquerait parfois ces blocages.
Limites et risques semblent donc nombreux dans le long chemin du bénévolat et de la participation. Existent-ils vraiment ou résultent-ils davantage d’attitudes que de réels obstacles ?
Axe 2 : Qui sont les participants et les bénévoles?
La question du profil des bénévoles et celle du regard des professionnels et des politiques sont des considérations qui dépendent des secteurs patrimoniaux et de leurs degrés d’ouverture aux acteurs. La numérisation de la société en a marginalisé certains et mobilisé d’autres, tandis qu’une forme de judiciarisation impacte ce monde de l’engagement où volontaires, professionnels et politiques se rencontrent et agissent.
Quels profils et quelles évolutions?
Les bénévoles sont des acteurs de terrain dont la force est de disposer de temps, d’un profil socioprofessionnel adéquat ou d’une motivation particulière, mais favorable aux apprentissages. Les associations ont longtemps été le vivier du bénévolat, mais leur évolution, notamment le vieillissement des membres, nécessite d’en repenser la place dans des domaines patrimoniaux qui cultivent le travail en mode projet.
Comment sont-ils considérés et comment se perçoivent-ils?
Il s’agit donc de considérer le croisement des regards qui varient selon les attentes et les besoins. La volonté, l’émotion, le pragmatisme, les compétences et la légitimité sont les ingrédients d’un monde d’intérêts complémentaires qui n’exclut pas les contradictions voire les confrontations.
Quelle place occupent-ils et quelle place souhaitent-ils ?
La question des rapports réciproques suggère de considérer l’acceptation mutuelle qui a largement évolué et parfois changé selon les secteurs.
Axe 3 : Existe-t-il des différences entre les champs patrimoniaux?
Les axes précédents montrent bien que la participation et le bénévolat diffèrent d’un champ patrimonial à l’autre. Il est intéressant de préciser à quel niveau se situent les différences observées.
Tous les champs patrimoniaux se prêtent-ils à la participation ? Les formes de la participation sont-elles différentes suivant les champs ?
Le patrimoine, qui est le bien commun à transmettre, concerne par nature l’ensemble des citoyens. Mais suivant sa nature – archives, livres, œuvres d’art, objets du passé proche ou lointain (dans le temps et dans l’espace), patrimoine bâti ou naturel… –, certaines des trois grandes étapes de la patrimonialisation – collecte, conservation, étude et valorisation – semblent ne pas pouvoir se prêter, du moins de la même manière, à l’intervention des bénévoles et des participants, en regard de celle des professionnels. Cette impression est-elle justifiée ou relève-t-elle plus d’une évolution différenciée des différents champs et de leurs spécialistes ?
Existe-t-il une spécificité de la participation dans le patrimoine culturel ?
Comparer la problématique de la participation des citoyens aux politiques des patrimoines, avec celle concernant, par exemple, pour le ministère de la Culture, les politiques ayant trait à la création artistique et au spectacle vivant, mais aussi à d’autres champs des politiques publiques, l’environnement, la recherche ou la santé notamment, pourrait être intéressant. Un regard sur la situation dans d’autres environnements culturels et politiques, à l’étranger ou pour le patrimoine immatériel serait éclairant.
Proposition de contributions
Les articles proposés devront contenir une part inédite d’expérience, de recherche, d’hypothèse ou de mise à jour ; ils ne sauraient reprendre la totalité d’un article déjà paru. Il est souhaité qu’ils soient largement illustrés, y compris par des exemples sonores et/ou audiovisuels. Ainsi pourraient-ils contenir un entretien vidéo ou en prendre la forme.
Si vous souhaitez contribuer à ce numéro, nous vous remercions d’envoyer avant le 15 juin 2023 un résumé de votre proposition de 1500 signes au maximum, ainsi qu’un court CV
par courriel :
insitu.patrimoines@culture.
ou par voie postale :
Ministère de la Culture
Direction générale des Patrimoines et de l’Architecture
Revue In Situ
à l’attention de Nathalie Meyer
6, rue des Pyramides
75001 Paris
Merci d’envoyer également une copie de votre proposition aux coordinateurs scientifiques : Sylvie Le Clech, Bruno Saunier, Simon Piéchaud, Pierre Pénicaud à :
sylvie.le-clech@diplomatie.
pierre.penicaud@culture.gouv.
Les textes des articles correspondant aux propositions retenues sont attendus pour le 1er janvier 2024. Vous pourrez rédiger votre article en français ou dans votre langue d’usage. Les textes seront publiés dans leur version originale et dans leur traduction française. La taille des articles sera comprise entre 15 000 et 35 000 signes, espaces et notes comprises.
Les recommandations aux auteurs concernant le nombre de pages ou d’images, les droits iconographiques, l’insertion de notes et de liens, etc. sont consultables sur le site de la revue : https://journals.openedition.
La rédaction de la revue In Situ


