
Recherche
Résultats de la recherche
2299 résultats trouvés
NEMO 2022 : L'innovation commence à l'intérieur
Retrouvez vos collègues européens à la conférence européenne des musées NEMO 2022
Le réseau des organisations muséales européennes (NEMO) invite la communauté muséale européenne et internationale à se retrouver en personne lors de la conférence européenne des musées NEMO 2022 : L'innovation commence à l'intérieur - Des musées résilients en période de perturbation.
Participez à l'événement du 9 au 11 octobre à Loulé, au Portugal, pour explorer comment les musées peuvent devenir plus innovants, agiles et flexibles dans un monde en rapide évolution - et célébrez les 30 ans de NEMO !

ICOFOM Study Series - prochain numéro : Varia

Pour la première fois depuis son premier numéro, ICOFOM Study Series propose un numéro ouvert pour des articles portant sur divers sujets liés à la muséologie et à la théorie des musées.
Les articles doivent tenir compte de la politique éditoriale de cette revue et être basés sur des recherches originales dans le domaine de la muséologie, des musées et des études du patrimoine.
Les numéros des ICOFOM Study Series peuvent comprendre :
- des articles théoriques mettant en lumière une recherche originale ;
- des articles empiriques, fondés sur des recherches et des données empiriques, qui permettent les professionnel·le·s des musées et du patrimoine de partager leur expérience dans le domaine.
Modalités de soumission
Les articles doivent être de 6 000 mots maximum (notes et références comprises comme précisé dans nos consignes de rédaction) et doivent être envoyés pour le 11 novembre 2022 (au plus tard) à l’adresse suivante : icofomsymposium@gmail.com.
Ils respecteront les règles de mise en page APA de l’ICOFOM. Les propositions peuvent être écrites dans une des trois langues de l’ICOM (anglais, français, espagnol). Nous vous encourageons vivement à écrire dans la langue que vous maîtrisez le mieux. Afin que nous puissions publier le plus tôt possible, seules les propositions soignées et correctement formatées seront pris en considération.
Utilisation d'images :
L'autorisation de reproduire des images qui n'ont pas été créées par l'auteur doit être obtenue à l'avance auprès du détenteur des droits, avec des légendes et des mentions de crédits placées dans le texte, ainsi que des fichiers d'images haute résolution fournis séparément. L’utilisation d’images nécessite une autorisation préalable, à moins qu'elles ne soient déjà dans le domaine public, libres de droits ou sous licence Creative Commons.
Veuillez inclure des informations complètes sur la source et le crédit dans la légende de l'image et être prêt(e) à fournir des preuves d'autorisation à l'éditeur pendant le processus de publication.
La documentation en conservation-restauration. Accès, diffusion, droit et usages
Journée d'étude
Les rapports de conservation-restauration et leur documentation photographique font partie intégrante du corpus de connaissances d'un objet donc de son dossier d'œuvre.
En tant que documents déposés dans un établissement public (service de l'État, de collectivités territoriales, d'établissements publics au sens administratif ou service déconcentré), ils sont archives publiques. A l'ère de l'open data, les enjeux de diffusion numérique et de reproduction de cette documentation dépassent la seule question de la consultation du rapport en centre de documentation. Ces enjeux soulèvent également la question des droits patrimoniaux qui concerne directement les conservateurs-restaurateurs, les contrats de cession des droits ayant pris un essor inattendu pour la profession.
Cette journée d'étude se propose de faire un point juridique sur la nature d'archives publiques, sa communication ainsi que sur les éventuelles restrictions (inaccessibilité ou droit réservé). Elle abordera la question des droits d'auteur et la cession de ceux-ci, mais aussi les principes de communication de ces données scientifiques pour favoriser la recherche et l'innovation.
Coorganisation par les Archives nationales de France, Institut national du patrimoine et la Fédération française des conservateurs-restaurateurs [FFCR].
Débat francophone sur l'actualisation du Code de déontologie de l'ICOM
Le code de déontologie de l'ICOM pour les musées est en cours de révision.
Retrouvez le débat participatif du 3 octobre dernier avec Sally Yerkovich, présidente d'ETHCOM et Chedlia Annabi, membre francophone d'ETHCOM à l'intention des membres francophones de l'ICOM.
Consultation en cours
Participez à la consultation organisée par l'ETHCOM (comité permanent de l'ICOM pour la déontologie) ouverte à tous les membres de l'ICOM jusqu'au 31 octobre 2022 :
Consultation pour la Conférence internationale sur la régulation du génie climatique
Ki Culture et la Gallery Climate Coalition organisent une conférence les 1er et 2 décembre sur la régulation du génie climatique.
La maîtrise de l'environnement nécessite une consommation massive d'énergie et constitue l'une des principales empreintes carbone du monde culturel. Dans le cadre des efforts visant à réduire notre empreinte carbone, le secteur culturel cherche à augmenter les plages de contrôle énergétique. De nombreux protocoles ont été élaborés et adoptés, mais on ne dispose que de peu d'informations sur leur mise en œuvre effective.
Dans le but de faciliter l'action collective dans ce domaine, Ki Culture, en partenariat avec Gallery Climate Coalition, organisera la première conférence internationale sur la régulation du génie climatique (Climate control) les 1er et 2 décembre 2022. Cet événement en ligne gratuit présentera l'état actuel de la régulation du génie climatique dans le monde, exposera les données scientifiques qui sous-tendent des contrôles moins rigides et lancera un projet pilote visant à mettre en œuvre des solutions efficaces sur le plan énergétique.
En prévision de cet événement, nous vous demandons de prendre 2 minutes pour répondre à l'enquête suivante sur vos protocoles de contrôle climatique actuels. Les données recueillies seront présentées lors de la conférence (les noms des institutions seront inclus UNIQUEMENT si une autorisation expresse est donnée à la fin de ce formulaire). Les courriels ne sont pas recueillis, sauf si vous avez opté pour un entretien de suivi.
Merci de contribuer à cette importante recherche ! Et nous nous réjouissons de vous voir à la conférence !
Collectés, spoliés, restitués, authentifiés, restaurés. Biographies d’objets patrimoniaux
À la veille de la clôture de l'exposition "Objets migrateurs. Trésors sous influences", le service des musées de Marseille a le plaisir de vous convier à la dernière journée d'étude organisée en partenariat avec le Centre Norbert Elias et l'IDEMEC sur le thème :
Collectés, spoliés, restitués, authentifiés, restaurés. Biographies d’objets patrimoniaux
Les objets se déplacent, se transforment et se réinventent, d’un espace à l’autre, d’une époque à l’autre. « Les objets migrateurs ont toujours existé. Qu’il s’agisse d’hommes, de dieux, d’animaux, d’idées, de langues, de musique, de cuisines ou de choses, ils ne cessent de migrer. » (Barbara Cassin, commissaire de l’exposition). La seconde journée porte sur l’objet patrimonial - en apparence inanimé, sous vitrine et sans futur autre que celui de l’éternité de sa conservation. Pourtant, ces objets ont une vie singulière, une origine, un parcours et des significations mouvantes, bref une biographie. Qu’on les vole, les convoite, les garde, les collectionne, les montre ou qu’on les fasse circuler, ils sont l’objet d’investissements personnels et collectifs que l’on doit analyser.
Coordination : Cyril Isnart (IDEMEC/CNRS) et Sophie Deshayes avec les interventions d'Eric Jolly (IMAF/CNRS), Aude Fanlo (Mucem), Hamady Bocoum, directeur du Musée des Civilisations noires de Dakar, Barbara Cassin (CNRS), Nicolas Misery, directeur des Musées de Marseille, Muriel Garsson et Manuel Moliner (Musées de Marseille), Sonia Bodier (Direction des douanes de Marseille), Emmanuelle Canghari (Fonds belge de la recherche scientifique/Université catholique de Louvain), Gaspard Salatko (chercheur associé – Héritages UMR 9022)
Vous trouverez, ci-joint, le programme détaillé de cette journée en date du samedi 15 octobre. A l'issue des communications et des échanges, une visite de l'exposition Objets migrateurs. Trésors sous influences aura lieu en présence de Barbara Cassin, commissaire.
Informations pratiques
Salle du Miroir, au Centre de la Vieille Charité - 2 rue de la Charité, 13002 Marseille.
Accès libre, sans inscription préalable, dans la limite des places disponibles.
Edito d'octobre 2022

Chers / chères membres d’ICOM France, chers/ chères collègues,
Je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble des membres d’ICOM France qui m’ont réélue au sein du Conseil d’administration, ainsi que les administrateurs qui m’ont exprimé leur confiance en me choisissant comme présidente. Je souhaite également saluer le nouveau bureau : Valérie Guillaume (vice-présidente), Marie Grasse (trésorière), Laure Ménétrier (secrétaire), Frédéric Ladonne (trésorier adjoint) et Florence Le Corre (secrétaire adjointe).
Cette nouvelle mandature débute alors que nous traversons une crise climatique et énergétique sans précédent, une crise qui nous incite à réinterroger nos pratiques et à explorer des solutions que nous n’aurions pas envisagées il y a quelques années encore, pour des raisons d'économie ou de sobriété, mais également avec un souci ardent de construire des pratiques plus soutenables. Le sujet du développement durable, qui dépasse les seuls enjeux climatiques, et auquel ICOM France a déjà consacré de débats et des actions, est aujourd’hui ravivé par cette crise. Il a évidemment largement occupé les esprits lors de la dernière conférence d’ICOM à Prague qui a abordé d’autres sujets cruciaux et révélé des points de vigilance qu’il nous faut garder à l’esprit. Je n’en mentionnerais ici que trois:
- La question de la « décolonisation » (on notera que certains au sein de notre organisation auraient aimé que le terme soit intégré à notre nouvelle définition du musée) qui pousse à repenser la « manière d’être au monde » des musées ;
- Son « presque » corolaire, la place de l’Europe dans le concert international des musées, une Europe souvent remise en cause, ou du moins interrogée par nombre de nos collègues ;
- La nécessaire réaffirmation que l’ICOM représente TOUS les professionnels de TOUS les musées (alors que les musées de Beaux-Arts se faisaient rares à Prague), engage à s’interroger sur ce qui fait lien entre toutes nos structures, pour ne pas perdre ce qui fait la singularité de l’ICOM, c'est-à-dire la plus grande diversité.
La période pousse à remettre en cause un certain état de faits longtemps considéré comme acquis, et nous impose de repenser nos métiers et le rôle des musées.
Dans ce contexte, c’est avec engagement et conviction que je me suis portée candidate à la présidence du comité français de l’ICOM, consciente des missions que notre association professionnelle peut jouer pour offrir un espace d’expression à ses membres, porter leur voix et faire avancer le débat.
ICOM France cheminera en étroite concertation avec l’ensemble des interlocuteurs nationaux dont le Ministère de la culture, ses opérateurs, ses acteurs, les collectivités territoriales et les associations professionnelles.
Sur le plan national, ICOM France doit poursuivre le travail de fond mené avec les membres et pour les membres et ainsi renforcer son réseau, cœur de son activité. Les idées de thématiques autour desquelles construire les futurs rendez-vous sont nombreuses (la réévaluation des normes de conservation, la construction de nouveaux récits au musée, la réinvention du développement des ressources en temps de crise, les nouveaux développements du numérique…) et ne manqueront pas d’être enrichies des propositions qui émaneront de l’ensemble de la « communauté ICOM France ».
Faites-les nous connaitre ! Nous vous communiquerons prochainement la prochaine date et la prochaine thématique de notre soirée-débat de déontologie.
Mes années antérieures passées au sein d’ICOM France m’ont permis de voir comment la spontanéité des échanges et la souplesse de formats légers, à côté de débats plus organisés, est un atout formidable pour créer du lien et porter la vitalité de notre association. J’aurai à cœur de rendre possible ces espaces de discussion qui permettent de faire entendre les acteurs de terrains investis et désireux de partager leur expériences ou leurs interrogations.
C’est la voix commune des membres français de l’ICOM, ainsi mise en valeur, qu’il nous faudra porter sur la scène internationale. Nous pouvons d’abord compter sur l’opportunité unique donnée par l’élection à la présidence d’ICOM Europe de Juliette Raoul-Duval. Nous faisons face à un enjeu de taille: porter les positions européennes dans un contexte de grande méfiance. Nous devrons compter sur et faire vivre les liens établis avec nos collègues d’autres comités nationaux (l’Allemagne, la Belgique, la Grèce, l’Espagne, l’Italie pour n’en citer que quelques-uns), mais aussi savoir dialoguer avec d’autres comités européens dont les voix divergent parfois des nôtres. Si le dialogue intra-européen est d’importance, la discussion avec les autres comités internationaux et alliances sera primordiale, pour ne pas isoler ICOM France du reste du monde.
Participer aux grands chantiers de notre organisation (comme la mise à jour du code de déontologie, vous pouvez d’ailleurs faire remonter vos avis en répondant à la consultation lancée par ETHCOM sur l’espace membre d’ICOM, avant le 31 octobre), répondre aux appels d’offre d’ICOM en collaboration avec d’autres comités, rester attentif à la question des conflits internationaux et au rôle que notre association peut jouer dans le domaine de compétence et d’actions qui est le sien, favoriser les échanges entre les représentants français dans les comités internationaux (une rencontre sur plateforme sera prochainement organisée), poursuivre les efforts en faveur du plurilinguisme (vous pouvez déjà noter une réunion du groupe Define dédiée aux francophones le 25 octobre sur les questions relatives à la traduction de la nouvelle définition des musées d’ICOM) : voici quelques premières pistes de travail pour construire ensemble l’avenir commun de l’ICOM.
Certes, la période actuelle est bouleversante, elle bouscule nos certitudes et nos habitudes, mais cela la rend aussi passionnante.
Je souhaite mettre à profit mon expérience au sein d’ICOM, ma connaissance des réseaux institutionnels et associatifs et ma force de travail pour porter ces sujets au sein d’un bureau impliqué et engagé, avec une équipe permanente confortée, dans le souci constant de l’écoute des membres et des représentants élus / représentantes élues dont notre association tire sa légitimité.
Je crois au collectif et à la force d’un travail commun, engagé et partagé, pour relever les défis qui sont les nôtres.
A très vite !
ICOM Voices – Conscience historique et préservation des mémoires sociales
Le podcast ICOM Voices est maintenant disponible sur Spotify, Google Podcasts, et Apple Podcast !
Découvrez notre deuxième épisode en espagnol de ICOM Voices : Conscience historique et préservation des mémoires sociales
Dans cet épisode, le présentateur Mathieu Viau-Courville dialogue avec Karen Worcman, directrice et fondatrice du Musée de la personne à Sao Paulo, et Eddie Avila, directeur de Rising Voices, au sujet de la manière dont les souvenirs de souffrance sont exposés dans le cadre des efforts collectifs de construction de la conscience historique et de l’identité.
Alors, que vous soyez un professionnel expérimenté des musées, un étudiant en muséologie ou un passionné de culture, écoutez ce deuxième épisode pour avoir un aperçu des épisodes passionnants à venir !
LE PRÉSENTATEUR
Mathieu Viau-Courville est directeur de l’Office de coopération et d’information muséales (OCIM), France. Né au Canada et élevé en Grèce, il s’intéresse aux études interculturelles des musées dans les contextes contemporains. Il considère que les musées, quels qu’ils soient, sont des espaces inclusifs qui favorisent la diversité et génèrent des expériences sociales significatives. Depuis plus de 15 ans, Mathieu a travaillé dans et autour de musées nationaux et d’universités au Canada, en Espagne, aux Pays-Bas, en France, au Royaume-Uni et au Luxembourg. Il a également mené des recherches approfondies sur le terrain en Amérique du Sud, principalement en Bolivie, où il a passé un total de six ans, ainsi qu’au Brésil, où il travaille depuis 2014 à la conception d’initiatives d’enseignement et d’engagement communautaire. Il développe également des collaborations de recherche et des ateliers en Espagne depuis 2012, notamment en Catalogne et au Pays basque. Il a obtenu son doctorat à l’école d’études des arts du monde et de muséologie de l’université d’East Anglia, au Royaume-Uni.
LES INVITÉS DE CET ÉPISODE
Karen Worcman est directrice du Musée de la Personne, Brésil. Elle est née à Rio de Janeiro, au Brésil, en 1962. Elle est diplômée en histoire et possède un master en linguistique. Elle travaille sur l’histoire orale depuis 1986. Elle est directrice du Musée de la Personne et l’une de ses fondatrices. Elle a coordonné d’innombrables projets sur les histoires de vie. Les projets – développés pour des entreprises et des institutions – sont devenus différents types de produits tels que des salles de CD, des intranets, des livres, des expositions et des documentaires. Le Musée de la Personne est un musée virtuel fondé à São Paulo, Brésil en 1992. Depuis 1996, un site sur le net est ouvert pour que chacun puisse envoyer son histoire de vie et lire celle des autres. Depuis sa création, Karen a coordonné plus de 20 projets tels que l’histoire multimédia des deux principales équipes de football du Brésil, l’histoire multimédia des commerçants du Brésil, l’histoire de l’électricité, des centres de mémoire pour certaines des plus grandes entreprises du Brésil. Elle est également membre d’Ashoka. Ashoka est une organisation mondiale à but non lucratif qui trouve et soutient des individus exceptionnels pour un changement social de grande envergure. Elle s’intéresse principalement à l’histoire orale et à la technologie, ainsi qu’à la manière dont elles peuvent être appliquées à la communication et à l’amélioration sociale. Son objectif est de créer un réseau international basé sur les histoires de vie qui devrait fonctionner sur le net et qui sera un canal alternatif de communication et d’éducation entre différents types de communautés.
Eddie Avila est directeur de Rising Voices, l’initiative de sensibilisation de Global Voices, dont l’objectif est d’aider à faire entendre de nouvelles voix issues de nouvelles communautés et parlant des langues menacées ou indigènes dans le débat mondial en proposant des formations, des ressources, des micro-subventions et un encadrement aux communautés locales sous-représentées qui souhaitent raconter leur propre histoire numérique à l’aide d’outils médiatiques participatifs.
Parution du Dictionnaire de muséologie en langue française
Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution du Dictionnaire de muséologie en langue française, une coédition entre Armand Colin (Dunod) et l’ICOM, sous la direction de François Mairesse.
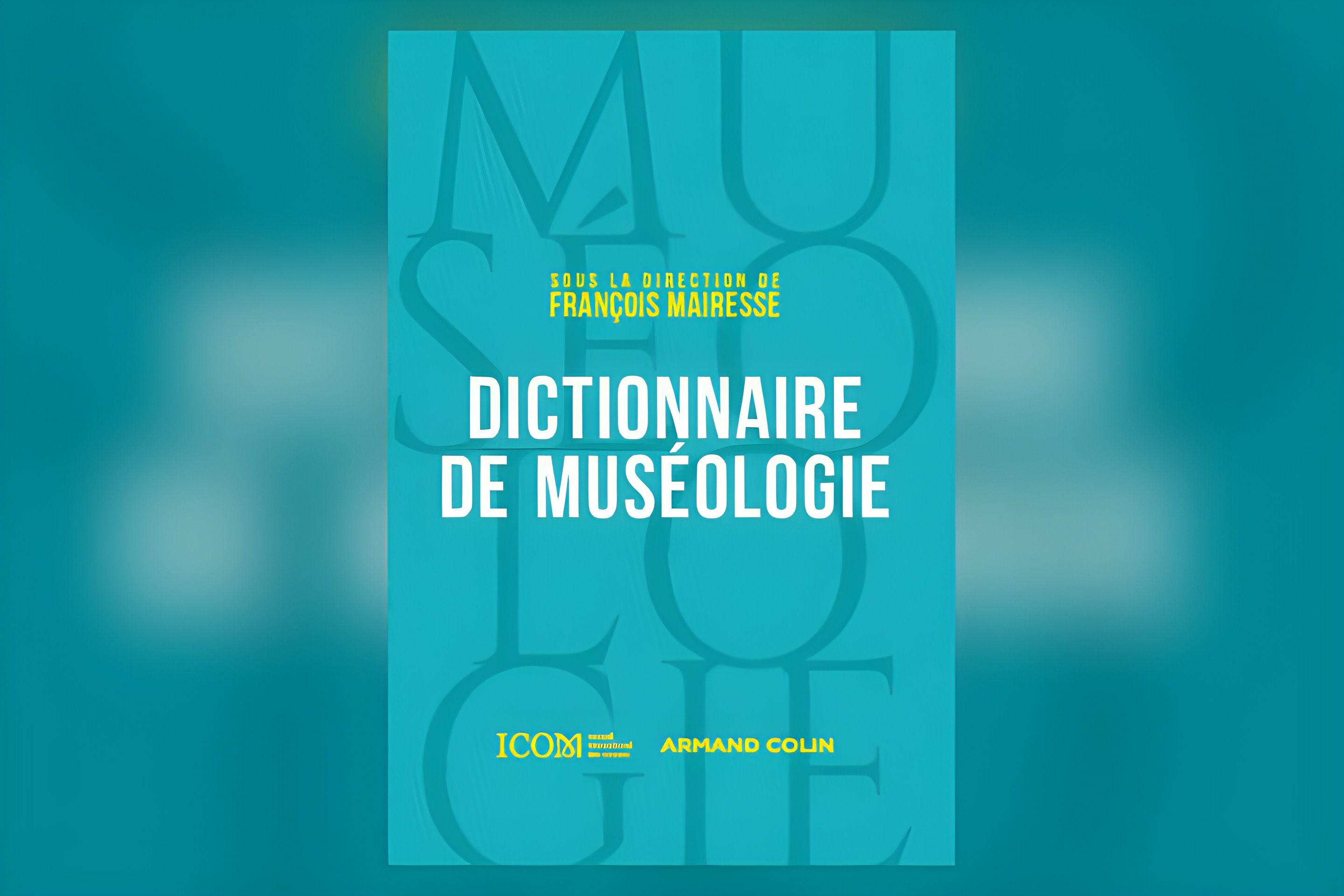
Les musées sont plus que jamais au centre des problématiques culturelles, sociales et économiques de nos sociétés. Cet ouvrage de référence couvre à la fois les domaines de la muséologie, de l’exposition, des méthodes de recherche, de gestion des collections et de conservation/restauration, de l’éducation muséale et la médiation, dans la gestion/marketing, de l’histoire et de l’analyse critique du musée.
Le fruit de plusieurs années de recherche, réunissant une équipe d’experts et d’auteurs internationaux, avec plus de 1200 entrées organisées en sept thématiques, le Dictionnaire de muséologie vient définir, analyser et mettre en perspective l’ensemble des termes utilisés dans le champ muséal, des plus académiques (exposition, artefact, patrimoine immatériel, cabinet de curiosité) aux plus innovants (NFT, points de mémoire, cybermusée…).
Nous espérons que le Dictionnaire de Muséologie permettra à ses lecteurs d’utiliser un langage commun, accessible à tous les professionnels de musée de toutes disciplines et de toutes cultures.
Les membres de l’ICOM bénéficient d’une remise de 30%. Si vous êtes intéressé(e), contactez le département des publications : publications@icom.museum
L’édition anglaise du Dictionnaire de muséologie paraitra en décembre 2022
Nouveau bureau exécutif
Le bureau exécutif d’ICOM France a été renouvelé au terme des élections qui se sont déroulées le 6 octobre dernier.
Emilie Girard, directrice scientifique et des Collections du Mucem (Marseille), a été élue présidente, pour un mandat de trois ans.
Le bureau exécutif est composé de :
- Vice-présidente : Valérie Guillaume, directrice du musée Carnavalet - Histoire de Paris et de la Crypte archéologique de l’Île de la Cité (Paris)
- Trésorière : Marie Grasse, directrice du musée national du Sport (Nice)
- Secrétaire générale : Laure Ménétrier, directrice des musées du vin de Champagne et d’Archéologie régionale (Epernay)
- Trésorier adjoint : Frédéric Ladonne, architecte programmiste (Paris)
- Secrétaire générale adjointe : Florence Le Corre, Conseil - indépendante (Paris)

Biographies
Présidente

Emilie Girard est directrice scientifique et des Collections du Mucem et conservatrice en chef du patrimoine. Elle rejoint l’équipe du MuCEM en 2006. En 2008, elle prend la direction du département des collections du musée où elle conduit entre autres le chantier qui a permis le transfert de Paris à Marseille de l’intégralité des collections et fonds conservés, et la mise en place du Centre de Conservation et de Ressources du Mucem. Elle assure régulièrement le commissariat d’expositions au Mucem (comme la Galerie de la Méditerranée en 2013 ; Un génie sans piédestal, Picasso et les arts et traditions populaires en 2016, On danse ? et Les reliquaires de A à Z en 2019, Jeff Koons Mucem ou Le Désir de regarder loin avec l’artiste Ilaria Turba en 2021). Elle coordonne la programmation de La Chambre d’amis depuis sa création en 2021. Depuis le 1er aout 2019, elle est dirige l’équipe scientifique et des collections du Mucem. Parallèlement, elle s'engage auprès d'ICOM dès 2005 et est élue au Conseil d'Administration d'ICOM France en 2016. Elle occupe successivement les fonctions de trésorière adjointe puis de vice-présidente, avant d'être élue Présidente du comité le 6 octobre 2022.
« Alors que les musées sont aujourd’hui confrontés à des mutations profondes (crises sanitaires, changement climatique, bouleversements sociétaux, renouvellement des attentes des publics…) qui transforment leurs pratiques et incitent à repenser leur rôle dans la société, l’ICOM constitue pour eux le seul organe international de liaison, d'information et d'échange, réunissant toutes les catégories professionnelles de tous les musées. Dans ce contexte, ICOM France a vocation, peut-être encore plus qu’avant, à offrir un espace d’expression à ses membres, pour porter leur voix et faire avancer le débat, sur le plan national et international. »
Vice-présidence

Adhérente depuis 1986 à l'ICOM, Valérie Guillaume a dirigé plusieurs départements de collections au sein de musées territoriaux et nationaux, avant d'être nommée pour mener à bien la rénovation d'un musée d'histoire, le musée Carnavalet Histoire de Paris, qui a accueilli plus d'1,3 million de visiteurs depuis sa réouverture. Faisant partie de multiples instances scientifiques, ses expériences sont de nature pluridisciplinaire et pluri-professionnelle, ses projets accomplis, complexes.
« ICOM France crée l’opportunité d’une démarche prospective, collective, qui emprunte deux voies, parallèles et complémentaires. La première, « réparatrice », au quotidien soutient les musées et rend visibles des trajectoires innovantes et des dynamiques collectives. L’autre voie, à moyen et long terme, est de nature plus complexe. ICOM France a pour ambition de révéler, d’analyser les changements systémiques majeurs à l’œuvre, aujourd'hui, pour identifier les idées à fort potentiel de changements et aussi les leviers d’action, à partager. »
Trésorière

Docteur en histoire de l’art, Marie Grasse a dirigé les musées de la ville de Grasse puis piloté la restructuration et l’agrandissement du musée de la Parfumerie, travaillé sur l’ouverture du musée Bonnard au Cannet et suivi l’écomusée du pays de la Roudoule à Pujet Rostang. Elle a ensuite été sollicitée pour mener à bien le transfert du musée national du sport, de Paris à Nice où elle travaille actuellement comme directrice générale.
Elle a acquis une expérience de projets divers et complexes mais également de direction de plusieurs musées de société, d’histoire et des beaux-arts, tant au sein de collectivités territoriales que de l’État. Membre d’ICOM depuis 2002, elle est convaincue que le réseau national et international d’ICOM est un atout pour tous les professionnels des musées et souhaite contribuer utilement à la réflexion sur ces métiers, mais également accompagner les mutations des musées notamment en matière environnementale et sociétale.
Secrétaire

Diplômée de l'École du Louvre, de l'Université de Bourgogne et historienne de l'art, Laure Ménétrier est la directrice conservatrice du musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale. Auparavant, elle a dirigé les musées de Beaune.
Son engagement au sein du conseil d'administration d'Icom France et désormais en tant que secrétaire repose sur 3 aspirations :
- participer à la réflexion relative à l'évolution des pratiques professionnelles et des normes de conservation des musées vers une démarche écoresponsable et durable ;
- à l'heure de la révolution numérique, de la dématérialisation des données et de l'apparition de nouveaux lieux de découverte "culturo-touristiques", accompagner les musées vers une redéfinition de leur lien aux publics en réaffirmant leurs missions culturelles et éducatives, de facilitateur de lien social et d'éveil à la citoyenneté ;
- participer aux échanges entre musées à l'échelle internationale afin de favoriser le dialogue et confronter les perceptions, interprétations et conceptions de nos métiers et missions.
Trésorier adjoint

Architecte de formation, intervenant sur des missions de maîtrise d’œuvre mais surtout d’assistance auprès des musées (programmation, conservation préventive, muséographie), Frédéric Ladonne est titulaire d’un master de conservation préventive et d’un autre en ingénierie en haute qualité environnementale. Membre actif de notre communauté muséale depuis presque 20 ans en tant que professionnel, enseignant à l’école du Louvre, à l’INP, il a travaillé pour près d’une centaine d'établissements aux échelles et collections différentes, grands musées nationaux, collections d’art contemporain, musées de société de tailles plus modestes dans presque toutes les régions.
Convaincu de la richesse et des diversités de notre communauté, Il souhaite apporter à celle-ci le regard d’un des partenaires des musées, qui sont aussi des acteurs importants du patrimoine. Pour lui, l’avenir de l’ICOM passera à la fois par l’affirmation et par l’ouverture des pratiques professionnelles comme à la diversité des approches muséales.
Secrétaire adjointe

Chargée d’études documentaires puis conservatrice du patrimoine, Florence Le Corre est titulaire d’un DEA en histoire de l’art et archéologie, du diplôme d’ingénieur de l’INTD-CNAM et du diplôme de conservateur du patrimoine de l’INP. Elle a travaillé dans différents musées (musée de l’Armée, où elle a créé le Cabinet des arts graphiques, musée national de la Marine dans lequel elle a participé aux projets de rénovation et de réorganisation, musée du Service de santé des armées où elle a pris en charge la collection photographique) puis au Service des musées de France. Elle mène aujourd’hui des missions de conseil auprès de différents établissements. Elle souhaite défendre et aider tous les musées et tous les métiers des musées français, en lien avec nos collègues étrangers dont le regard et l’expérience sont riches d’enseignements.



