
Recherche
Résultats de la recherche
24 résultats trouvés
Les musées, acteurs crédibles du développement durable ?


« Disons-le franchement : les musées n’ont pas encore fait leur révolution écologique. Alors, faut-il arrêter de faire des expositions ? Non, bien sûr, mais il serait peut-être temps de changer certaines pratiques, en privilégiant par exemple les prêts d’œuvres en circuit court ou en recyclant les éléments de scénographie, car s’il fait frais dans les musées, cela peut un jour se mettre à chauffer pour eux »1.
Voilà ce qu’on lisait dans l’Œil, il y a juste deux ans. Heureusement, parmi les observateurs critiques des musées, certains voient aujourd’hui, entre « musée et écologie, un tournant majeur ! la transition écologique est en route : longtemps pointées du doigt, les institutions culturelles s’activent pour réduire leur empreinte carbone »2.
La pandémie, en effet, a marqué un tournant. Dès les premières fermetures de mai 2020, plusieurs dirigeants de musées ont pris la plume pour exprimer eux-mêmes leur désir de mettre fin au « productivisme », au turn-over rapide d’exposition d’œuvres ayant un long parcours de transport à leur actif et rappeler que nombre d’équipes, dans les musées, n’avaient pas attendu la crise sanitaire et les leçons de vertu pour agir. Le discours est devenu très audible, car tous les professionnels, dans un mouvement de résilience partagé, ont alors aspiré à prendre leur part de la reconstruction du musée de demain, responsable et durable. A ICOM France, un cycle de débat sur plateforme, hâtivement monté et efficacement conduit, porte témoignage de ces volontés de changement, émanant de tous les acteurs de tous les musées, grands et petits3. Porté par des professionnels, ce débat trouve aussi sa véritable ampleur et ne se focalise pas sur les expositions, activité certes la plus visible pour le grand public, mais pas seule concernée par l’enjeu de l’éco-responsabilité : transport, climatisation des réserves, et même déplacements des publics … sont à prendre en compte dans leur bilan carbone !
Les désastres climatiques de l’été 2021 ont accéléré le sentiment d’une urgence, face à laquelle une mobilisation d’envergure s’imposait. Le développement durable s’est invité sur le devant de la scène, au sens le plus large de l’agenda 2030 : construire une société économiquement et socialement viable. Les musées ont compris qu’ils pourraient en être des acteurs-clés. L’ICOM avait déjà, lors de son assemblée générale de septembre 2019, adopté la résolution « Développement durable et mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, Transformer notre monde ». Ce programme, mis en place par l’ONU en 2015 et signé par la majorité des états membres lors des Accords de Paris, inclut les 17 Objectifs du Développement Durable, qui visent à répondre aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement et viser à la prospérité économique, à la paix et à l’éducation…. L’ICOM invite ses musées adhérents à suivre cette voie. Un groupe de travail (Working Group on Sustainability) a été créé en septembre 2018 pour permettre un accompagnement méthodologique.
A notre tour, à ICOM France, nous avons décidé, mi-2021, de contribuer à cette mission et d’y impliquer ses membres : lancement d’un questionnaire et constitution d’un groupe de volontaires, sensibilisés aux enjeux ou déjà impliqués dans des actions concrètes de leurs établissements. La réponse a été forte dès le mois d’août. Elle a permis de recenser de nombreuses expériences et pratiques organisationnelles, qu’il est vite apparu opportun de partager, de valoriser et d’enrichir.
C’est le premier objectif de la soirée-débat déontologie du 17 février prochain.
Le deuxième objectif est prospectif : quelle part incombe aux musées, au-delà de l’adoption de pratiques vertueuses, pour contribuer collectivement aux objectifs de l’agenda 2030 ?
Robert Janes le formule ainsi dans un article titré « Museums in perilous times » :
« Les musées sont éminemment qualifiés pour aborder le changement climatique pour diverses raisons, en plus de leur vision profonde du temps qui passe. Ils sont ancrés dans leurs sociétés ; ils sont un pont entre la science et la culture ; ils témoignent en rassemblant des preuves et des connaissances qu’ils ont la charge de faire connaître ; ils sont des conservatoires des pratiques durables qui ont guidé notre espèce pendant des millénaires ; ils sont compétents pour rendre l'apprentissage accessible, engageant et amusant, et enfin, ils sont parmi les environnements de travail les plus libres et créatifs au monde »3.
Lors du G20 centré sur la Culture réuni à Rome l’été dernier, le Président d’ICOM - seules deux ONG étaient conviées, dont ICOM et son intervention figure dans la déclaration finale - a positionné à son tour les musées comme des acteurs-clés en tant qu’institutions parmi les plus crédibles.
La responsabilité qui incombe aux musées, en raison de leur crédibilité, est d’agir pour informer et convaincre leurs visiteurs, influencer leurs perceptions et leurs comportements. Comment est-ce intégré aujourd’hui dans la conception des expositions futures et de la programmation culturelle associée ? Le débat n’a pas de frontière et les musées forment un réseau mondial très dense, structuré depuis trois-quarts de siècle par l’ICOM, qui peut avoir un impact fort si les efforts convergent. On invitera les professionnels de tout le réseau d’ICOM à en témoigner et à présenter leurs projets. Certains conçoivent déjà des musées entièrement dédiés aux « problématiques environnementales, au développement durable et aux solutions possibles » (Climate Museum de New York, créé en 2016), beaucoup œuvrent à de leurs de nouvelles présentations.
Enfin, on s’interrogera, avec l’INP, sur les dispositifs de formation à l’œuvre et sur l’enjeu de sensibilisation des futurs professionnels de musées.
JRD, janvier 2021
(1) Fabien Simode,, « Le mauvais bilan carbone des expositions », L’Oeil-Le Journal des arts, 30 septembre 2019.
(2) Mailys Celeux-Lanval, « Musées et écologie : un tournant majeur », Beaux Arts magazine, 22 octobre 2021.
(3) Version originale : « In addition to their deep view of time, museums are eminently qualified to address climate change for a variety of reasons. They are grounded in their communities and are expressions of locality; they are a bridge between science and culture; they bear witness by assembling evidence and knowledge, and making things known; they are seed banks of sustainable living practices that have guided our species for millennia; they are skilled at making learning accessible, engaging and fun, and last, they are some of the most free and creative work environments in the world. » dans Museum Management and Curatorship, Volume 35, Issue 6: Museums and climate action, ICOM, 2020, pages 587-598.
Programme
Ouvertures
Charles Personnaz, directeur de l’Institut national du patrimoine (Inp)
Juliette Raoul-Duval, présidente d’ICOM France
Intervenants
Carine Ayélé Durand, responsable de l'unité collection du Musée d'ethnographie de Genève et directrice ad interim du Musée d'ethnographie de Genève ;
Nathalie Bondil, directrice du département du musée et des expositions de l’Institut du monde arabe ;
Etienne Bonnet-Candé, administrateur général du Palais des Beaux-Arts de Lille ;
Elsa Boromée, conseillère développement durable au Muséum d’histoire naturelle de Paris ;
Hélène Guenin, directrice du MAMAC, Nice ;
Sonia Lawson, directrice du Palais de Lomé - centre d’art et de culture, Lomé - Togo;
Bettina Leidl, présidente d’ICOM Autriche, directrice de la Kusnt Haus Wien - Autriche ;
Olivier Lerude, haut fonctionnaire au Développement durable du ministère de la Culture ;
Lucie Marinier, professeure du Conservatoire national des Arts et Métiers, titulaire de la chaire d’ingénierie de la culture et de la création ;
Henry McGhie, membre du groupe de travail sur le développement durable de l’ICOM international, directeur de l'agence Curating Tomorrow - Royaume-Uni ;
Aude Porcedda, professeure au Département d’études en loisir, culture et tourisme de l’Université du Québec à Trois-Rivières ;
Karin Weil, responsable du patrimoine naturel et culturel au Centro de Humedales Río Cruces - Chili ;
Modératrices : Estelle Guille des Buttes et Hélène Vassal, membres du bureau d’ICOM France.
Retrouvez la séance
Captation en français, première partie
Captation en français, deuxième partie
Podcast en anglais
Podcast en espagnol
Les actes d'ICOM France n°40

Editorial
L’année 2016 a été en France une année de débats publics et politiques sur les enjeux culturels, avec la discussion et le vote de la loi « Liberté de la création, architecture et patrimoine ». Peu de temps auparavant, la loi portant la nouvelle organisation territoriale de la République avait produit d’importante transformations dans la répartition des compétences en matière de culture entre l’Etat et les régions, aboutissant notamment) renforcer les compétences des régions et le poids des élus territoriaux. Tenir la journée professionnelle annuelle d’ICOM France dans l’enceinte du Sénat était symbolique. Il s’agissait de sensibiliser les élus aux problématiques des musées, particulièrement bien sûr celles de musées en région et de mieux appréhender les attentes des élus à l’égard des musées.
Nos vifs remerciements vont tout d’abord à Françoise Carton, vice-présidente du Sénat, sénatrice de la Gironde, membre de la commission Culture, Education et Communication, qui nous a accueillis dans les salons de la Présidence du Palais du Luxembourg. Son engagement aux côtés des musées et sa conviction que les professionnels des musées ont un rôle social éminent à jouer notamment dans le milieu éducatif et jusque dans les zones rurales a pesé fortement pour la réussite de cette journée. Remercions également chaleureusement Jean-Claude Luche, sénateur de l’Aveyron et président de son conseil départemental. Sa riche expérience d’élu local le convainc qu’aujourd’hui un musée doit tisser des liens et s’intégrer pleinement dans un territoire car la culture c’est toujours un choix pour les collectivités territoriales.
Nos tables-rondes abordait précisément le sujet des changements intervenus dans le monde muséal : Daniel Jacobi a souligné la diversité des institutions, leur accroissement et le « paradigme de l’exposition » qui transforme le musée. Jean-Pierre Saez a livré une analyse de la place de la culture dans la loi NOTRe, plus que jamais liée à l’ambition de chaque collectivité. Il n’y a de « compétence culturelle obligatoire » -que l’auteur aurait souhaité- le patrimoine reste l’objet le plus sensible dans les relations entre les collectivités et l’Etat mais le texte introduit clairement l’idée de droit culturel, notamment grâce à l’insistance des sénateurs. Sylvie Pfliergler a mis en avant l’extrême hétérogénéité des situations -1% des musées concentrent 50% des entrées- et a posé la question de la soutenabilité future des musées de France.
La deuxième table-ronde était celle de professionnels des musées venant d’établissements ou d’associations en région, invités à témoigner de leur expérience, de leurs espérances et de leur ancrage dans le territoire. Jean Guibal a avancé l’idée que le musée du patrimoine devait être la maison mère de tous les patrimoines. Christophe Vital témoigne d’une démarche participative, en Vendée, d’un projet de musée qui associe la population à sa définition. Géraldine Balissat a relaté l’expérience de gestion en réseau coopératif des musées scientifiques et techniques francs-comtois, du rapport de cette association avec les élus, les propriétaires de site et en a exposé les enseignements institutionnels. Nicolas Dupont a mis en perspective l’engagement conjoint des politiques et des professionnels qui a fait du projet du musée des Confluences l’une des plus vastes réhabilitations urbaines en Europe.
Après ces très fortes interventions, Jean-Michel Tobelem dans sa conclusion, est revenu sur la notion de « paysage culturel », en soulignant le paradoxe d’une responsabilité accrue des musées à l’égard de leur territoire dans une période où ils ont eu du mal à faire face à leurs missions existantes. De manière prospective, il a interrogé leur rôle à venir dans le sens de l’intérêt public et de la cohésion sociale, en invitant à un décloisonnement et à une ouverture à la mutualisation, aux partenariats et à la coopération.
Le tempo de cette réunion était aussi fixé par des enjeux internationaux : elle précédait la 24e Conférence générale triennale d’ICOM international, qui s’est tenue à Milan en juillet 2016. Les acteurs culturels italiens avaient retenu la thématique « Musées et paysages culturels » et rassemblé des préconisations dans une charte, dite Charte de Sienne, qui a inspiré nos réflexions et suscité, à l’international, une position coordonnée de la délégation française sous le pilotage de Louis-Jean Gachet, membre du Bureau d’ICOM France.
La journée d’ICOM France au Sénat s’inscrivait donc dans une double actualité : française avec le contexte de la décentralisation et de la loi Création ; mondiale à Milan.
Cette séance de travail des professionnels de musée a aussi été porteuse d’une annonce : celle du lancement de la mission « Musées du XXIe siècle » par Marie-Christine Labourdette, directrice du Service des musées de France au Ministère de la Culture. Orientée principalement sur la question des publics, la mission visant prioritairement à conforter les politiques de démocratisation des musées et d’accueil de tous, notamment de ceux qui en sont le plus éloignés. On trouvera, en fin de ce volume, la contribution d’ICOM France à cette mission d’envergure.
Pour tous les intervenants et dans le débat avec les professionnels présents, l’actualité des musées reste complexe. D’un côté, la fréquentation des « grands » musées, même si elle a connu un ralentissement sous l’effet des évènements terroristes, reste très élevée. D’un autre côté, un territoire, les situations sont très inégales voire disparates. Les ressources sont plus rares et la part de l’activité consacrée à les rechercher et à les gérer s’accroît mécaniquement.
Les métiers changent. Nous avons lancé un cycle de soirées-débats : qu’est-ce qu’être aujourd’hui un professionnel de musée, quelles compétences et quelles qualifications sont requises, quelles formations sont dispensées pour que tous ceux qui œuvrent au sein d’une institution muséale aient une déontologie commune ? Y a-t-il toujours un « modèle français », tel celui qui avait permis il y a 70ans la création à Paris de l’ICOM aujourd’hui présente dans 136 pays et de son code de déontologie traduit dans 36 langues et qui fait loi dans de nombreux pays qui n’en disposent pas ?
A nos 4700 membres, invités chaque année à se rassembler en assemblée générale et à débattre de questions vives (en 2017, le « Récit dans l’exposition », au musée des Confluences), nous voulons donner davantage la parole, notamment à travers un site renouvelé qui permettra de partager expérience et bonnes pratiques.
Juliette Raoul-Duval
Présidente d’ICOM France
Denis-Michel Boëll
Ancien président d’ICOM France
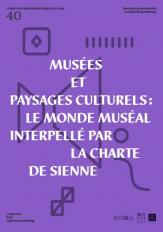
Pour une délégation responsable – Musées et externalisation
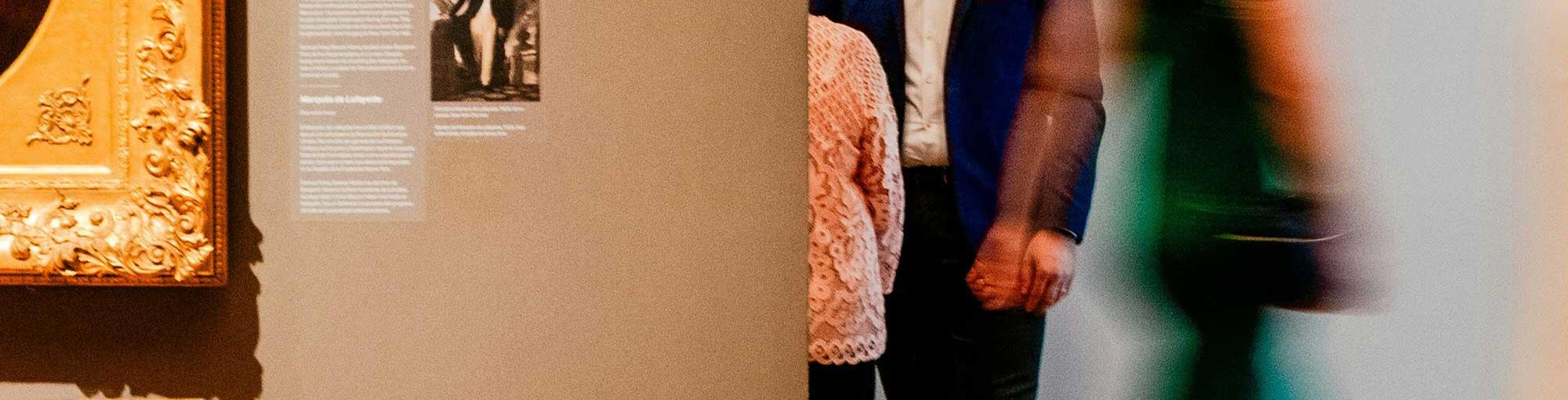
Retrouvez la captation de notre soirée du 24 mars dédiée à l'externalisation dans les musées.
La rencontre a été modérée par Michèle Antoine, directrice du musée des Arts et Métiers et conclue par Séverine Blenner-Michel, directrice des études et du département des conservateurs de l'Inp.
Elle a réuni les interventions de :
- Goranka Horjan, présidente d'INTERCOM (comité international de l'ICOM pour la gestion des musées) ;
- Nathalie Candito, responsable du service Expérience visiteurs, études et qualité, musée des Confluences ;
- Claire Muchir, directrice du musée d’art moderne de Collioure ;
- Gilles Guey, directeur de la culture de Roubaix et président de l'ADAC-GVAF (Association des directeurs des affaires culturelles des grandes villes et agglomérations de France).
Moments forts de la soirée :
« Parler d'externalisation en dit beaucoup sur les valeurs du musée, mais aussi sur les champs de contraintes dans lesquels se débattent les musées. »
Michèle Antoine, directrice du musée des Arts et Métiers
« Derrière chaque musée réussi, il y a un effectif compétent qui travaille ensemble. La manière dans laquelle un musée recrute reflète la priorité professionnelle du travail et des valeurs qui lui sont chères. »
Goranka Horjan, présidente d'INTERCOM (comité international de l'ICOM pour la gestion des musées)
« [Au musée des Confluences] nous pouvons avoir des variations de fréquentation entre 500 visiteurs par jour jusqu'à parfois 8 000. Compte tenu de ces contraintes, de ces formats d'équipe, du volume d'activité, le musée a choisi de déléguer certaines fonctions à des entreprises tierces pour se concentrer sur ces missions de fond. »
« Le musée conserve le contrôle sur l'ensemble de ses missions et de ses fonctions en particulier, c'est lui qui définit les orientations, les contenus et coordonne la mise en œuvre en évaluant vraiment la qualité, mais aussi l'expérience des visiteurs. »
« Une des clés, c'est de penser cette relation dans une optique de collaboration, et d'essayer d'être cohérent entre le projet du musée, ses valeurs, et de les partager avec ses équipes. »
Nathalie Candito, responsable du service Expérience visiteurs, études et qualité, musée des Confluences
« [En externalisant le commissariat d’exposition] on a refusé à l’équipe en interne d’incarner, le plaisir de voir l’incarnation d’un discours dans un parcours. L’équipe ne s’est pas approprié le discours, et le parcours qui lui a été imposé. »
« Une exposition est aussi un outil de management d'une équipe. C'est toute une équipe qui travaille à l'incarnation de ces expositions. »
« L'envie de partager, c’est donc de passer d'une externalisation du commissariat à un partage du commissariat, ce qui est complètement différent. […] Il y a un récit à écrire ensemble. »
Claire Muchir, directrice du musée d’art moderne de Collioure
« Sur cette question de l'externalisation, je dirais qu'il y a deux socles à peu près unanimement respectés. Le premier point c'est la question de la conservation des collections permanentes qui bien sûr reste quelque chose absolument à garder en interne et l'autre sujet est la question de l'externalisation d'un certain nombre de services spécialisés. Nous croyons tous ou presque que d’avoir des restaurants externalisés, c'est vraiment très important. Il est important que les musées soient des lieux de vie, des lieux qui accueillent tout le monde, y compris des gens qui viennent juste pour déjeuner, mais qui vont voir une exposition un autre jour. Il est important d'avoir des boutiques performantes, intéressantes, qui ont une vraie offre qualitative, très en lien avec les expositions qu'on propose. Pour cela, on croit qu'il faut l'externaliser, parce que c'est très spécifique. »
« Sur cette question de l'internalisation et de l'externalisation, nous n'avons pas de position ferme. Cela dépend des moments, des sujets, des façons d'aborder, des priorités qui ont été fixées. »
Gilles Guey, directeur de la culture de Roubaix et président de l'ADAC-GVA
« Il me semble que les débats de ce soir ont permis de redire ce qui est fondamental pour les professionnels des musées. Ils ont permis de redire aussi que cette externalisation des missions fait partie intégrante du fonctionnement de nos musées aujourd'hui, et que ce qui compte, c'est effectivement d'être vigilant sur le cadre d'exercice de ces externalisations. Et d'être toujours prêt, éventuellement, à réajuster, pourquoi pas à modifier les rapports entre les missions externalisées et les missions internalisées. Et puis de laisser aussi aux professionnels cette liberté de pouvoir décider ce qui convient aux modes de fonctionnement de leur établissement. »
Séverine Blenner-Michel, directrice des études et du département des conservateurs de l'Inp
Captation en version originale
Captation en anglais
Captation en espagnol
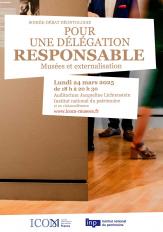
Peut-on parler d'une Europe des musées ?
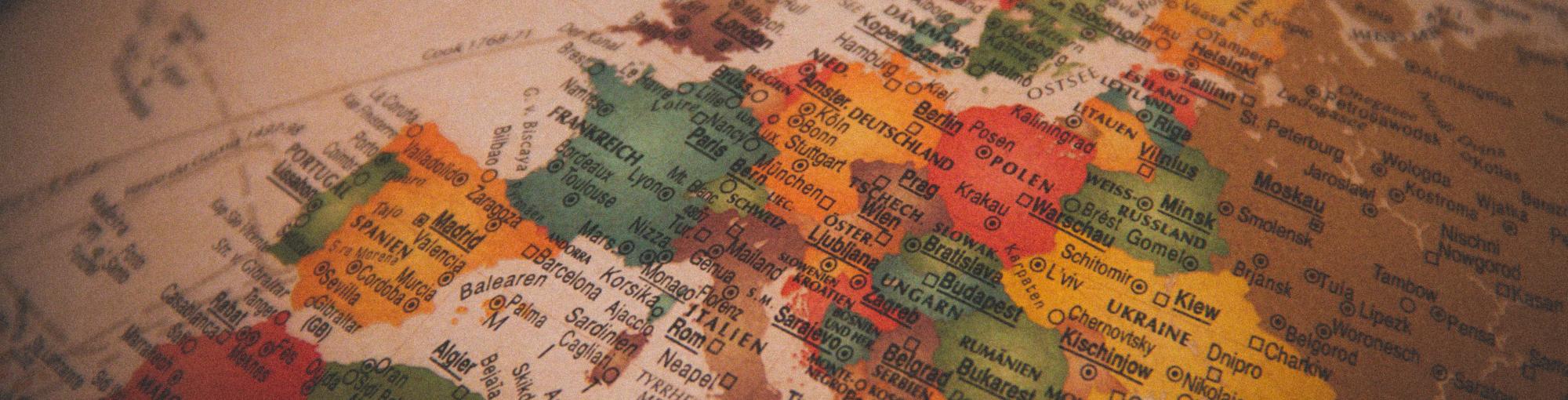
Propos de la soirée
À quelques semaines de la présidence française de l’Union européenne, nous avons choisi d’inviter les professionnels de musées à débattre ensemble de ce que signifie aujourd’hui, pour un musée, « être européen ».
Ouvrir cette question, c’est s’interroger sur les valeurs que nous avons en commun - ou désirons partager - au sein d’une région du monde aussi variée sur le plan culturel, politique, économique… La période se prête à cette réflexion pour les membres de l’ICOM, car notre organisation est traversée par des questionnements sur son identité – qu’est-ce qu’un musée, quels termes peuvent le définir de manière recevable et pertinente en tout point de la planète, en englobant tous ses domaines, de l’art à la science ? Cette aspiration à nommer - ou plutôt à renommer - est légitime tant les musées se sont multipliés et diversifiés en vingt ans ; et les crises de ces vingt derniers mois mettent déjà chacun en situation de penser ce que sera l’après : nous sommes conscients, à ICOM, que l’enjeu de se définir est celui de notre unité-même.
Le « modèle » des musées européens, dans ce contexte, est particulièrement interrogé. L’Europe se perçoit comme le berceau des musées – Krzysztof Pomian le fait naître à Rome au début du XVème siècle, d’autres rappellent que museion est le nom du temple dédié aux muses, bâti il y a plus de 2000 ans sur la colline de l’Helicon à Athènes – et notre propre organisation, créée il y a juste 75 ans conjointement par les Etats-Unis et la France, est aujourd’hui composée à 84 % de membres européens. Ce ratio impressionnant invite cependant à la prudence, car l’image des « musées européens » au sein du monde muséal n’est pas aussi consensuelle que nous le voudrions. Tout le secteur de la culture est bousculé par des questionnements sur ses fondements-mêmes et sur ses ressorts, celui des musées l’est notamment par les incitations pressantes à clarifier la provenance de ses collections. Les sociologues Vincenzo Cicchelli et Sylvie Octobre nous avertissent : « le monde culturel risque la marginalisation s’il se contente de brandir l’étendard de l’universalisme sans tenir compte des nouvelles préoccupations des jeunes »*. La place des communautés, l’appel à la décolonisation … s’imposent désormais dans toute vision prospective.
Les musées européens ont, dans leur ensemble, traversé la crise sanitaire avec plus de résistance qu’ailleurs. Leurs gouvernements ont pris des mesures protectrices, le « quoiqu’il en coûte » français et le plan de relance européen en sont deux exemples. Aujourd’hui, nombre de musées peuvent rouvrir et reprendre leur activité, alors que dans d’autres régions du monde, le manque de recettes et les départs de personnels entrainent des fermetures durables : en Amérique du Nord, ce sont 13 % des musées qui ne rouvriront pas. En outre, les professionnels européens ont rapidement adopté les innovations numériques émergentes. Sur le continent africain ou dans les petits états insulaires, le numérique est accessible à 5% de la population, rappelle souvent la directrice générale de l’UNESCO…
Face à ces fractures, l’ICOM a mis en place un dispositif de solidarité et ICOM France a co-engagé un cycle de dialogue avec des partenaires d’Europe du Nord et du Sud. Nous le mesurons, le caractère d’organisation professionnelle de l’ICOM a prouvé ici tout sa pertinence. Ce qui lie ses membres, c’est l’aspiration à exercer un métier, leur métier, quelle que soit leur place dans leur organisation, la place de leur organisation dans le monde, le domaine muséal concerné. Ce lien, celui de la compétence et de la volonté d’exercer, c’est ce que reprend le Code de déontologie adopté par les 50 000 adhérents des 135 pays membres. De professionnalisme, les musées en Europe sont largement pourvus, du fait de systèmes de formations et de qualification de haut niveau, d’une place de la recherche en leur cœur et de l’excellence des pratiques de conservation et de restauration. Le débat de décembre, au sein et avec l’Inp, vise à le cerner et à renforcer les comparaisons internationales. Au sein de l’Europe, l’enjeu de mobilité est central ; à l’international, il s’agit de solidarité et de partage : les musées européens, leurs organismes de formation et associations professionnelles ont une force de mobilisation de plus en plus réactive lors par exemple d’événements climatiques, de conflits ou d’accidents.
Penser possible une « Europe des musées » est peut-être audacieux. Pourtant, après ces mois de crise sanitaire et un été d’incendies et d’inondations, la culture apparaît comme centrale pour réparer, reconstruire et redonner sens à la vie collective. « Les musées sont parmi les lieux les plus crédibles », a affirmé le président de l’ICOM en juillet, lors de la réunion des ministres de la Culture préparatoire au G 20 et ses propos ont été retenus dans la déclaration finale. Ce message est encourageant, il est surtout un appel à notre sens des responsabilités. Oui, les musées sont crédibles. Cette confiance oblige les professionnels de musée à l’exemplarité et à la créativité en matière de pédagogie pour sensibiliser et former les citoyens aux enjeux du développement durable.
Le débat sur « l’Europe des musées » s’inscrit ainsi dans une double actualité pour les membres d’ICOM France et pour l’Inp :
- D’une part, appréhender ensemble les enjeux européens,
- D’autre part, se saisir de ce « moment politique » pour exprimer nos attentes en la matière aux dirigeants européens.
* Une jeunesse crispée : le vivre ensemble face aux crises globales, ed. l’Harmattan, cité par Michel Guerrin dans le Monde, 6 novembre "le monde culturel au défi de la jeunesse".
Programme
Ouvertures
- Charles Personnaz, directeur de l’Institut national du patrimoine
- Juliette Raoul-Duval, présidente d’ICOM France
- Terry Nyambe, vice-président d'ICOM international
Intervenants
-
Pauline Chassaing, responsable des relations internationales de l’Institut national du patrimoine;
-
Pierre Chotard, responsable des expositions du Château-musée d'histoire de Nantes
-
Audrey Doyen, docteure en muséologie, chercheuse associée au CERLIS - Université de Paris
-
Vincent Droguet, sous-directeur des collections, service des musées de France, Direction générale des patrimoines, ministère de la Culture
-
Bruno Maquart, président d'ECSITE (réseau européen des musées et centres de sciences) et président d'Universcience
-
Mikael Mohamed, responsable des relations internationales du Mucem - Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée
-
Pia Müller-Tamm, directrice de la Kunsthalle de Karlsruhe
-
Luís Raposo, président d'ICOM Europe;
-
David Vuillaume, président de NEMO (réseau des organisations muséales européennes) et directeur général de l'association allemande des musées
La rencontre sera animée par Alexandre Chevalier, président d'ICOM Belgique et Juliette Raoul-Duval.
Elle sera conclue par Christian Hottin, directeur des études, département des conservateurs de l'Institut national du patrimoine.
