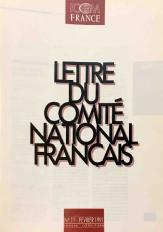Recherche
Résultats de la recherche
2299 résultats trouvés
Lettre de l'Icom France n°2

Editorial
C’est à vous, mes chers et chères collègues, de dire si vous estimez que votre journée du 25 février dernier n’a pas été perdue, si elle a été fructueuse et si vous estimez que cette première tentative doit avoir des suites. Pour ma part, celles-ci devraient revêtir, dans la mesure où vous le jugerez nécessaire, une double forme. En premier lieu, le renouvellement de telles rencontres générales peut être centré sur une ou deux questions du genre de celles évoquées par quelques-uns d’entre vous : la restitution des biens culturels considérés du point de vue des musées français, ou bien l’ouverture professionnelle et sociale du recrutement de l’ICOM. EN second lieu, la prolongation des contacts entre les participants au groupes de travail qui se sont réunis dans l’après-midi du 25 février. Cette prolongation me parait indispensable, tout d’abord pour assurer la participation française à la conférence générale de Londres et au sein de la majorité des Comités internationaux, ensuite parce qu’il est nécessaire qu’en liaison avec l’Association des conservateurs, les responsables des musées de chaque catégorie se connaissent et se rencontrent régulièrement. Il faudrait que dans chaque groupe de travail, un ou deux parmi les participants acceptent d’assurer un minimum de liaison. Je souhaiterais que cet appel soit entendu et que chaque groupe puisse ensuite, à sa propre initiative, se réunir sans attendre d’y être provoqué. De telles rencontres seraient particulièrement opportunes au lendemain des sessions plénières des comités internationaux. Votre bureau exécutif souhaiterait seulement être informé de vos réunions dont je souhaite qu’elles gardent le plus longtemps possible un caractère amical et informel.
En achevant ces quelques lignes, je voudrais renouveler un double appel. Le premier concerne le paiement de vos cotisations. J’ai déjà dit combien le retard d’un nombre important d’entre vous était préjudiciable à tous, puisqu’il diminue sensiblement les moyens d’action de l’organisation internationale et ceux du comité français. J’insiste donc pour que ces retardataires prennent conscience de leur devoir de solidarité à l’égard de leurs collègues. Le second rappel sera pour appuyer les propos de Luis Monreal. Trop peu utilisé par les Français, le Centre de Documentation UNESCO/ICOM regroupe une masse d’informations unique au monde. Il le doit à tous ceux d’entre nous qui, depuis sa fondation, lui ont confié d’innombrables documents, livres, photographies, etc. A cette œuvre coopérative, vous vous devez de participer. Pensez à tous nos collègues du monde entier !
Jean Faviere
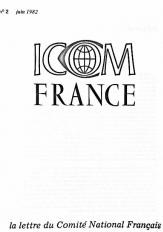
Lettre de l'Icom France n°3

Editorial
Il n’était pas dans l’ordre prévisible des choses que le prédécesseur de Jean FAVIERE à la direction des musées de Strasbourg devînt son successeur à la présidence de la section française de l’I.C.O.M. Ce pas de deux est donc l’effet du hasard et non point de la nécessité. Que cet humour involontaire les conduise tous deux à apprécier le chemin parcouru par l’autre et à œuvrer pour le bien culturel des collectivités qui leur ont accordé leur confiance.
Le nœud des problèmes agités ces temps derniers au sein de l’I.C.O.M. et, partant, de sa section française réside dans une crise de croissance. Constitué au départ de phalanges de professionnels des musées stricto sensu : conservateurs, directeurs, custodes, etc. selon la terminologie propre aux pays concernés, l’I.C.O.M. s’est rapidement étoffé, par à-coups pourrait-on dire, ces à-coups étant provoqués par la proximité des assemblées générales triennales, et au fur et à mesure que les musées recueillaient une plus large audience. Il est certain que la croissance d’un corps organisé modifie les données de départ et remet en cause les modalités de son fonctionnement. Des forces se mettent en jeu qui n’étant pas, de prime abord, investies de la science et conscience initiale, base de la déontologie propre au musée, tendent à infléchir l’esprit et les pratiques de ce corps dans leur propre sens, qui est autre et par conséquent centrifuge. Ces forces sont de deux ordres essentiellement :
1. Celle des spécialistes, regroupés, fort légitimement d’ailleurs dans les divers comités internationaux, lesquels représentent en principe ce que sont les sous-comités dans le cadre d’une association, c’est-à-dire des chambres de réflexion et d’approfondissement des problèmes spécifiques, et des organes de proposition extrêmement utiles, car ils sont à même de répondre techniquement de la façon la plus autorisée et la plus adéquate à la vocation générale de l’I.C.O.M. Mais le penchant des spécialistes n’est-il pas de s’enfermer dans la spécialité et, la communauté des collègues aidant, le penchant du groupe n’est-il pas de se suffire à lui-même et d’oublier un peu de qui il est l’émanation, c’est-à-dire l’I.C.O.M. international ? La section nationale devant demeurer, en tout état de cause, partie informée.
J’ai toujours été frappé de la justesse de cet aphorisme des Pantcha Tantra : la vertu fut une aide, la vertu est l’entrave, applicable à toutes les circonstances. Ainsi, ce qui dans le cadre de l’I.C.O.M. représente une fonction spécifique efficace, risque de devenir un facteur d’affaiblissement, une menace d’éclatement, car la finalité générale de cet organisme tend à être sacrifiée à la finalité spécifique, la fonction mettant en péril l’organe. Un exemple, parmi d’autres, qu’il s’agisse de muséologie, de pédagogie et, singulièrement, d’égyptologie (à ce propos le Comité français élève à l’unanimité de ses membres une protestation contre la création du Comité d’égyptologie, car il existe bel et bien un comité d’archéologie – où s’arrêterait-on dans cette voie ?) : les spécialistes de l’étude scientifique des composantes de l’œuvre d’art ou de l’objet de musée, ainsi que de la restauration n’ont-ils pas de plus en plus tendance à considérer qu’en vertu de leur formation et de leur information scientifiques eux seuls seraient habilités à juger de la valeur intrinsèque des pièces de collection , à l’encontre des historiens d’art, praticiens de nos musées que sont les conservateurs ? Comme si, précisément, l’étude historique, stylistique et morphologique n’apportait pas à la connaissance objective des pièces plus qu’un complément, et indispensable ?
Rigueur des sciences dites exactes – et qui changent ! Opposée à l’esprit de finesse des sciences dites humaines qui s’applique aux problèmes de relations et de causalités historiques ? Des deux côtés la subjectivité est à l’œuvre, immanquablement, de sorte que seule la complémentarité est garante de la vérité la plus approchée.
2. L’autre force centrifuge est constitué par le corps, disparate, de ceux dont les préoccupations essentielles sont extérieures au musée pour le négoce ou pour le faire-valoir. Tout grand corps secrète ses parasites. Que l’on m’entende bien : nombreux sont ceux qui leur profession ne lie pas étroitement au musée, mais qui lui apportent leur soutien, leur foi, leurs lumières, leurs moyens et leur bonne volonté. Ils ont droit à notre reconnaissance, et un article des statuts de l’I.C.O.M. est spécialement conçu à leur bénéfice. Mais ne nous le cachons pas, il y a les marchands du temple, qui font plus qu’envahir les parvis et qui d’une voix empruntée parlent haut et fort. L’I.C.O.M. se doit de les démarquer et de les contenir, faute de quoi la foire s’installe et le patrimoine culturel des nations, présent et à venir, risque d’en faire les frais, car il n’est plus servi, mais asservi. Il importe donc d’être vigilant ; la section française de l’I.C.O.M. est particulièrement sensible à cette question, c’est pourquoi elle a proposé la modification des article 4a et 9 des statuts relatifs à la définition, tant qualitative que quantitative de ses divers membres.
Les sections nationales donnent souvent à penser qu’elles n’existent qu’à l’horizon des assemblées générales. Il est vrai qu’elles n’ont pas l’efficience des comités internationaux. Les rapports triennaux d’activité le révèlent bien. Mais ne seraient-elles que le relais fidèle et constant des informations transmises par l’I.C.O.M., il conviendrait de leur en savoir gré. La section française a noué avec l’Association des Conservateurs des Collections publiques de France un type de relations qui, au-delà de ce rôle d’intermédiaire, devrait assurer une réflexion commune sur des sujets inscrits au programme des rencontres de l’I.C.O.M. Même si les derniers travaux en commun ont été décevants, il y a lieu de persévérer, car ce n’est qu’ainsi que ces rencontres peuvent avoir une portée, des retombées réelles, éprouvées.
Il faut se féliciter de la participation en force des Français à l’Assemblée générale de Londres cette année, malgré une conjoncture financière particulièrement défavorable. Le soutien substantiel de la Direction des Musées de France a pallié heureusement cette carence ; nous lui en sommes vivement reconnaissants. La session de Grande-Bretagne a été révélatrice à bien des égards. Si les discussions, les controverses, les contestations se sont donnée libre cours dans les séances des comités internationaux (çà et là aussi a-t-on pu constater un manque de tonus frisant l’inexistence), cette session a mis en évidence un assez large consensus dans les séances plénières. Comment, à ce stade de promotion de l’I.C.O.M. pourrait-il en être autrement ? Car l’esprit de représentation dont parlais jadis Jean Guéhenno à propos de l’UNESCO et celui de convenance ne sauraient plus être absents d’une aussi haute et large assemblée. L’amabilité et la respectabilité de nos hôtes anglais, l’accueil bienveillant des pouvoirs réservé à un organisme dont, toutes proportions gardées évidemment, ils ne peuvent ignorer l’audience conduisent à observer une certaine discrétion du maintien, au risque de paraître de convention, d’où l’importance pour nous, membres français de l’I.C.O.M., d’être présents partout où des positions sont affirmées et des décisions prises. Ne serait-ce aussi que de ne pas faire oublier, dans le principe et dans la pratique, que le français est une des deux langues officielles de l’I.C.O.M. et doit le demeurer à parité avec l’autre.
Victor BEYER
Président du Comité National Français
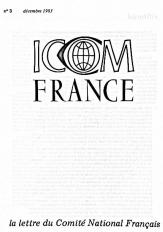
Lettre de l'Icom France n°4

Editorial
Quel profit, quel encouragement peuvent attendre les personnes qui cotisent pour appartenir au Comité national de l’I.C.O.M. ? La question a été posée dans un rapport international. La réponse à cette question est que les objectifs d’une activité souvent dynamique, ne sont pas définis avec suffisamment de clarté. Quelques chiffres, quelques réflexions peuvent nous aider à caractériser la communauté de l’ICOM-France et son activité.
1. Les trois atouts d’ICOM-France
Avec ses 795 membres recensés en 1984, le Comité national français de l’I.C.O.M. est par le nombre, le deuxième Comité national après celui des Etats-Unis. Cette place dénote un intérêt et un dynamisme indéniables des professionnels de musée pour ce qui concerne les multiples aspects de leur activité. Cette situation implique en toute logique, l’existence de moyens financiers et une large représentation française dans les différents Comités internationaux. La réalité est plus nuancée mais le nombre important des membres est quand même une condition favorable au développement de l’ICOM-France.
Créé en 1946, en même temps que l’I.C.O.M. international, le Comité national français compte parmi ses membres, des personnalités qui ont joué un rôle considérable dans l’évolution générale de la conception muséale. Les expressions de ce rôle ont été et sont variées : présidence et autres charges importantes de l’I.C.O.M. international, présidences de plusieurs comités internationaux, participation à la rédaction de multiples documents dont Museum, réalisations de musées ou d’expositions considérées comme des modèles du genre.
La présence du secrétariat-centre de documentation de l’I.C.O.M. international dans les locaux de l’UNESCO à Paris reflète l’intérêt précoce de la France, qui n’a jamais été démenti, pour les problèmes de la conservation du patrimoine et de sa mise en valeur. Le centre de documentation sur les musées est unique en raison de la masse d’informations qu’il peut prodiguer et en raison de l’éventail international de ses sources. Il constitue une grande richesse facilement accessible aux membres français de l’I.C.O.M. L’actualité de l’information est de plus assurée du fait que le centre est en même temps le secrétariat de l’I.C.O.M. international.
2. Qui sont les membres d’ICOM-France ?
Le public d’ICOM-France est varié.
Sur les 795 membres, 508 (soit 63,9%) habitent Paris ou la région parisienne tandis que 287 (soit 36,1%) exercent leur métier en province. Ce dernier pourcentage est faible mais non alarmant. Un effort devra être fait pour mieux motiver nos collègues de province.
La variété des formations des membres de l’ICOM-France est l’une des caractéristiques du Comité national. D’après les statuts, sont réunies toutes personnes des musées, conservateurs des multiples formes de musées, restaurateurs et gens de Laboratoires, responsables des services de documentation, d’animation culturelle, de sécurité, de surveillance… D’autres spécialistes travaillant sous contrat pour les musées peuvent représenter jusqu’à 10% des membres ; ce sont des architectes, des animateurs, des restaurateurs spécialisés et privés… Ainsi, sont réunis des historiens d’art, des historiens, des archéologues, des administrateurs, des juristes, des philosophes, des chimistes, des physiciens, des statisticiens…
Par rapport aux autres Comités nationaux, le Comité français se distingue par le grand nombre de ses membres individuels (746, soit 93,84% du total des membres) ; les 49 membres institutionnels représentent donc 6,16%. Il n’y a pas lieu de réduire l’ampleur de l’engagement individuel mais il faudrait favoriser l’adhésion de membres institutionnels qui représentent davantage l’effort collectif pour de grandes réalisations et la continuité des programmes.
3. Une activité internationale souvent trop timide malgré quelques belles exceptions
Les membres du Comité national ICOM-France sont pour la plupart inscrits dans les groupes de travail des Comités internationaux de l’I.C.O.M. : d’autres participent aux réunions de groupes affiliés à l’I.C.O.M. Quelques-uns contribuent à la réalisation des programmes de sauvegarde du patrimoine de l’UNESCO. Malgré une activité indéniable, les membres du comité français acquièrent une réputation de timidité. Parmi les multiples raisons que l’on peut invoquer, il y a sans doute un problème de langue et la peur d’une spécialisation trop grande de la profession.
D’une part, les deux langues officielles de l’I.C.O.M. sont le français et l’anglais. La défense de la langue française exige de nos jours que l’on comprenne bien l’anglais. Pour intervenir et participer à ses débats, il ne faut pas que le problème linguistique soit un barrage, ce qui est trop souvent le cas malgré les traductions simultanées et les dons linguistiques de certains de nos collègues.
D’autre part, la prise de conscience approfondie des problèmes de musées aboutit à une complexité reflétée par la multiplication des comités internationaux de l’I.C.O.M. et des comités affiliés à l’I.C.O.M. La variété de plus en plus grande des disciplines représentées par les membres confirme cette évolution vers un professionnalisme poussé qui contraste souvent avec la réalité quotidienne qu’elle soit vécue dans un musée de province ou dans un département du Louvre.
Il faut à la fois se réjouir d’une telle évolution internationale qui est accompagnée de compétence et de rigueur et à la fois se préoccuper d’en dominer tous les paramètres, grâce à une coordination et à un effort de synthèse souvent délicats dont les comités nationaux ont été chargés vis-à-vis de leurs membres.
4. Rôle du bureau d’ICOM-France pour faciliter l’effort de coordination internationale
Ce rôle n’est pas réduit à néant comme certains collègues le pensent : il ne faudrait pas non plus l’exagérer. Mais avec quelques moyens financiers que nous voudrions augmenter et de la bonne volonté, nous pourrons régler un certain nombre de vos problèmes.
Pour favoriser la circulation de l’information, la lettre du Comité National Français continuera à être publiée régulièrement pour donner des détails pratiques à la préparation des différentes missions et des chroniques courtes des différentes réunions internationales, points de vue de nos collègues ayant participé à ces réunions. Cette information complètera ainsi celle reçue par nos membres et puisée dans les Nouvelles de l’I.C.O.M. international et dans Museum. Elle facilitera aussi la consultation du centre de documentation de l’I.C.O.M. international.
Nous faisons notre possible pour faciliter les missions de nos collègues qui font des communications dans les différents comités internationaux et nous intervenons dans l’organisation en France de telles réunions. Le détail de cette activité sera donné lors de la réunion de l’Assemblée générale du 31 Janvier 1985 qui se tiendra à l’UNESCO à la suite des journées d’étude de l’Association des conservateurs. Le choix du lieu de la réunion souligne l’optique internationale de notre activité. Le lien avec l’Association des conservateurs est à nouveau affirmé.
Nous voudrions aussi entreprendre une politique d’échange avec certains pays. Un accord est à l’étude avec le comité national soviétique pour des missions de collègues soviétiques en France et de collègues français en U.R.S.S. Les Etats-Unis envisagent également un tel programme. Ainsi le Comité français pourrait contribuer à développer la vocation internationale essentielle de l’I.C.O.M.
Jean-Pierre MOHEN
Président du Comité national français
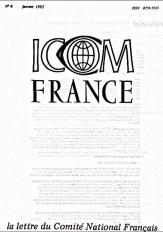
Lettre de l'Icom France n°5

Editorial
L’ICOM et l’UNESCO
Si nous sommes réunis ici, ce n’est pas pour bouder l’Association des Conservateurs aux activités de laquelle participent beaucoup d’entre nous. Il y a donc un lien naturel entre cette association et le Comité national de l’ICOM que nous aurons l’occasion de développer. Mais il existe aussi des affinités entre l’ICOM et l’UNESCO qui sont peut-être moins bien perçues ; elles sont toutefois importantes pour notre Association et sont définis par les statuts et par les faits.
L’ICOM, est l’organisation internationale, non-gouvernementale et professionnelle, représentative des musées et de la profession muséale. Il est à ce titre en relation étroite de consultation et de coopération avec l’UNESCO (extrait article 6 des Statuts de l’ICOM).
L’ICOM est donc une organisation indépendante (subventions de l’UNESCO représentent 12% du budget de l’ICOM) qui entretient des liens privilégiés avec l’UNESCO et j’aimerais rappeler quelques-uns des aspects de cette collaboration.
Le secrétariat de l’ICOM assiste le secrétariat de l’UNESCO dans la réalisation de son programme concernant les musées. Auprès de l’UNESCO et de ses Etats membres, l’ICOM joue un rôle consultatif. A leur demande, il leur apporte informations et études, se charge de missions. Mais nombre de sujets de cette demande ne sont que l’écho de conceptions développées par les professionnels rassemblés dans l’ICOM, lequel a toujours joué un rôle déterminant dans l’élaboration net la mise en œuvre des actions de l’Unesco dans le domaine des musées : échanges internationaux ; lutte contre le trafic illicite des biens culturels par exemple.
L’assistance professionnelle de l’ICOM peut intéresser de nombreux domaines : programmation architecturale, expositions et différents services comme formation du personnel, méthodes de gestion, de documentation, de présentation, de conservation…par exemple la rénovation des musées du Caire, la création du musée d’Assouan ou l’aménagement du musée national du Koweït. Exposition pour la sauvegarde de Mohenjo-Daro etc… l’UNESCO lance par exemple un appel pour recruter un spécialiste de muséologie pour le Centre régional de formation en muséologie de Niamey, Niger.
Créé en 1946 par l’UNESCO, le centre de documentation UNESCO-ICOM a constitué un fonds documentaire concernant les musées, la profession et les techniques muséales, sans équivalent au monde. La documentation ainsi rassemblée, mise à jour, progressivement informatisée est tenue à la disposition de tous les professionnels.
L’ICOM collabore aussi à la préparation de Museum, revue trimestrielle de l’UNESCO dont il assure la diffusion à les ses membres.
Deux organisations internationales entretiennent des relations similaires avec l’UNESCO et avec l’ICOM, l’ICCROM dans le domaine de la préservation et de la conservation et l’ICOMOS dans celui des monuments et sites. L’informatisation des différents fonds documentaires de ces organisations aboutit à la création d’un réseau UNESCO-ICOM-ICOMIS6ICCROM et à l’établissement d’une banque de données concernant la sauvegarde du patrimoine culturel.
C’est dans ce contexte général, qu’il faut situer l’action de l’ICOM, de ses comités internationaux spécialisées et de ses comités nationaux dont le nôtre.
Jean-Pierre Mohen
Président du Comité national français
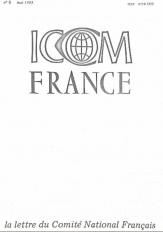
Lettre de l'Icom France n°6

Editorial
Le Comité National de l’ICOM et l’essor des musées en France
Depuis quelques années, depuis 1977 par exemple, année de l’inauguration du Centre Georges Pompidou à Beaubourg, l’intérêt porté aux musées est de plus en plus manifeste : intérêt des responsables des collectivités aussi bien que du public. Cet essor modifie progressivement dans son dynamisme l’idée même de musée à laquelle nous devons nous adapter.
Quelques évènements marquent ou marqueront le développement des musées dans notre pays : l’éclosion des écomusées, comme ceux des Fournies –Trélon et de Lewarde (Nord), d’Inzinzac-Lochrist près de Lorient (Morbihan), d’Alès (Gard), de St Etienne (Loire), de Buffon (Côte d’Or) etc., les inaugurations du musées Picasso à Paris, de celui de Carnac ou de celui d’Evreux.
Très bientôt, nous pourrons visiter les nouvelles salles du château de Versailles (musée de l’histoire de France) et du château de Fontainebleau. Le musée du XIXe siècle à Orsay, l’original établissement de la Villette, le prestigieux Grand Louvre sauront chacun attirer des publics curieux et passionnés dans un futur proche. D’autres musées vieillis seront refaits comme ceux qui dépendent du ministère de l’Education nationale.
Parallèlement à ces créations, la fréquentation du public augmente non seulement pour les célèbres expositions du grand Palais, qui font venir par voyages collectifs spéciaux les amis des musées de villes provinciales lointaines, mais pour les musées en général et leurs diverses manifestations (expositions, ateliers, conférences, voyages…). Un effort particulier concerne le jeune public pour lequel les visites spéciales sont souvent préparées, des enquêtes et des ateliers proposés. Les services d’actions culturelles qui prennent en charge ces activités se développent et font circuler des expositions itinérantes et des valises pédagogiques. Les services commerciaux, comme ceux de la Réunion des Musées nationaux et d’autres, assurent par leurs éditions, leurs moulages, leurs copies une large diffusion des œuvres de musée.
Plus discrètement mais de manière toute aussi efficace, les centres de documentations qui ont décidé de s’informatiser (adoption du système Mistral) gèrent une information continuellement enrichie et abordable d’ores et déjà grâce à des terminaux dans vingt-cinq villes du territoire. Les laboratoires de restauration récemment installés, occupent les vastes écuries royales de Versailles ; le laboratoire de recherche des Musées de France déjà bien équipé attend son « accélérateur » qui sera mis en place dans des locaux conçus dans le programme du grand Louvre.
Mais en même temps la vocation pédagogique de l’Ecole du Louvre est amplifiée: une école supérieure des musées en complète maintenant son enseignement : elle est destinée à la formation de ceux qui ont passé le concours, en cours de réforme, des musées nationaux et de celui des musées classés et contrôlés, en cours de mise au point.
Les musées cherchent encore à clarifier leurs relations avec des administrations voisines et complémentaires comme la sous-direction de l’archéologie (problèmes de dépôts de fouilles et des musées) ou avec le monde contemporain et ses entreprises comme l’attestent, par exemple, l’exposition Les Immatériels présentée à Beaubourg.
Ce ne sont que des aspects du dynamisme actuel de l’activité des musées tel qu’il est apparu aux yeux du grand public à travers toute la France, lors de La ruée vers l’Art en novembre dernier, dit le mois des musées et des arts plastiques suscité par le Ministère de la Culture. Le supplément au bulletin trimestriel de l’association générale des conservateurs des collections publiques de France s’en est fait l’écho en traitant les musées aujourd’hui.
Nous avons été sensibles au sein du Comité national français de l’ICOM à deux aspects particuliers de cette évolution :
- Les demandes d’adhésion sont de plus en plus nombreuses et elles émanent de personnes aux formations variées. Cet apparent éclatement de la profession nous a obligés à recruter nos membres en fonction d’une notion à la fois souple et réaliste de la profession «muséale» : celle-ci est caractérisée plus par l’activité (exercice de la fonction à un haut niveau de compétence) que par le titre ou même une formation ancienne. Des domaines comme celui des études scientifiques très poussées concernant tant les collections elles-mêmes que les microclimats, ou comme celui de l’animation prennent une importance accrue dont il faut tenir compte. De marginaux au départ, ces domaines s’intègrent maintenant dans la dynamique globale des musées.
- L’accroissement des établissements assimilés à des musées et celui des personnels, la variété des financements des différentes opérations entraîne des cloisonnements qui existaient déjà mais qui s’accentuent. L’information trop riche et trop diversifiée circule mal. Plusieurs e nos collègues ont fait part de leur isolement; pourtant ils sont des collègues qui s’occupent des mêmes problèmes et qui éprouvent eux aussi le sentiment de solitude. Les comités internationaux proposent les rencontres que certains réclament. Qu’ils se renseignent: le grand rassemblement que constitue la réunion générale de l’ICOM, peut être aussi l’occasion de confronter d’une manière plus globale des expériences et de réfléchir sur ses propres activités. Nos collègues étrangers sont très curieux de savoir ce qui se passe chez nous en ce moment et ils ont de leur côté beaucoup à nous apprendre. Je vous invite donc à préparer activement le voyage de Buenos Aires (26 octobre – 4 novembre 1986). De notre côté, nous avons entrepris des démarches pour vous faciliter cette préparation.
Jean-Pierre Mohen
Président du Comité national français
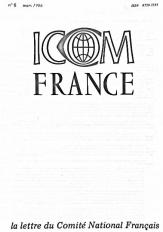
Lettre de l'Icom France n°7

Editorial
L’effet Buenos Aires
Une Conférence générale est toujours mobilisatrice. Celle de Buenos Aires a d’abord surpris les membres du Comité français. L’éloignement de l’Argentine, la méconnaissance réelle de ce pays malgré une idée un peu mythique que chacun pouvait s’en faire, la crainte d’une mission financièrement difficile ont été des arguments très rapidement perçus que le bureau du comité national a essayé de dissiper progressivement. Le thème de la Conférence Musées et avenir du Patrimoine : état d’urgence a été largement compris non seulement par les membres du comité international plus directement concerné, celui de la Conservation mais par beaucoup de membres des autres comités. Le comité de Conservation, avec son président Christian LAHANIER du Laboratoire de Recherche des musées de France, a d’ailleurs multiplié les réunions de travail et les contacts pour définir la richesse du thème proposé. En même temps, les demandes de crédits pour accorder des bourses étaient progressivement suivies de prudentes promesses faites par la Direction des musées de France, par la Ville de Paris, par différents Ministères dont le Ministère des affaires étrangères, par différentes collectivités territoriales. Des conditions avantageuses de voyage étaient accordées par l’Argentine et l’agence Transtour prenait en main l’organisation du séjour. Les premières circulaires ont pu être envoyées. Puis, une seconde. Quatre-vingt-six de nos membres ont finalement pu se libérer pour participer aux travaux de la Conférence générale de l’I.C.O.M. et pour découvrir l’Argentine. La curiosité de prendre contact pour la première fois pour beaucoup d’entre nous, avec l’hémisphère Sud et plus spécifiquement, avec cette partie du monde où le patrimoine et le domaine intellectuel comptent beaucoup, l’a finalement emporté sur les difficultés de préparation de la mission. En nombre, nous étions la troisième représentation nationale, après celle de l’Argentine et celle des USA. Seuls les pays africains et extrême orientaux n’avaient que peu de délégués malgré les bourses accordées par l’I.C.O.M. international et la fondation I.C.O.M.
L’activité du Comité de Conservation a été particulièrement remarquable. L’exposition de panneaux faite sur le thème de la Conférence pour Buenos Aires circula à travers l’Amérique du Sud et sera présentée en Septembre 1987 à Sydney en Australien lors de la prochaine réunion de ce comité. La Conférence de Buenos Aires a eu pour résultat de recruter 110 nouveaux membres pour ce comité, soit un gain de 20%. Le compte-rendu de Christian LAHANIER, qui suit, est révélateur.
D’autres comités internationaux ont montré leur dynamisme comme le CECA ou l’ICMAH, le comité de muséologie ou celui d’Art appliqué. Ils reflètent les secteurs en mouvement des musées à travers le monde. En règle générale et les motions qui ont été adoptées le confirment, la responsabilité des musées en matière de patrimoine est mieux perçue tant des autorités gouvernementales que des personnels des musées même. Ainsi la vocation muséale s’élargit avec l’accord de la majorité des membres de la profession. Les problèmes posés au comité national français par l’ouverture de l’I.C.O.M. aux différents secteurs d’établissement comme le Centre Pompidou ou la Cité des Sciences de la Villette, se retrouvent dans d’autres pays et les positions que nous avons prises de tenir compte davantage des activités que des formations d’origine intéressent nos collègues. Pour développer l’esprit I.C.O.M. et assurer une sorte de formation continue, les français ont proposé à l’I.C.O.M. international de préparer une série de publications les manuels I.C.O.M. qui devraient être complémentaires des Nouvelles de l’I.C.O.M.
Il convient de remercier les organisateurs argentins et ceux du secrétariat de l’I.C.O.M. international d’avoir pu créer les conditions les plus favorables pour que chacun trouve un écho de ses préoccupations, dans cette vaste rencontre qui a rassemblé près de 1 500 personnes.
Nous avons appris que la réussite de la conférence avait aussi sensibilisé le gouvernement argentin qui a créé un nombre important de postes pour les musées et envisagé sérieusement le projet de laboratoire au service du patrimoine.
Dans le contexte argentin très francophile, les participants français ont compris leur responsabilité internationale – tant sur le plan des musées que sur le plan intellectuel en général – ce recul géographique que le voyage à Buenos Aires nous a procuré, a été pour beaucoup d’entre nous, un stimulant.
Jean-Pierre MOHEN
Président du Comité national français

Lettre de l'Icom France n°8

Editorial
Le mot du président :
Je voudrais aujourd’hui, si vous le voulez bien, rappeler ce qui fait la richesse de l’ICOM, dire l’importance qui s’attache à son action.
En adhérent à l’ICOM a titre individuel ou par le biais d’une institution vous avez voulu marquer votre appartenance à la communauté muséale internationale. C’est déjà un premier point, et quand bien même l’ICOM ne serait qu’un lieu où l’on est amené à rencontrer des collègues de tous pays, à lier des relations amicales, à mieux se connaitre, il serait utile.
Mais l’ICOM est bien plus que cela. Il est le lieu de réflexion, de recherche, d’échange d’expériences et il faut insister sur l’importance du rôle que jouent dans ce domaine, les comités spécialisés.
Encore trop nombreux sont ceux d’entre nous qui ne sont pas inscrits à ces comités. Pourtant c’est là, dans une cadre plus restreint que celui de la conférence générale, que s’effectue le travail fondamental. Les réunions dans tel ou tel pays permettent également de connaître des collections, découvrir des coulisses de musées, d’échanger des informations et des conseils.
Le comité national français a pu constater que, dans certains comités, notre pays n’était pas assez représenté par des professionnels actifs participant régulièrement aux réunions. Je pense notamment aux comités Beaux-Arts, Egyptologie, formation du personnel musées littéraires, musées régionaux…
Il y a lieu de rappeler, d’ailleurs, que, si l’on peut voter dans un seul comité, l’on peut appartenir à plusieurs d’entre eux. Pourquoi ne pas suivre les travaux à la fois d’un comité concernant le type de collection sur lesquelles nous travaillons et un comité s’intéressant à une préoccupation générale (éducation, restauration, documentation) ? Sachez en tout cas, que, dans la mesure de ces moyens, le comité français fera tout pour vous aider à vous rendre aux réunions des comités internationaux. Dans la mesure de ses moyens. Dans la mesure et dans la limite, car quelle est la situation financière du comité français ? Quelle est celle de l’ICOM en général ?
Le commandant Bellec et Jean Pierre Mohen vous en parlerons tout à l’heure. Je peux simplement dire que, si le payement des cotisations est capital pour l’ICOM international, dont la situation est particulièrement difficile, la part qui revient au comité français est très faible, 10%, et ne saurait constituer le nerf de la guerre qui nous est nécessaire. L’importance de la subvention de la Direction des musées de France est donc primordiale pour nous et nous devons nous réjouir qu’ICOM-France ait poursuivi avec M. Chevillon les bonnes relations entretenues avec M. Landais . Nous lui sommes particulièrement reconnaissants de son aide importante. Nos moyens nous ont en tout cas permis de participer à l’accueil des collègues étrangers en France, notamment pour les réunions du CECA, du comité pour les relations publiques et du comité consultatif. Nous avons pu également aider un certain nombre d’entre vous à se rendre aux réunions de comités internationaux, particulièrement l’important comité pour la conservation qui s’est réuni à Sydney en septembre.
Je voudrais que vous sachiez que le comité français fera ce qui est en son pouvoir pour faciliter les relations internationales, entre professionnels, des musées. Nous sommes prêts à apporter une aide, là où aucune ressource n’a pu être dégagée, à faciliter les contacts.
C’est ce que nous voulons faire en soutenant le projet de colloque européen « télévision musées » dont j’ai demandé à Simone Blazy de vous parler tout à l’heure.
La vocation du comité français de l’ICOM est de faciliter les rapports avec nos collègues étrangers, d’être des partenaires dans les dialogues internationaux et crois que, dans ce domaine, il ne faut pas hésiter à faire appel à nous. Je suis personnellement prêt, avec le bureau exécutif, à intervenir auprès des comités nationaux étrangers pour tenter de régler les problèmes qui pourraient exister (prêts, échanges…). Sachez également que l’ICOM est appelé à collaborer à de grandes entreprises internationales, UNESCO, patrimoine mondial, et à apporter à ces organismes et réalisations la part originale et irremplaçable du monde des musées.
Il y a beaucoup à faire dans tous ces domaines que je viens d’évoquer, il reste beaucoup à faire. Qu’il ne soit pas dit que notre génération de professionnels des musées n’aura pas su saisi les chances des relations internationales, n’aura pas su, à travers elles, s’enrichir, mieux connaître, et mieux faire connaître notre patrimoine muséal.
Vous le voyez, l’ICOM bouge et désire apporter sa pierre à tout ce qui bouge dans les musées en France, dans leurs entreprises à caractère international. Mais son dynamisme est le vôtre. Ne l’oublions pas. A vous de dire ce que sera demain la collaboration internationale dans le monde des musées (Extrait d’allocution lors de l’Assemblée générale du comité français).
Jacques Perot

Lettre de l'Icom France n°9
Lettre de l'Icom France n°10

Editorial
Un nouveau départ ? C’est la question que l’on se pose à chaque changement d’équipe dirigeante. C’est celle qu’on peut se poser après les élections tenues lors de la dernière conférence générale à la Haye, en septembre 1989. Un nouveau départ ? Un changement en tout cas. En effet, pour la première fois l’ICOM se choisit un président africain, le Malien Alpha Oumar Komaré. A travers lui, c’est certes un nouveau continent, un nouveau type de pays qui entre de plain-pied dans notre ONG. C’est aussi un francophone convaincu que l’universalité et le rayonnement de l’ICOM ne peuvent passer par la victoire d’une langue de travail de l’organisation sur les autres. Mais c’est également la prise en mains des rênes de l’ICOM, par un homme ouvert, efficace, aux méthodes résolument de notre temps. Paradoxalement son éloignement –il réside à Bamako- impose un aggiornamento des méthodes du secrétariat qui, travaillant avec rigueur en liaison régulière avec le président, devrait redevenir l’un des moteurs de l’ICOM accompagnant, voire suscitant les activités des différents comités nationaux et internationaux. Une meilleure organisation lui permettra de montrer son dynamisme et sa compétence.
Au nouveau président, aux nouveaux membres élus du Conseil Exécutif, au secrétariat général, tous nos vœux pour cette nouvelle période de la vie de l’ICOM. Qu’ils sachent que le Comité français est prêt à apporter son soutien aux grandes actions de l’ICOM. Nous sommes d’ailleurs persuadés que ce climat de confiance est réciproque et que l’ICOM est conscient des liens historiques qui le rattachent à la France. C’est d’ailleurs ce dont Alpha Konaré a voulu témoigner le 6 décembre 1989 en venant présenter, au Louvre, où fut fondé l’ICOM en 1946, le plan triennal de l’organisation devant les représentants des grandes organisations internationales.
Et notre comité ? Lui aussi change. Les dernières élections ont amené cinq nouvelles personnalités à son bureau : un vice-président a été élu, Jean-Yves Marin ; un nouveau secrétaire général, Catherine Arminjon et un nouveau trésorier, Charles Penel, qui prend la suite du Commandant Bellec auquel nous voulons rendre hommage pour son dévouement au Comité français. Ayant accepté de poursuivre ma tâche pour trois années, répondant à une confiance qui me touche et m’oblige, j’ai souhaité que nos méthodes de travail s’améliorent, que chaque membre du bureau exécutif soit de plus en plus investi dans ses activités.
Il en est de même pour chacun de vous. Votre participation est encore trop faible dans de nombreux comités internationaux. Et pourtant il en va de notre enrichissement personnel ou du rayonnement international de l’action que nous menons tous dans le domaine des Musées. Sachez que le Comité français considère ce point comme prioritaire et vous aidera dans la mesure de ses moyens, ceux forts modestes qui proviennent de vos cotisations dont seulement 10% restent au Comité français, et ceux plus généreux provenant de nos partenaires privilégiés auxquels nous exprimons notre gratitude, la Direction des Musées de France et la Ville de Paris.
De même, le Comité français se préoccupe d’échanges entre collègues français et étrangers. De tels échanges ont été rendus possibles avec l’U.R.S.S., la Pologne et la Hongrie avec les Comités desquels nous avons signé des accords. Cette politique doit se poursuivre et s’amplifier. Désirant nouer des liens avec la Tchécoslovaquie nous avons invités deux collègues de Prague à participer aux travaux du Comité des musées d’art appliqué réuni à Paris fin mai 1990. Le Comité français prend part également au programme Musées sans frontières lancé conjointement par l’Ecole du Patrimoine, l’ICOM et Air France. Sachez que dans ce cadre comme dans celui de nos protocoles avec les pays de l’Est vous pouvez poser votre candidature à des échanges.
Une dernière action également dans la ligne des préoccupations de l’ICOM est d’organiser un colloque biennal. Au colloque de Bordeaux en 1989 qui a permis de confronter les opinions des représentants des différentes professions impliquées dans le marché de l’art sur le problème de l’exportation des œuvres d’art succèdera, en 1991, un autre colloque sur le problème de l’édition au musée. Catherine Arminjon chargée de sa coordination sera heureuse de recevoir vos suggestions à ce sujet.
Un nouveau départ pour l’ICOM ai-je écrit en tête de cette lettre. Sans doute, pour ce qui concerne l’organisation dans son ensemble, et nous l’espérons bien. Mais pour le Comité français cela ne dépend en grande partie que de chacun de vous. Certes nous poursuivons et amplifions notre activité. Mais ne nous laissez pas seuls.
Jacques Perot
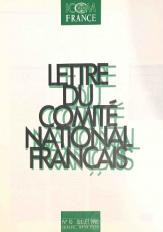
Lettre de l'Icom France n°11

Editorial
PRO MUSEIS
Au moment où nous écrivons ces lignes, un conflit armé embrase une partie du monde. Il ne nous appartient pas, à nous membres de l’ICOM, et nous nous garderons de le faire, de porter un jugement sur cette confrontation. Notre souci, le souci du Comité Français comme celui des autres membres de l’Organisation internationale des musées, ne peut être que celui des professionnels de musées, celui des collections dont ils ont la charge, à quelque pays qu’ils appartiennent.
Notre souhait est d’assurer de notre solidarité tous ceux qui œuvrent pour faciliter l’exercice plénier des responsabilités des uns pour la préservation des collections muséales qui sont notre patrimoine commun.
Notre référence reste le Code de déontologie de l’ICOM et les textes internationaux relatifs à la protection des biens culturels en cas de conflits armés. Que tous nos collègues étrangers sachent que, dans le domaine qui est le nôtre, nous ne pouvons envisager les relations entre nous que sur le plan de l’amitié, de la solidarité professionnelle et de la coopération.
Partout dans le monde, y compris dans les pays qui n’y sont pas directement impliqués, ne laissons pas cette guerre servir de prétexte à la division du monde des musées, au repliement sur soi. Et ceci vaut aussi bien pour les échanges et les réflexions communes que pour les collaborations à des expositions, que ce soit dans le domaine scientifique ou celui des prêts d’œuvres, toujours cependant, dans le respect des conditions de sécurité des personnels et des collections.
Tel est le message que nous voulons faire parvenir à tous nos collègues.
Tardifs mais encore plus d’actualité, mes vœux, ceux du Comité Français de l’ICOM, s’adressent à chacun des membres de l’Organisation, français ou étrangers, pour eux-mêmes et leur famille, pour leur activité professionnelle, pour les parcelles de patrimoine qu’ils ont la charge de préserver et de transmettre.
Jacques Perot