
Recherche
Résultats de la recherche
2299 résultats trouvés
Prenez le pouls de votre public grâce à l’étude Sentomus
Prenez le pouls de votre public grâce à l’étude Sentomus
Francis de Bonnaire, responsable du projet "Sentomus", étude européenne d'audience des musées, est le premier invité de notre cycle en 2025 ! Cette session de rentrée des 52 minutes d'ICOM France se tiendra le jeudi 30 janvier à 12h30 en ligne.
Le projet de recherche sur les publics à grande échelle "Sentomus" a permis de sonder les visiteurs de musée de manière accessible et pragmatique au cours de l'année 2023 et 2024. Plus de 150 musées ont participé à cette étude indépendante développée à échelle européenne. Francis de Bonnaire vient en présenter les conclusions.
Comment les publics vivent les différents aspects du musée ? Comment les visiteurs perçoivent-ils l'offre, les expositions et les activités ? Quelle est l'efficacité de votre marketing et de votre communication pour atteindre votre public cible ? Quel est l'impact du musée sur le bien-être du visiteur? Tels sont, parmi d'autres, les questions qui ont été posées aux visiteurs au cours de l'enquête.
Après une première édition réussie, l'étude sera de nouveau proposée aux musées français en 2025.
Elle sera mise à disposition en tant qu'outil fixe, que les musées pourront utiliser de manière ad hoc ou permanente.
La séance sera modérée par Florence Le Corre, secrétaire d'ICOM France.
Vous trouverez toutes les informations sur l'étude à l'adresse suivante :
Rendez-vous à 12h30 en ligne pour suivre la rencontre
ID de réunion: 827 6306 6925
Code secret: 379047
Qui est Francis De Bonnaire ?
Francis De Bonnaire est Senior Project Manager pour le projet de recherche muséale Sentomus. Avec plus de 12 ans d'expérience en études de marché professionnelles, il s'est notamment spécialisé dans le secteur culturel. Il a dirigé plusieurs projets de recherche d'envergure dans le secteur des musées et des bibliothèques en Europe, en collaboration avec différentes universités.


Documentation muséale et technologies de l’information
Le CIDOC, comité international pour la documentation de l’ICOM vous invite à une journée d’études pour découvrir ou redécouvrir ses projets visant à promouvoir et outiller le rôle de la documentation au sein des musées. Cette journée sera également l’occasion de faire un point d’étape sur l’intelligence artificielle dans le secteur muséal au travers de quelques projets français récents ou en cours dans ce domaine.
Programme
- 9:30-10:00 Accueil café
- 10:00-10:10 Valérie Guillaume (ICOM France), mot de bienvenue.
- 10:10-11:25 Trilce Navarrete, Matthieu Bonicel, Nicholas Crofts (CIDOC), le comité CIDOC et ses projets
- 11:25-11:45 Mélanie Roche (Bibliothèque nationale de France), le modèle sémantique de référence CIDOC-CRM
- 11:45-12:10 Angelina Meslem (Ministère de la culture), De l’usage d’Opentheso au schéma Lido : des perspectives concrètes d’amélioration des données du Catalogue collectif des musées de France.
- 12:10-12:30 Questions
12:30-14:00 Déjeuner (libre)
- 14:00 - 15:30 Focus intelligence artificielle
- 14:00-14:20 Emmanuelle Bermès (École nationale des chartes) et Marion Charpier (Musée des Arts décoratifs), L'IA entre au musée ? Retour d'expérience du projet TORNE-H avec le Musée des Arts Décoratifs.
- 14:20-14:50 Rodolphe Bailly (Philharmonie de Paris) L'IA pour l'assistance à la recherche documentaire : retour d'expérience à la Médiathèque de la Philharmonie de Paris
- 14:50-15:10 Edouard de Saint-Ours (Musée Guimet), Mélodie Boillet (TEKLIA), HikarIA : Exploration d’une collection de photographies anciennes japonaises par IA
- 15:10-15:30 Tiphaine Vacqué (Bibliothèque nationale de France), De l'expérimentation à l'industrialisation : focus sur 4 projets IA à la Bibliothèque nationale de France
- 15:30-15:45 Questions
15:45-16:15 Pause café
- 16:15-16:35 Emmanuelle Delmas-Glas (Yale Center for British Art) -en visioconférence-, Linked Art à l'université de Yale: un modèle pour connecter les collections.
- 16:35-17:10 Table ronde, Les enjeux de l’intelligence artificielle (tous les intervenants)
- Modération et synthèse : Romain Delassus & Aurélien Conraux (Ministère de la Culture)
- 17:10-17:30 Conclusion, perspectives
Informations pratiques
Lieu du colloque : Musée Guimet Hôtel d’Heidelbach (19 avenue d’Iéna, Paris 16e)
Date et horaire : Vendredi 24 janvier 2025. 9H30 – 17H30
Entrée gratuite sur inscription
Personne à contacter pour toute demande :
Matthieu BONICEL, membre du bureau du CIDOC pour le développement de la communauté francophone.
mbonicel@acgparis.fr
ICOM COSTUME présente ses meilleurs vœux pour 2025
Musées et culture en transition
Résumé
Depuis environ trente ans, le secteur des arts, du spectacle, de la culture et de nombreux musées ont déjà entrepris des actions en faveur du développement durable comme cela avait pris forme au début des années 2000 avec la Stratégie Nationale de Développement Durable en France (Gagnebien et Nedjar, 2013; Taxopoulou, 2023). Cependant, ces derniers temps, on observe une augmentation significative de l'intérêt porté à la question de la transition socio-écologique et économique, se manifestant par l'émergence de nouveaux discours, la mise en place de nouvelles programmations et l'allocation de ressources financières spécifiques (Müller et Grieshaber, 2024). En parallèle se développent de nouvelles productions scientifiques et de nouveaux mouvements militants et formes d’activisme.
Cet appel à contribution a l’ambition de dessiner les fondements de ce phénomène et d’illustrer les transformations profondes induites par la transition socio-écologique et économique sur la mission des institutions culturelles, leurs valeurs, leurs pratiques ainsi que leur rôle dans une société en mutation.
Il se déclinera en trois axes :
- Le premier explorera des modèles de gestion innovants pour les institutions culturelles en période de transition.
- Le deuxième se concentrera sur l'évolution des pratiques professionnelles.
- Le troisième axe interrogera à la fois la transformation en cours des récits dans leurs activités, l’évolution des modes de participation du public et les défis liées à la légitimité et la position politique des institutions culturelles face à la transition socio-écologique et économique.
Envoi des propositions d’articles
Merci d’adresser vos propositions d’articles (5000 à 7000 signes) par courriel avant le 31 janvier 2025 :
Aude Porcedda : Aude.Porcedda@uqtr.ca
Anne Gagnebien : anne.gagnebien@univ-tln.fr
Avec copie à Eric Triquet : eric.triquet@univ-avignon.fr
Pauline Grison : pauline.grison[at]univ-avignon.fr
Retrouvez l'appel complet ci-contre
"Eco-conservation: preventive conservation in the face of climate change challenges”
Le dossier 61 de la revue Technè a pour thème « Eco-conservation : la conservation préventive face aux enjeux du changement climatique ».
Il s’intéressera à la conservation préventive comme méthode de recherche et outil d’application s’intégrant dans un projet responsable et durable bénéficiant aux biens culturels et aux acteurs qui veillent à leur préservation en contrant les défis contemporains. Ce thème poursuit la réflexion amorcée dans le numéro 34 publié en 2011 et intitulé « La conservation préventive, une démarche évolutive. 1990-2010 ». Trois axes orienteront cette édition :
- S’adapter à un monde changeant
- Réduire l’empreinte carbone
- Construire un monde nouveau
Aujourd’hui est lancé un appel à contributions jusqu'au 20 janvier 2025.
Appel à participation à l’intention des institutions culturelles scientifiques
Dans le cadre du Master en Management Culturel des universités de Lausanne et de Genève en Suisse, une étude est réalisée sur la pertinence de la mise en place d'une plateforme digitale collaborative internationale dans le domaine des expositions. Cet outil viserait à favoriser les collaborations, les échanges de savoirs et de contenus ou de concepts et scénarios d'expositions entre institutions culturelles scientifiques francophones (notamment en France, Suisse, Belgique, Luxembourg et Québec).
Les directions et équipes travaillant au développement des expositions au sein des musées de sciences (au sens large), musées d’histoire naturelle et jardins botaniques sont invitées à remplir le questionnaire et à le partager à leurs réseaux professionnels.
La transition écologique au cœur des politiques du ministère de la Culture
La transition écologique au cœur des politiques du ministère de la Culture
Depuis plusieurs années, le secteur culturel s'est résolument engagé dans une mutation écoresponsable. En cette fin d'année 2024, Karine Duquesnoy, haute fonctionnaire à la transition écologique et au développement durable du ministère de la Culture, propose de faire le point sur les actions menées par le ministère en faveur de la transition environnementale. Cette séance a été l'occasion de présenter les outils mis à disposition des acteurs du secteur muséal, telle la boussole écologique de la culture BouTure, ou des dispositifs légaux qui peuvent être utilisés par les musées (décret Tertiaire)...
La séance a été modérée par Laure Ménétrier, secrétaire d'ICOM France.
Revoir la séance
Qui est Karine Duquesnoy ?
Haute fonctionnaire à la transition écologique et au développement durable du ministère de la Culture depuis 2023, Karine Duquesnoy a occupé de multiples postes au ministère de la Culture (directrice régionale adjointe des affaires culturelles d'île de France ; conseillère sociale et chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes du cabinet de la ministre Audrey Azoulay...)

ICOM France relaie l'appel du BBF en faveur de Mayotte
Suite au passage dévastateur du cyclone Chido, l'île de Mayotte fait face à une situation critique. Outre les dommages matériels et humains, le patrimoine culturel unique de Mayotte, témoin de son histoire et de son identité, a subi des destructions majeures.
Le Bouclier Bleu France, association agréée de sécurité civile spécialisée dans la sauvegarde du patrimoine culturel, lance un appel urgent à votre solidarité.
Les besoins matériels demandés par nos collègues mahorais sont essentiels pour protéger et restaurer ce patrimoine en danger.
Comment contribuer ?
- Dons matériels : Fournitures de conservation, équipements pour sécuriser les collections, EPI. Vous trouverez ci-jointe la liste du matériel indispensable. Un envoi pourrait être possible au début du mois de janvier. Nous savons que cette période de congés représente un défi logistique pour l'acheminement du matériel mais nous serions extrêmement reconnaissants de votre aide pour que le matériel puisse être utile en temps voulu.
- Dons financiers : Nous avons besoin de vous ! Vos contributions permettront d’acquérir le matériel nécessaire manquant et de mobiliser deux experts Bouclier bleu France qui seront missionnés pour intervenir sur place.
Pour faire un don : https://www.bouclier-bleu.fr/adherer#don (Cliquer sur "fonds d'intervention d'urgence du Bouclier bleu France")
Chaque don, qu'il soit matériel ou financier, bénéficie de réductions fiscales conformément à la législation en vigueur.
Pourquoi agir ?
Le patrimoine culturel de Mayotte n’est pas seulement une richesse locale, c’est un bien commun universel. Protéger ces témoignages de notre histoire, c’est préserver l’âme et l’identité d’un peuple, transmettre sa mémoire aux générations futures et renforcer les liens entre nos cultures.
Même le plus petit don compte !
Votre geste, aussi modeste soit-il, contribuera à faire une différence. Ensemble, nous pouvons limiter les dégâts et redonner vie à ce patrimoine si précieux.
Pour l’envoi du matériel ou pour obtenir plus d’informations sur les besoins spécifiques identifiés, vous pouvez :
- Nous écrire à : sru@bouclier-bleu.fr
- Nous appeler : Claire Leger, directrice de la réponse à l'urgence 06 85 95 51 04
Adresse de livraison : Musée de la Résistance et de la Déportation, Claire Leger, 52 allée des Demoiselles, 31400 Toulouse
Nous comptons sur votre générosité et votre soutien pour relever ce défi. L’union fait la force, et c’est ensemble que nous pourrons reconstruire et sauvegarder le patrimoine de Mayotte.

ICOM France présent à Museum Connections
ICOM France sera présent lors du prochain salon Museum Connections le 14 et 15 janvier prochain porte de Versailles
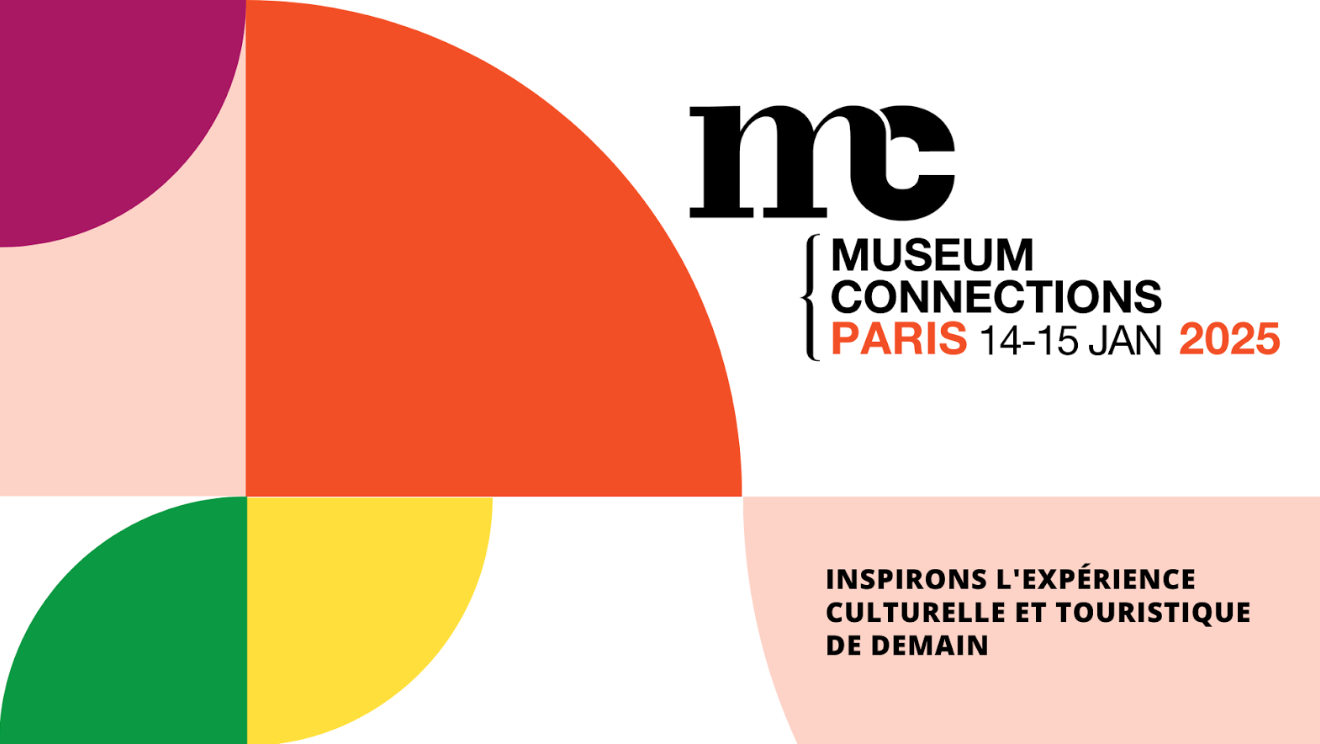
Notre stand sera situé face à l'Inspiration Room (Conférences), en D82.
Emilie Girard, présidente d'ICOM France, interviendra dans la table-ronde "Mener les transitions du point de vue du leadership : focus sur la conduite du changement" le 14 janvier de 14h à 14h45.
Qu'est ce que Museum connections ? Salon professionnel international, résolument tourné vers les enjeux économiques et durables des lieux culturels et touristiques, Museum Connections décode les tendances et les innovations pour inspirer l’expérience culturelle et touristique de demain. Depuis plus de 25 ans, Museum Connections rassemble les professionnels de la médiation, de l’optimisation, et de la création de ressources des musées et lieux culturels pendant 2 jours à Paris.
Guide des conférences ci-contre
ICOM France propose à ses membres de se joindre au salon en bénéficiant d'une entrée gratuite : pour cela, rendez-vous sur le site du salon et utilisez le code ICOM2025
Informations pratiques :
Date et Horaires
Mardi 14 Janvier : 9h30 à 18h30
Mercredi 15 Janvier : 9h30 à 18h00
Lieu
Paris Expo Porte de Versailles - Hall 5.2
1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris, France
Raconter la banlieue - regards croisés
Dans la continuité du cycle des Rencontres professionnelles consacré à l'ambition écologique et solidaire des musées, le cycle “Muséographie pratique” continue !
Un programme simple : des conservateur·rices, des chargé·es d'exposition et des scénographes nous font découvrir les coulisses des projets d'expositions et une méthode active : la visite permet de croiser les regards, des enjeux de récit à leur traduction scénographique.
La FEMS et Les Neufs de Transilie comptent des adhérents dans des territoires très divers, à l’histoire singulière, au patrimoine parfois méconnu. La banlieue est de ceux-là. Nous vous proposons de venir échanger sur les enjeux des musées de société en banlieue ! Quels récits proposer ? Pour quels publics/habitant·es ? Comment les co-construire en mobilisant ce qui a souvent fait leur ADN, tout en croisant les regards de sociologues et d’artistes ?
Date limite pour s’inscrire : 29 janvier 17h
Retrouvez le programme ci-contre






