
Recherche
Résultats de la recherche
2299 résultats trouvés
Scénographier une exposition: «Figures du fou»
Présentation du parcours et de la conception scénographique de l’exposition «Figures du fou. Du Moyen Âge aux Romantiques ».
Avec Élisabeth Antoine König, conservatrice générale au département des Objets d’art du musée du Louvre, commissaire de l’exposition, Nicolas Groult, scénographe chez Scénografiá, et Nicolas Lesur, chef de projet délégué au service des expositions du musée du Louvre.
Entrée gratuite par la porte des Arts du musée du Louvre et sur inscription: Programmation-Centre-Vivant-
Informations pratiques
Centre Vivant Denon – Musée du Louvre
Musée du Louvre, Porte des Arts, 75058 Paris Cedex 01
Journées Nationales d’Étude AGCCPF et l’AMP-BFC
L’AGCCPF et l’association Musées et Patrimoines en Bourgogne-Franche-Comté, association régionale de l’AGCCPF (MP-BFC) annoncent la tenue des Journées Nationales d’Études à Dijon, les 26, 27 et 28 mars 2025.
La thématique à l’honneur, “Musées et monuments historiques”, invitera les participants à réfléchir à la question de l’aménagement de musées au sein d’édifices à la fonction originelle distincte (abbayes, palais civils ou religieux, châteaux, sites hospitaliers et charitables), dans un soucis d’équilibre entre préservation du patrimoine bâti, mémoire des lieux et exigences muséographiques. Plusieurs musées de la région Bourgogne-Franche-Comté illustrent d’ailleurs cette démarche.
Face aux enjeux économiques et climatiques actuels, dans un contexte où la transition écologique s’impose comme une priorité pour les musées, une question cruciale se pose : comment ces monuments historiques, dans leur nouvelle fonctionnalité de protection des collections publiques, peuvent-ils s’adapter aux exigences de résilience et de sobriété énergétique ?
Ces journées se tiendront au sein du Musée de la Vie Bourguignonne de Dijon et seront ponctuées par une journée de visites en région Bourgogne-Franche-Comté.
Formation et Appel à projets européens
NEMO - the Network of European Museum Organisations - soumet deux opportunités de participation à des projets de collaboration transfrontaliers européens
Participer à un projet permet d'acquérir de nouvelles expériences, connaissances et perspectives, ainsi que de tisser des liens au-delà des frontières.
1 ) Proposition de formation axée sur les technologies interactives, l'IA et la durabilité pour la création et la narration numérique culturelle
- Personnes de contact : Paolo Mazzanti (paolo.mazzanti@unifi.it) et Marco Bertini (marco.bertini@unifi.it)
- Date limite pour manifester son intérêt à rejoindre le consortium : 15 décembre 2024.
- Appel à propositions : Programme Europe créative - DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET DES TALENTS (CREA-MEDIA-2025-TRAINING (25 avril 2025).
- En bref : Le Media Integration and Communication Center (MIICC) de l'Université de Florence (Italie) recherche des partenaires pour se joindre à eux afin de dispenser ce cours, qui comprendra des sessions de formation, des études de cas et des ateliers pratiques. Plus précisément, ils recherchent des formateurs pour les activités du programme, des institutions culturelles et muséales pour contribuer à des études de cas réels, des professionnels de l'audiovisuel et des gestionnaires d'archives intéressés par une formation sur ces sujets émergents.
2) Hub DiPA : Musées partenaires recherchés pour des tests d'accessibilité numérique
- Personne de contact : Michele Barghini (michele.barghini@alphabetformation.org)
- Date limite pour manifester son intérêt à rejoindre le consortium : 27 janvier 2025.
- Appel à propositions : Programme Europe créative (CREA) dans le cadre de l'appel à projets de coopération européenne (CREA-CULT-2025-COOP-1) (Q1 2025)
- En bref : Le projet DIPA Tool, développé par la Fondazione Kainon (Italie), vise à développer une plateforme numérique capable d'évaluer et d'améliorer l'accessibilité du contenu numérique dans les musées. Grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle et d'algorithmes avancés, l'outil DIPA fournira aux musées un outil puissant pour rendre leurs collections plus inclusives et attrayantes.
Salon Museum connections
ICOM France sera présent lors du prochain salon Museum connections le 14 et 15 janvier prochain porte de Versailles
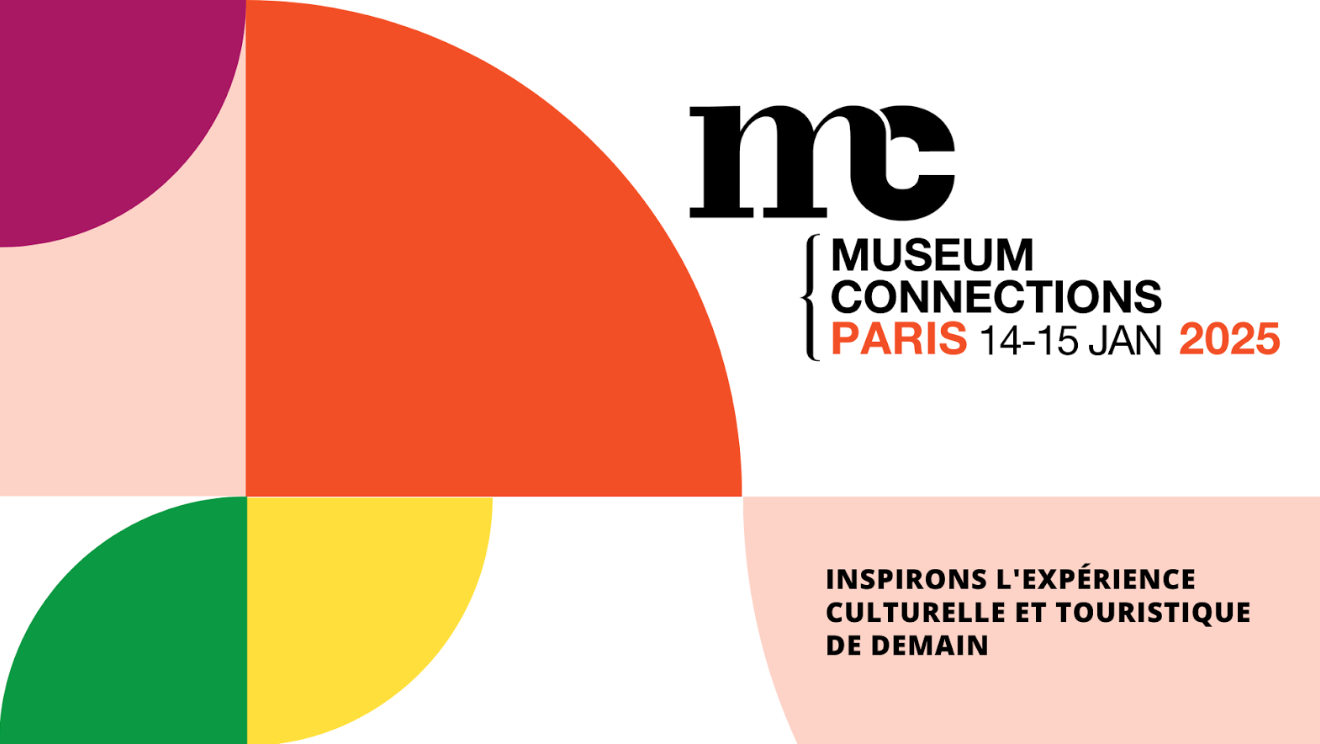
Notre stand sera situé face à l'Inspiration Room (Conférences), en D82.
Emilie Girard, présidente d'ICOM France, interviendra dans la table-ronde "Mener les transitions du point de vue du leadership : focus sur la conduite du changement". Date et horaire à confirmer.
Qu'est ce que Museum connections ? Salon professionnel international, résolument tourné vers les enjeux économiques et durables des lieux culturels et touristiques, Museum Connections décode les tendances et les innovations pour inspirer l’expérience culturelle et touristique de demain. Depuis plus de 25 ans, Museum Connections rassemble les professionnels de la médiation, de l’optimisation, et de la création de ressources des musées et lieux culturels pendant 2 jours à Paris.
ICOM France propose à ses membres de se joindre au salon en bénéficiant d'une entrée gratuite : pour cela, rendez-vous sur le site du salon et utilisez le code ICOM2025
Informations pratiques :
Date et Horaires
Mardi 14 Janvier : 9h30 à 18h30
Mercredi 15 Janvier : 9h30 à 18h00
Lieu
Paris Expo Porte de Versailles - Hall 5.2
1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris, France
Patrimoines et mémoires de l'esclavage : réception et attentes des publics
Patrimoines et mémoires de l'esclavage : réception et attentes des publics
Rencontre animée par Coralie de Souza Vernay, Responsable Patrimoine & Recherche de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage
Les causeurs - contributeur.trices :
- Caroline Creton, MCF en Sciences de l'Information et de la Communication, UCO Nantes et Manuelle Aquilina, MCF en Histoire, UCO Bretagne Sud
- Laurence D'Haene, Chargée du développement et de la politique des publics - Château des Ducs de Bretagne - Musée d'histoire de Nantes
- Isabelle Gard, Chargée du développement des publics – Réunion des Musées Métropolitains - Métropole Rouen Normandie et Mathilde Schneider, Directrice - Musée Beauvoisine, co-commissaires de l'exposition Esclavage, Mémoires Normandes
- Emmanuelle Riand, Directrice - Musées d'Art et d'Histoire Ville du Havre
- Adiva Lawrence, Project Curator - International Slavery Museum - National Museums Liverpool
Patrimoines et mémoires de l'esclavage : réception et attentes des publics
Patrimoines et mémoires de l'esclavage : réception et attentes des publics
Rencontre animée par Coralie de Souza Vernay, Responsable Patrimoine & Recherche de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage
Les causeurs - contributeur.trices :
- Caroline Creton, MCF en Sciences de l'Information et de la Communication, UCO Nantes et Manuelle Aquilina, MCF en Histoire, UCO Bretagne Sud
- Laurence D'Haene, Chargée du développement et de la politique des publics - Château des Ducs de Bretagne - Musée d'histoire de Nantes
- Isabelle Gard, Chargée du développement des publics – Réunion des Musées Métropolitains - Métropole Rouen Normandie et Mathilde Schneider, Directrice - Musée Beauvoisine, co-commissaires de l'exposition Esclavage, Mémoires Normandes
- Emmanuelle Riand, Directrice - Musées d'Art et d'Histoire Ville du Havre
- Adiva Lawrence, Project Curator - International Slavery Museum - National Museums Liverpool
Museum International : Recherche de provenance dans les musées
Museum International Vol. 77 Nº 307-308 « Recherche de provenance dans les musées : Principes, pratiques et possibilités »
Appel à textes
L’ICOM prépare un numéro de Museum International sur la Recherche de provenance dans les musées : Principes, pratiques et possibilités (Vol. 77 Nº 307-308). Tous les résumés d’articles que nous recevrons seront évalués et sélectionnés suivant un processus de relecture anonyme par des pairs. Le numéro devrait être publié fin 2025, en collaboration avec Taylor&Francis/Routledge.
Date limite d’envoi des propositions : 20 janvier 2025
Nous encourageons les propositions d’article mettant en lumière des exemples d’initiatives concrètes et prenant en compte diverses perspectives dans la recherche de provenance et de documentation d’objets dans les musées du monde entier. Ce numéro a pour objectif d’aller au-delà de la perception courante de la recherche de provenance, qui consiste à retracer la propriété et l’histoire juridique des objets, pour parvenir à une compréhension nuancée des histoires sous-jacentes des collections et des contextes historiques des acquisitions. Nous interprétons les termes « objets » et « collections » au sens large pour faire référence aux collections culturelles et d’histoire naturelle, afin de remettre en question la division binaire existante entre la nature et la culture dans les musées.
RECHERCHE DE PROVENANCE DANS LES COLLECTIONS MUSÉALES
Selon les circonstances historiques qui entourent leur acquisition, de nombreux objets ne bénéficient pas d’informations de provenance adéquates qui permettraient de déterminer à qui ils appartiennent ou comment ils sont entrés dans les collections des musées. La question est donc la suivante : comment pouvons-nous retracer la provenance d’objets qui ont été amassés dans le passé et placés dans les musées comme des objets ordinaires, figés dans le temps et sans vie, sans information ni mises en contexte adéquates ? Nous recherchons des contributions théoriques et pratiques qui mettent en lumière des approches guidées par une autorité partagée, une recherche de la vérité et une prise de responsabilité ; trois axes qui seraient envisagés comme des principes pour la recherche de provenance. Les contributions peuvent également porter sur des approches collaboratives liées au traitement des restes ancestraux et des objets sacrés dans les collections des musées, y compris ceux acquis à l’époque coloniale qui ont été pillés, appropriés et enlevés aux descendants des communautés d’origine, en raison de violence historique et d’échanges inégaux. Nous encourageons également les contributions qui considèrent la recherche de provenance comme un processus collaboratif au cours duquel les institutions travaillent avec les diasporas et les communautés de descendants.
De manière générale, ce numéro entend souligner l’importance d’entreprendre une recherche exhaustive sur la provenance en tant que pratique favorisant la production de connaissances avant toute forme de collecte et de restitution.
Nous encourageons toute contribution qui aborde les sujets suivants (cette liste n’est pas exhaustive) :
- Approches théoriques pour comprendre la recherche de provenance et les restitutions
- Approches pratiques de la recherche de provenance
- Histoires des collections et contextes coloniaux
- Collections de musée de provenance inconnue et non-inventoriées
- Les nouvelles technologies dans la recherche de provenance
- Le rôle émergent de chercheur de provenance dans les musées
- Recherche biographique et de provenance en collaboration avec les diasporas et les communautés concernées
- Expériences et actions des communautés dans la réinterprétation des significations des collections muséales lors de recherches de provenance
- Dynamique de pouvoir et inégalités dans la recherche collaborative sur la provenance et la documentation des objets
- Traitement des restes ancestraux et des objets sacrés dans les collections muséales
- Prise de responsabilité, recherche de vérité et ouverture d’esprit dans le cadre de recherches de provenance
- Vers d’autres façons d’être (ontologie) et de faire (axiologie) la recherche de provenance
- Recherche collaborative néocoloniale sur la provenance des objets.
Processus de sélection
Les résumés d’articles, d’environ 300 mots et rédigés en anglais, en français ou en espagnol, doivent être envoyés à publications@icom.museum dans un document Word (.doc). (si vous ne recevez pas de confirmation de réception dans un délai de 2 semaines, il est possible que votre e-mail ne nous soit pas parvenu – n’hésitez pas à nous écrire à nouveau).
Les contributions ne sont pas rémunérées.
Merci d’inclure les informations suivantes dans votre résumé :
- Titre de l’article
- Noms de l’auteur (ou des auteurs)
- Expérience professionnelle
La date limite d’envoi est fixée au 20 janvier 2025.
Les résumés d’articles seront examinés anonymement par le Comité Éditorial.
Museum International est publié en anglais. Toutefois, nous acceptons également des résumés d’articles dans les deux autres langues officielles de l’ICOM (le français et l’espagnol). Si votre résumé est accepté, nous vous enverrons les directives à suivre pour la rédaction de votre article complet. Vous disposerez alors d’approximativement deux mois pour le rédiger et nous l’envoyer. Il vous est possible de rédiger votre texte complet dans l’une des trois langues officielles de l’ICOM, à savoir l’anglais, le français, ou l’espagnol.
Structure attendue d’un résumé d’article
Un résumé d’article, d’une longueur d’environ 300 mots (sans compter la bibliographie sélective), doit donner, de manière succincte, l’essence du propos, et doit pouvoir être lu comme un texte à part entière. Il ne doit pas contenir d’images ni de notes de bas de page et doit être envoyé dans un fichier Word.
Il doit comprendre les sections suivantes :
1/ Introduction : une ou deux phrases qui décrivent le sujet dans son ensemble, y compris le contexte de l’étude présentée.
2/ Une problématique, ou les principaux axes de réflexion qui articulent les différents aspects critiques ou thématiques envisagés dans le texte. Il convient également d’identifier tous les aspects non étudiés précédemment par la recherche.
3/ L’originalité de la démarche adoptée par l’auteur doit être mise en lumière.
4/ La description de la méthode adoptée doit décrire l’approche choisie pour les études de cas, les entretiens, etc. (entre autres exemples).
5/ Une conclusion qui souligne l’impact de cette recherche, et qui expose les raisons pour lesquelles les résultats de la recherche sont importants.
6/ Une bibliographie sélective, citant uniquement les sources principales qui seront citées dans l’article (15 maximum).
7/ Des mots clés (5 maximum).
Museum International : Recherche de provenance dans les musées
Museum International Vol. 77 Nº 307-308 « Recherche de provenance dans les musées : Principes, pratiques et possibilités »
Appel à textes
L’ICOM prépare un numéro de Museum International sur la Recherche de provenance dans les musées : Principes, pratiques et possibilités (Vol. 77 Nº 307-308). Tous les résumés d’articles que nous recevrons seront évalués et sélectionnés suivant un processus de relecture anonyme par des pairs. Le numéro devrait être publié fin 2025, en collaboration avec Taylor&Francis/Routledge.
Date limite d’envoi des propositions : 20 janvier 2025
Nous encourageons les propositions d’article mettant en lumière des exemples d’initiatives concrètes et prenant en compte diverses perspectives dans la recherche de provenance et de documentation d’objets dans les musées du monde entier. Ce numéro a pour objectif d’aller au-delà de la perception courante de la recherche de provenance, qui consiste à retracer la propriété et l’histoire juridique des objets, pour parvenir à une compréhension nuancée des histoires sous-jacentes des collections et des contextes historiques des acquisitions. Nous interprétons les termes « objets » et « collections » au sens large pour faire référence aux collections culturelles et d’histoire naturelle, afin de remettre en question la division binaire existante entre la nature et la culture dans les musées.
RECHERCHE DE PROVENANCE DANS LES COLLECTIONS MUSÉALES
Selon les circonstances historiques qui entourent leur acquisition, de nombreux objets ne bénéficient pas d’informations de provenance adéquates qui permettraient de déterminer à qui ils appartiennent ou comment ils sont entrés dans les collections des musées. La question est donc la suivante : comment pouvons-nous retracer la provenance d’objets qui ont été amassés dans le passé et placés dans les musées comme des objets ordinaires, figés dans le temps et sans vie, sans information ni mises en contexte adéquates ? Nous recherchons des contributions théoriques et pratiques qui mettent en lumière des approches guidées par une autorité partagée, une recherche de la vérité et une prise de responsabilité ; trois axes qui seraient envisagés comme des principes pour la recherche de provenance. Les contributions peuvent également porter sur des approches collaboratives liées au traitement des restes ancestraux et des objets sacrés dans les collections des musées, y compris ceux acquis à l’époque coloniale qui ont été pillés, appropriés et enlevés aux descendants des communautés d’origine, en raison de violence historique et d’échanges inégaux. Nous encourageons également les contributions qui considèrent la recherche de provenance comme un processus collaboratif au cours duquel les institutions travaillent avec les diasporas et les communautés de descendants.
De manière générale, ce numéro entend souligner l’importance d’entreprendre une recherche exhaustive sur la provenance en tant que pratique favorisant la production de connaissances avant toute forme de collecte et de restitution.
Nous encourageons toute contribution qui aborde les sujets suivants (cette liste n’est pas exhaustive) :
- Approches théoriques pour comprendre la recherche de provenance et les restitutions
- Approches pratiques de la recherche de provenance
- Histoires des collections et contextes coloniaux
- Collections de musée de provenance inconnue et non-inventoriées
- Les nouvelles technologies dans la recherche de provenance
- Le rôle émergent de chercheur de provenance dans les musées
- Recherche biographique et de provenance en collaboration avec les diasporas et les communautés concernées
- Expériences et actions des communautés dans la réinterprétation des significations des collections muséales lors de recherches de provenance
- Dynamique de pouvoir et inégalités dans la recherche collaborative sur la provenance et la documentation des objets
- Traitement des restes ancestraux et des objets sacrés dans les collections muséales
- Prise de responsabilité, recherche de vérité et ouverture d’esprit dans le cadre de recherches de provenance
- Vers d’autres façons d’être (ontologie) et de faire (axiologie) la recherche de provenance
- Recherche collaborative néocoloniale sur la provenance des objets.
Processus de sélection
Les résumés d’articles, d’environ 300 mots et rédigés en anglais, en français ou en espagnol, doivent être envoyés à publications@icom.museum dans un document Word (.doc). (si vous ne recevez pas de confirmation de réception dans un délai de 2 semaines, il est possible que votre e-mail ne nous soit pas parvenu – n’hésitez pas à nous écrire à nouveau).
Les contributions ne sont pas rémunérées.
Merci d’inclure les informations suivantes dans votre résumé :
- Titre de l’article
- Noms de l’auteur (ou des auteurs)
- Expérience professionnelle
La date limite d’envoi est fixée au 20 janvier 2025.
Les résumés d’articles seront examinés anonymement par le Comité Éditorial.
Museum International est publié en anglais. Toutefois, nous acceptons également des résumés d’articles dans les deux autres langues officielles de l’ICOM (le français et l’espagnol). Si votre résumé est accepté, nous vous enverrons les directives à suivre pour la rédaction de votre article complet. Vous disposerez alors d’approximativement deux mois pour le rédiger et nous l’envoyer. Il vous est possible de rédiger votre texte complet dans l’une des trois langues officielles de l’ICOM, à savoir l’anglais, le français, ou l’espagnol.
Structure attendue d’un résumé d’article
Un résumé d’article, d’une longueur d’environ 300 mots (sans compter la bibliographie sélective), doit donner, de manière succincte, l’essence du propos, et doit pouvoir être lu comme un texte à part entière. Il ne doit pas contenir d’images ni de notes de bas de page et doit être envoyé dans un fichier Word.
Il doit comprendre les sections suivantes :
1/ Introduction : une ou deux phrases qui décrivent le sujet dans son ensemble, y compris le contexte de l’étude présentée.
2/ Une problématique, ou les principaux axes de réflexion qui articulent les différents aspects critiques ou thématiques envisagés dans le texte. Il convient également d’identifier tous les aspects non étudiés précédemment par la recherche.
3/ L’originalité de la démarche adoptée par l’auteur doit être mise en lumière.
4/ La description de la méthode adoptée doit décrire l’approche choisie pour les études de cas, les entretiens, etc. (entre autres exemples).
5/ Une conclusion qui souligne l’impact de cette recherche, et qui expose les raisons pour lesquelles les résultats de la recherche sont importants.
6/ Une bibliographie sélective, citant uniquement les sources principales qui seront citées dans l’article (15 maximum).
7/ Des mots clés (5 maximum).
Museum Connection - Edition 2025

Salon professionnel international, résolument tourné vers les enjeux économiques et durables des musées, lieux culturels et touristiques, Museum Connections décode les tendances et innovations pour imaginer les nouvelles expériences de visite.
ICOM France propose à ses membres de se joindre au salon en bénéficiant d'une entrée gratuite : pour cela, rendez-vous sur le site du salon et utilisez le code ICOM2025
Thèmes clés abordés cette année :
|
ÉCOUTER ET ENGAGER LES PUBLICS |
|
Ce cycle de conférences s’articule autour de la relation entre les lieux culturels, les publics et les non-publics. Il met en lumière des démarches innovantes en matière d’'inclusion et d'accessibilité, et explore de nouvelles tendances pour mieux comprendre les publics et faire venir les non-publics. Les interventions abordent les thèmes suivants : l'apport des neurosciences à l'expérience culturelle, l’accessibilité universelle et le design inclusif, un focus sur l'accueil des personnes en situation de précarité, ou encore l'usage de la médiation ludique à destination des non-publics adultes.
|
INFORMATIONS PRATIQUES
Date et Horaires
Mardi 14 Janvier : 9h30 à 18h30
Mercredi 15 Janvier : 9h30 à 18h00
Lieu
Paris Expo Porte de Versailles - Hall 5.2
1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris, France
L’avenir des musées au sein de communautés en constante évolution
Annonce du thème
Dans le contexte actuel, marqué par une succession d’événements redéfinissant notre perception du monde et notre place dans celui-ci, nous sommes immergés dans une époque de transformation constante. Au cœur de ce paysage en perpétuelle évolution, nous nous efforçons de nous adapter, d’innover et de garder une longueur d’avance.
Il en va de même pour les musées, qui s’engagent également dans cette voie, à des rythmes variés en raison de leur grande diversité. Alors que nous traversons des changements, les musées réimaginent également leurs rôles et forgent de nouvelles connexions. C’est à ce voyage que nous invite ICOM Dubaï 2025 : envisager ensemble l’avenir des musées et de leurs communautés. Les professionnels des musées et des membres de leurs communautés se réuniront pour façonner collectivement leur avenir. L’objectif est de travailler ensemble pour préserver, partager et approfondir nos identités culturelles, en renforçant le rôle des musées en tant que piliers sociétaux vitaux et catalyseurs de croissance.
Le thème « L’avenir des musées au sein de communautés en constante évolution » résume l’environnement dynamique, en mutation continuelle, dans lequel nos communautés et nos musées naviguent aujourd’hui, tandis que trois sous-thèmes interconnectés inviteront à des discussions approfondies sur la sauvegarde du patrimoine immatériel, le pouvoir des jeunes et l’essor des nouvelles technologies.
Alors que nous nous préparons pour ICOM Dubaï 2025, unissons-nous pour définir une voie commune vers l’avenir.
Sous-thèmes
Le patrimoine immatériel
Ce sous-thème explorera le positionnement des musées en tant qu’entités dynamiques capables de sauvegarder le patrimoine immatériel, dans un environnement global en constante évolution. Face aux transformations rapides induites par les progrès technologiques, les changements démographiques, les flux migratoires, les mutations des modèles sociaux et les changements environnementaux, la sauvegarde du patrimoine immatériel est une préoccupation majeure dans le monde.
Le patrimoine immatériel incarne l’essence des identités culturelles et célèbre la richesse et la diversité. Il est donc essentiel pour les musées de promouvoir le patrimoine immatériel comme une source d’inspiration dynamique et un élément fondamental de notre culture collective. ICOM Dubaï 2025 invitera les acteurs régionaux et mondiaux à explorer et à définir de nouvelles stratégies et des pratiques innovantes visant à nourrir, promouvoir et transmettre le patrimoine immatériel aux jeunes générations. En outre, ce sera l’occasion de discuter de la continuité et de la revitalisation du patrimoine immatériel, en particulier dans les communautés soumises à des mouvements migratoires.
Dans un contexte de transformations globales, la préservation du patrimoine immatériel apparaît comme une mission essentielle. Les musées sont à l’avant-garde de cette quête, agissant comme une boussole qui cultive et sauvegarde notre héritage culturel collectif, aujourd’hui et demain. ICOM Dubaï 2025 incarnera cet engagement collectif, mettant en lumière les efforts conjoints des musées du monde entier, pour surmonter ces défis.
Le pouvoir de la jeunesse
La reconnaissance du pouvoir de transformation de la jeunesse : ce sous-thème se penchera sur le rôle essentiel de la jeunesse dans la création des musées de demain. Les jeunes sont le moteur nécessaire pour aller de l’avant et naviguer dans un monde en constante évolution, tandis que les musées possèdent un potentiel unique, offrant aux jeunes une fenêtre sur le passé, un outil de réflexion sur le présent et une plateforme pour façonner l’avenir. ICOM Dubaï 2025 sera une excellente occasion d’explorer ces synergies, ayant un écho mondial, notamment dans les régions qui connaissent une croissance de la population jeune comme le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, l’Asie du Sud et au-delà.
Les sessions d’ICOM Dubaï 2025 se pencheront sur le positionnement des musées en tant que lieux en plein d’essor favorisant le leadership des jeunes générations et de nouvelles formes d’engagement des jeunes dans la gouvernance. Elles aborderont également les stratégies et les politiques en faveur de la jeunesse, ainsi que des initiatives directement dirigées par eux et sollicitant leur participation active. Les discussions inviteront à la réflexion sur les perspectives des jeunes générations face aux changements ; à réimaginer les musées avec et pour les jeunes, en les positionnant comme une force vitale qui va permettre aux musées et à leurs communautés d’évoluer dans un contexte de changement. Il s’agit de trouver de nouvelles façons de découvrir et de récupérer, en encourageant les efforts collectifs pour trouver des formes innovantes de collaboration et d’engagement.
L’analyse de l’influence dynamique des jeunes générations au sein des musées marque une étape importante dans le façonnement des musées de demain. Grâce à des discussions sur le leadership, l’engagement et le point de vue des jeunes, ICOM Dubaï 2025 vise à positionner les musées comme des centres vibrant d’innovation et de coopération, guidés par l’élément moteur que forme les jeunes générations, stimulant la résilience, la découverte et la croissance collective des musées et de leurs communautés.
Nouvelles technologies
Dans la continuité des discussions d’ICOM Prague 2022, ce sous-thème explorera de nouvelles pistes pour placer les musées à l’avant-garde de l’innovation en matière de création et de préservation culturelles, d’engagement du public, d’apprentissage et d’efficacité opérationnelle. Alors que les communautés subissent des transformations rapides induites par les avancées technologiques, associées à l’essor de l’apprentissage à distance, les musées ont la possibilité d’exploiter ce potentiel pour créer d’autres formes d’expression, renforcer l’engagement du public et l’expérience des visiteurs, et améliorer les opérations.
ICOM Dubaï 2025 explorera des questions clés telles que : comment les musées peuvent-ils intégrer les nouvelles technologies de manière responsable ? Quelles sont les implications pour le public et les collaborateurs ? Comment la technologie peut-elle améliorer la création et le partage de contenu tout en préservant l’authenticité et l’émotion ? Les musées peuvent-ils développer des solutions personnalisées pour leurs communautés ? Les discussions chercheront à articuler le rôle que les musées peuvent jouer en adoptant les nouvelles technologies pour répondre et/ou anticiper leurs besoins et ceux de leurs communautés en constante évolution, tout en conservant au cœur de leur expérience le pouvoir et l’authenticité des expressions culturelles.
ICOM Dubaï 2025 propulsera les musées à l’avant-garde de l’innovation, en mettant en lumière le potentiel transformateur des nouvelles technologies. En tant que gardiens du patrimoine et catalyseurs du changement, les musées seront en mesure de forger l’avenir de la préservation culturelle et de leurs liens avec les communautés, dans un environnement technologique en perpétuelle évolution.
Dans un monde en mutation constante, ICOM Dubaï 2025 offrira une plateforme de dialogue, de collaboration et d’actions, où les professionnels des musées et les membres de leurs communautés pourront se réunir afin de relever les défis urgents et saisir les opportunités passionnantes qui se profilent à l’horizon. Que ce soit par le biais d’une participation en personne ou en ligne, la voix et l’expertise de chacun d’entre vous auront un pouvoir décisif quant à l’avenir des musées et de leurs communautés dans un contexte de transformation globale. Votre présence est essentielle pour définir l’avenir qui nous attend. Ensemble, saisissons cette opportunité et traçons avec audace une voie où les musées prospèrent grâce à une perspective innovante et à leur résilience.
Cliquez ci-dessous pour lire l’article en arabe, la langue locale de la Conférence générale de 2025 à Dubaï.


